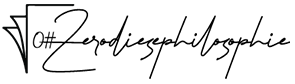Ecrit philosophique de Julien Machillot
Meetic et Metoo – 2020
Un seul crime, l’amour
(Titre du livre publié par Mary Letourneau et Vili Fualaau en 1998, aux éditions Fixot pour la traduction française)
A la fin des années quatre-vingt-dix, une relation amoureuse entre une institutrice de 33 ans, Mary Kay Letourneau, et un jeune homme de 12 ans, Vili Fualaau, qui venait d’être un de ses élèves, a défrayé la chronique aux Etats-Unis. Cette histoire est apparue dans ce pays puritain au dernier degré comme un scandale bientôt très largement connu, dont s’est lamentablement repue l’opinion pendant des mois. L’immense intérêt de cette histoire – notamment lorsqu’on s’y intéresse à l’aune du livre que Mary Kay, Vili Fualaau et la mère de celui-ci, Soona Fualaau ont publié ensemble en 1998, après le second procès qui a envoyé Mary Kay pour sept ans et demi en prison – est qu’il s’agit d’une histoire d’amour évidente, parfaitement incontestable, qui de plus ne se présente absolument pas comme une histoire de pédophilie.
Je voudrais ici rendre compte de cette histoire oubliée en citant le plus possible le livre écrit alors que Mary Kay Letourneau était en prison, de façon à leur donner la parole. Ce qui est absolument terrible en ce moment est la façon dont le réel du désir et des rencontres est recouvert par des propos extérieurs, par du bricolage idéologique totalement creux, la parole et la pensée des gens étant violemment niée, barrée, parfois par ceux-là même qui ont vécu une histoire et qui décident rétroactivement de la renier et de ne plus y voir qu’un mal, corrompant par là définitivement la beauté intrinsèque de ce qui avait pu avoir lieu. Je propose donc ici de méditer la possibilité radicale d’un amour vrai entre un adulte et un enfant.
Que Mary n’était absolument pas pédophile, nombre de ses propos l’atteste, et la mère de Vili, Soona, en a elle-même rapidement pris conscience :
« En écoutant Mary, j’ai bien compris qu’elle n’avait pas prémédité de se retrouver au lit avec mon fils. Elle n’avait pas du tout ce genre d’intention, mais voilà, une étincelle a allumé le feu de bois, et une chose en amène une autre. J’ignore ce qui s’est passé dans sa tête, pour que ça arrive, tout ce que je sais, c’est qu’elle n’était pas assez forte pour refuser ce que mon fils voulait d’elle. Et, Dieu me pardonne, quand il veut faire quelque chose, si je ne suis pas là pour le surveiller, il le fait. » (42, 43)
La raison de faire ressurgir cette histoire plus de vingt ans après est qu’il apparaît vite qu’à l’aune de celle-ci, la situation a empiré au dernier degré, au point que le puritanisme américain est en passe, avec les mouvements féministes actuels, de s’installer définitivement en France. Alors qu’elle était en prison, Mary Kay a reçu un certain nombre de lettres :
« J’ai reçu également beaucoup de lettres et d’appels venant du monde entier et notamment d’Europe. L’histoire avait été publiée en France dans certains journaux, et en l’espace de quelques semaines j’ai reçu une centaine de lettres de France. Pas une n’était négative à mon sujet. Chacun de mes correspondants m’apportait son soutien et pensait que j’étais victime d’une injustice. Il n’y avait pas de lettres d’injure… »
Aujourd’hui, la situation semble avoir bien changé, et pour le pire. Il est fort à parier que si cette histoire avait lieu actuellement, Mary Kay recevrait de France une centaine de lettres d’insultes et non plus de soutien.
Mary Kay Letourneau a grandi dans une famille américaine bourgeoise conservatrice, républicaine et catholique. Son père, John Schmitz, pour qui elle a toujours vouée une grande admiration, n’était pas tout à fait n’importe qui : après avoir été membre du Congrès sous Nixon, il s’est présenté aux élections présidentielles américaines de 1972. Républicain très conservateur, « un jour, à l’occasion de la visite historique de Nixon en Chine, il a déclaré qu’il ne voyait pas d’objection à ce que Nixon aille en Chine, sa seule objection était qu’il en revienne ». Quant à Mary Kay elle-même, elle s’est très tôt, dès l’enfance, envisagée comme mère et institutrice, ce qu’elle est devenue. Elle a eu quatre enfants de Steve Letourneau, et est devenu institutrice. Il n’est peut-être pas inutile de souligner qu’outre son implication quasiment sans limite dans son travail auprès des élèves, pour lesquels elle se dépensait sans compter, disposant d’une vaste expérience scolaire du fait des incessants déplacements dus aux activités politiques de son père durant toute son enfance, elle s’est forgée très tôt une orientation et une conception très affirmative et engagée de son métier d’institutrice. Un des points était le suivant :
« Quatrièmement : mes plans à court terme pour une éducation réussie comprennent des cours préparatoires en langue, une formation particulière pour les élèves doués (…). Je m’intéresse beaucoup aux élèves qui possèdent des dons particuliers. Nombre de mauvais élèves sont doués dans des domaines non conventionnels, talents qu’en ma qualité d’enseignante je peux repérer et encourager ».
Vili Fualaau sera un cas typique de « mauvais élève » dont elle décèlera des dons immenses, en particulier pour le dessin. Mais de tous les élèves qu’elle a eu et auquel elle s’est consacrée pendant plusieurs années, on sent que Vili est celui qui a poussé son travail jusqu’à son point d’impossible, et cela a été la condition du basculement dans la rencontre amoureuse. Elle raconte la façon dont, déjà très fragilisée par l’échec total de son mariage, il lui arrivait de quitter sa classe en pleurant devant ses élèves, ne pouvant supporter les âneries interminables de son élève malgré tout son dévouement professionnel. Elle disait aussi : « j’ai toujours pensé que Vili serait un jour un grand artiste, peut-être même le futur Picasso. Ce qui m’agaçait et me mettait parfois en colère, c’est que son parcours scolaire ne l’aidait pas ». D’une certaine manière, la situation d’enseignement était avec lui une situation événementielle, où l’enseignement est au bord du vide, confrontant l’enseignant à un choix tout à fait radical : ou bien abandonner la partie, abandonner l’enfant à son sort, ou bien accepter de basculer dans un autre registre, complètement différent, capable de franchir l’obstacle, de forcer l’impossible par la création d’une possibilité existentielle entièrement neuve et insoupçonnée. C’est un point crucial : Mary Kay n’est pas tombée amoureuse de son élève parce qu’elle était sexuellement attirée par les enfants, mais précisément parce qu’elle était une vraie enseignante, une pédagogue hors pair. Sans cela, il est clair qu’une femme de sa trempe ne se serait jamais aventurée dans une telle relation.
Cependant, l’autre facteur déterminant a été l’échec de son mariage avec Steve Letourneau, qu’elle raconte en détail et sur lequel je ne m’attarderai pas, et donc le fait qu’elle se soit à cette occasion découverte une « question métaphysique » commune avec celle de Vili Fualaau : « où mène le chemin ? ». La difficulté d’orienter Vili dans l’existence se nouait intimement avec sa propre désorientation existentielle. Au-delà de son enseignement, c’était donc en quelque sorte sa vie entière qui se retrouvait d’une certaine manière « au bord du vide ».
Le destin de Vili Fualaau est lui-même très singulier. Il raconte que lui et toute sa famille sont des Samoans, des Polynésiens américains, même s’il est né à Hawaï, où sa mère a grandi. Sa mère est venue vivre aux Etats-Unis après avoir quitté son mari.
« Ici à Seattle, la communauté s’est installée surtout en banlieue sud, près des usines Boeing, dans des quartiers comme Burien et White Center qui sont très proches l’un de l’autre. Je ne crois pas que nous ressemblons aux autres habitants des îles du Pacifique Sud, ou aux Asiatiques, qui eux aussi vivent en communauté à Seattle, comme les Cambodgiens, les Vietnamiens ou les Philippins. Ils ont toujours l’air de se battre entre eux ces types. Les Samoans, eux, forment une vraie communauté soudée et fraternelle. Tout le monde sait que les Samoans sont des types costauds, et personne va leur chercher de crosse. On appelle « Hood » le coin où nous vivons. Un raccourci de neighborhood en américain. Ce n’est pas vraiment un ghetto, ou un endroit de ce genre, mais il y a des gangs et tout ça, et chacun a son propre territoire dans le « Hood ». Le mien s’appelle « Roxbury Hood », un genre de banlieue ouvrière, où l’on trouve beaucoup d’ethnies différentes. Il y a des gens qui louent leur maison, pas très cher, mais aussi beaucoup de gens propriétaires. Des gangs se sont formés dans le coin, c’est comme ça qu’on se sent forts.
Il se passe des tas de trucs dans le « Hood », des vols de voiture, de magasins, des bagarres, toutes ces choses. J’étais dans un gang qui piquait des bagnoles, à un moment, juste pour rouler avec pendant quelques jours. Si des concurrents étrangers se pointent dans le quartier, ou même des flics, on est très vite au courant, on surveille. Si un autre gang essayait de s’installer dans le « Hood », il y aurait sûrement de la bagarre.
Mais je ne crois pas que ce soit déjà arrivé. Parfois les choses peuvent tourner à la violence, mais ce n’est pas souvent, quoique, une fois, j’étais dans une voiture, et quelqu’un a carrément tiré dessus. Ce sont des jeunes pour la plupart, mais quand on a vingt et un ans ou plus, on peut tomber dans le vol à main armée, la drogue et même se retrouver mort. C’est ça grandir dans le « Hood ».
Malgré tout ça je préfère grandir ici que dans des quartiers de Blancs, comme Bellevue ou Renton, là où sont les gosses de riches. C’est pas une histoire de racisme, parce que dans les gangs que je fréquente, il y a aussi des Blancs, comme mon copain Chris. Mais il vaut mieux grandir dans le « Hood », moi je dis que ça ouvre les yeux d’un mec vite fait, alors que si on grandit dans les quartiers riches, on est des singes, on apprend rien sur la façon dont le monde tourne. C’est ce que je pense. Des fois on descend en ville, juste rigoler après les singes, ces jeune Blancs gosses de riches, rien que des nuls.
Quand on est arrivés ici, j’avais environ quatre ans, et maman était seule pour élever et nourrir quatre gosses. La maison était toujours emplie de monde, des tantes, des oncles, des cousins, des amis. Maman travaillait tout le temps dehors, et il fallait presque que je me débrouille tout seul à mon âge. Ça m’a fait grandir vite.
Il y avait des jours où la maison était tellement pleine de monde, qu’on entendait discuter et crier et râler dans tous les coins. J’aurais bien voulu me trouver un endroit pour dessiner tranquillement. J’ai commencé à dessiner tout ce qui me passait par la tête, quand on est venus de Hawaii. Je fais ça facilement, et les gens disent toujours que c’est super. Je sais que c’est bien, et que j’ai un vrai talent, pas seulement parce que les gens le disent, mais parce que je regarde aussi ce que font les autres artistes, et bien souvent je trouve ça nul. » (61-62)
Le rapport à son père, avant d’en être séparé, était fait à la fois de haine et d’admiration. Haine contre sa violence, mais admiration envers un homme qui lui paraissait être un chef important de l’île, un chef de gang ou de mafia. Il l’a en fait très peu connu, sa mère Soona s’étant séparée de lui pour échapper à sa violence : « je crois bien qu’il était dans le trafic des drogues, il devait livrer par-ci par-là, brutaliser et cogner les gens et tout ça. Il avait l’air de tout contrôler sur cette putain d’île d’Hawaii. Je suppose que j’ai dû fantasmer sur lui, je croyais que c’était quelqu’un à qui il fallait ressembler. Je me souviens qu’une fois, on était sur la plage et mon frère Perry s’est fait prendre par un mauvais courant, il était entraîné de force. Mon père a foncé dans les vagues, il l’a arraché de l’eau comme un rien. Ce jour-là, il a sauvé Perry de la noyade.
Je suis retourné à Hawaii depuis, la famille m’a aidé à remplir un peu les trous à propos de mon père, moi je savais pas vraiment qui c’était. Il paraît que c’était un sale mec finalement, qu’il était tout le temps en prison, et en plus qu’il y a fumé du crack. Un truc que j’aime pas du tout. »
La figure déterminante de la vie de l’enfant Vili a été non son père, mais sa mère, Soona, que manifestement il aimait, respectait et craignait tout à la fois. Figure d’autorité et figure centrale de la famille. Les choses s’éclaircissent dans le récit que fait Mary du temps qui a suivi l’accouchement, à l’hôpital :
« Quelques temps plus tard, j’ai eu l’impression que le peuple samoan tout entier surgissait dans ma chambre. Soona, Leni et Seni, la sœur et la tante de Vili, sont arrivés. L’ambiance dans la chambre a aussitôt changé. Vili, réfugié près de la fenêtre, s’est fait tout petit sur sa chaise, tandis que Soona occupait le centre de la scène, installée dans un rocking-chair, le bébé dans les bras.
La manière dont Vili se rapetissait ainsi devant sa mère me contrariait. Les Samoans ont, il me semble, un système matriarcal qui écrase les hommes. Voir l’être que l’on aime se retrouver brusquement dans cette situation est assez bouleversant. On avait délibérément mis de côté Vili, tassé sur sa chaise contre la fenêtre, et sa mère avait pris la situation en main. Heureusement, nous avions eu le temps d’être un peu seul, Vili avait pu prendre le bébé dans ses bras et lui parler comme un père. » (247)
Mais le plus intéressant est le rapport de Soona à son fils. C’est d’elle que lui vient son surnom de Bouddha, et elle a très tôt considéré que Vili était « une vieille âme dans un jeune corps ». Soona tient son fils pour responsable de ce qui s’est passé avec Mary. Or, qu’une mère puisse tenir son fils mineur pour responsable de sa relation avec une femme adulte est déterminant, car cela signifie la possibilité de l’amour aux yeux de la mère elle-même, ou plus précisément la capacité d’être sujet dans le registre de l’amour. Bien sûr, cela ne va pas au départ sans une profonde incompréhension, mais elle finit par l’accepter, et par se rallier à l’amour de Mary et Vili contre la loi et le jugement :
Soona : « Il y a une période où j’aurais volontiers étranglé Mary pour ce qu’elle avait fait. D’abord, je ressentais de la colère en tant que mère, elle avait trompé la confiance que j’avais en elle. Non seulement Mary est aussi une mère, mais nom d’un chien, elle était l’institutrice de Vili !
Pourtant aujourd’hui, assise sur ce banc de la salle d’audience, je la regarde et j’ai envie de lui tendre les bras. Si je pouvais seulement être à ses côtés et lui montrer que je la soutiens.
Si je pouvais m’avancer pour l’embrasser devant tous ces gens, la rassurer, lui dire que tout ira bien. Je sais bien pourtant, au fond de moi, que rien n’ira bien, qu’elle va les prendre, ces sept ans et demi de prison, mais ça ne fait rien, elle a mon soutien, et j’aurais voulu montrer aux autres qu’ils auront beau l’enfermer, la punir autant qu’ils voudront, mon cœur est avec elle, et je ne ressens plus aucune colère envers elle.
Je suis sincèrement désolée à présent, je m’en veux de ne pas avoir le cran de la prendre dans mes bras, là, devant tout le monde. Je crains tous ces journalistes, et leurs réactions. Beaucoup ont déjà entendu parler de moi, ils connaissent mon nom, mais personne ne connaît mon visage, et il vaut mieux que ça reste ainsi. En allant au tribunal ce matin, je me demandais encore comment je réagirais vis-à-vis de Mary. La colère ou le pardon ? Je n’étais sûre de rien, jusqu’au moment où je l’ai vue arriver dans la salle d’audience, avec ses boucles blondes, ses grands yeux d’enfant écarquillés, l’air tellement perdu et désorienté. A cette minute j’ai compris que mon cœur était avec elle.
Je me suis assise dans un coin, loin des regards insistants des journalistes, en essayant de contenir ma rage après eux… C’est la manière dont il la traite qui me met en rogne. Je suis une femme simple, je comprends des choses simples. Et ce que j’entends ici ne me plaît pas. La cour dit qu’elle a commis un crime. Le viol de mon fils, qu’ils disent, mais moi je n’ai jamais vu ça comme un viol. Ou alors ce viol est une drôle de chose. J’ai toujours cru que le viol, c’était prendre quelqu’un contre sa volonté. Et qu’est-ce qu’on a dans cette histoire ? On a deux parties consentantes, deux personnes conscientes de ce qui s’est passé entre eux, et qui le désiraient. Je sais bien, moi, que ce n’est pas un viol, et Dieu le sait aussi. Sûr que c’était un adultère, ça, je ne peux pas dire le contraire, mais pas un viol ! Ils ne connaissent pas mon fils !
En écoutant les avocats et le juge, les choses se compliquent encore dans ma tête. Je finis par me demander à quoi servent nos lois. J’ai toujours pensé qu’elles étaient faites pour nous protéger, même si je sais qu’il est impossible de traiter chaque cas séparément, de l’examiner individuellement, selon ses caractéristiques propres. Mais il faudrait aussi admettre que certaines choses sont particulières dans la vie. On ne peut pas toujours suivre la loi à la lettre. A mon avis, c’est le cas pour Mary et Vili.
C’était un mercredi, quand les policiers m’ont appelée pour la première fois à cause de tout ça. Le lendemain, ils arrêtaient Mary et l’inculpaient. Un tas de gens voyaient le problème différemment, chacun avait son idée, et moi, j’avais déjà les idées confuses, tout embrouillées.
Quand il se passe quelque chose, je tente toujours de comprendre par moi-même comment c’est arrivé, et pourquoi. C’est ce que j’ai essayé de faire. J’ai téléphoné à Mary pour qu’on se rencontre quelque part dans la marina, un endroit à peu près tranquille. C’est assez drôle, car j’ai appris plus tard que c’était là que Vili et elle se rencontraient souvent.
J’avais décidé d’emmener une amie avec moi pour ce rendez-vous. A cause de l’état d’esprit dans lequel j’étais à ce moment-là, en colère, inquiète, et aussi parce que je ne savais pas comment les choses allaient tourner. On est arrivées à la marina vers 9 heures du soir, il faisait déjà sombre, Mary était en retard, et quand elle s’est enfin montrée, le parking était déjà fermé. Nous sommes allées de l’autre côté de la route, dans le parking du restaurant, chez Anthony. Il y avait beaucoup de monde, avec tous ces gens qui entraient et sortaient, et personne ne nous a prêté attention. On est restées dans la voiture de mon amie, pour discuter.
Je n’avais vraiment qu’une seule question à lui poser : « Pourquoi ? » Et je l’ai répétée plusieurs fois :
- Dis-moi seulement pourquoi c’est arrivé, Mary ?
L’ambiance a chauffé par moments, quand j’élevais la voix. Parce qu’elle me parlait d’amour, et de son intime conviction, au plus profond de son âme… Moi, je n’étais pas là pour entendre ces salades. Je lui répétais :
- Non, Mary, dis-moi pourquoi, c’est tout. Dis-moi comment c’est arrivé !
Elle était incapable de me fournir une explication, et jusqu’à ce jour, alors que le tribunal va l’envoyer en prison pour la deuxième fois, pour sept ans et demi, elle ne m’a toujours pas dit pourquoi.
Ce soir-là, recroquevillée dans la voiture sur le siège du passager, Mary m’a fait pitié, elle était pathétique, enfantine, à sangloter en marmonnant tous ces trucs sur l’amour et le reste. J’ai essayé de m’y prendre autrement :
- Pourquoi tu n’es pas venue me voir ? On aurait pu s’en sortir ensemble ! J’aurais peut-être piqué une colère, fulminé après vous deux, sûrement même, mais ça ne serait pas sorti de ma maison ! On se serait débrouillées, on aurait trouvé une solution.
C’était la meilleure façon de faire, j’en suis toujours persuadée. » (9-11)
Elle ajoute :
« Je lui disais tout ça, et elle hochait la tête, en m’implorant toujours de comprendre que l’amour qu’ils avaient l’un pour l’autre était exceptionnel. Ça m’a fichue en rogne à nouveau, j’avais pas besoin de ce genre de parenthèse romantique pour le moment ! Comme tout le monde, comme n’importe qui, je ne voyais que le problème de l’âge.
- Mary, il faut que tu regardes les choses en face, c’est un gosse de treize ans ! Et tu es une femme mariée, avec un tas de gosses déjà. T’as un fils qui a pratiquement le même âge que Vili…
Mais elle arrêtait pas de dire :
- Je sais, je sais, je sais…
- C’est toi la plus vieille dans tout ça, tu le savais bien, tu n’aurais pas dû te laisser faire… dis-le moi maintenant, de mère à mère, entre quatre yeux, hein ? Pourquoi ? Pourquoi c’est arrivé ?
On est restées là dans la voiture, peut-être deux heures, et je n’ai pas eu de réponse. Mais au moment de la quitter, même si mon cœur ne comprenait toujours pas, j’avoue qu’il lui avait au moins pardonné. Une mère ne peut que prier quand son enfant aime véritablement celui ou celle qu’il a choisi. Pour que leur union ne soit pas superficielle, mais basée sur des sentiments profonds, sur ce qu’ils peuvent s’apporter l’un à l’autre.
Et je commençais à comprendre qu’elle aimait vraiment mon fils, même s’il n’avait que treize ans. J’ai toujours dit, et je l’ai répété bien des fois depuis, Vili, c’est « une vieille âme dans un jeune corps ».
Et Mary l’a en quelque sorte prouvé.
…
A présent, je vais être témoin, dans cette cour, d’une parodie de justice. Je ne suis venue là que parce que l’avenir des enfants me concerne. D’abord, il y a Audrey, le bébé de Mary et Vili. Ma préoccupation est qu’elle devra grandir sans connaître sa mère. Les autres enfants de Mary, qui sont avec leur père, auront tous des souvenirs de Mary en tant que mère, ils auront toujours des petites choses en commun, des choses faites ensemble, des images d’enfance. Mais les souvenirs d’Audrey ne viendront que de sa grand-mère, de son arrière-grand-mère et de la famille de son père.
Dans le meilleur des cas, elle ne saura que peu de choses à propos de sa mère. J’ai bien essayé de convaincre les gens de la prison de me laisser lui emmener l’enfant, mais ils se sont montrés inflexibles. Ne voient-ils pas qu’ils sont tout simplement en train de déposséder une petite fille de sa mère ?
Le silence est pesant. Au moment où le juge énonce la sentence, je suis sous le choc. A ce moment précis, je voudrais être avec elle. J’avais beau m’attendre à ce qu’elle écope des sept ans et demi qu’on lui avait promis la première fois, j’avais malgré tout gardé un petit espoir et je suis triste pour Mary à présent. Je suis triste aussi pour tous ceux qui sont embarqués dans ce pétrin. Pour elle, pour sa famille, son avocat, mon fils, ma petite-fille, et ses quatre autres enfants. La seule personne pour laquelle je ne ressens rien, c’est son mari.
Mais pour Mary, c’est comme si quelqu’un de ma famille venait de mourir. C’est tellement dommage, elle avait tant de cartes en main, et elle a tout perdu. Elle a déjà sacrifié sa liberté une fois et, pour la retrouver, elle devait déjà payer un certain prix : ne plus revoir mon fils et ses enfants. Je pense que Mary s’était dit que, même hors de prison, elle resterait une prisonnière, car le prix qu’on lui demandait, en particulier de ne plus revoir ses propres enfants, était bien trop élevé. Ça, je peux dire que je n’arrive pas à y croire ! Même un meurtrier a le droit de voir ses gosses, un meurtrier peut coller les photos de tous ceux qu’il aime sur les murs de sa cellule. Pas Mary. Si un mari tue sa femme, il a toujours le droit de voir ses enfants, et il a le droit de les retrouver dès l’instant où il sort de prison. Pas Mary.
La loi, dans sa grande sagesse, a décidé qu’elle n’était pas capable de voir ses enfants et Vili sans leur faire de mal, alors qu’elle les aime du fond du cœur. » (41-44)
On voit bien, si on laisse pour l’instant de côté la question de la justice et de la loi, que la difficulté pour Soona est qu’elle ne peut que se convertir à l’amour de son fils sans jamais avoir la réponse à sa question « pourquoi ? », pour la simple et bonne raison que l’amour est sans pourquoi. L’amour est en quelque sorte comme la rose de la sentence mystique d’Angelus Silesius que commente longuement Heidegger dans Le principe de raison :
« La rose est sans pourquoi, fleurit parce qu’elle fleurit,
N’a souci d’elle-même, ne désire être vue ». (104)
L’amour est sans pourquoi, il ne saurait relever d’aucun principe de raison suffisante, puisque son origine est événementielle et bouleverse la ligne de partage entre le possible et l’impossible. L’absence de pourquoi caractérise certainement tout à la fois ce qu’il y a de meilleur et ce qu’il y a de pire dans la vie humaine. Aux antipodes de l’incompréhension de Soona, on trouve l’histoire racontée par Primo Levi dans Si c’est un homme, au moment où il découvre en tant que détenu juif le camp de concentration et d’extermination d’Auschwitz :
« Et justement, poussé par la soif, j’avise un beau glaçon sur l’appui extérieur d’une fenêtre. J’ouvre, et je n’ai pas plus tôt détaché le glaçon, qu’un grand et gros gaillard qui faisait les cent pas dehors vient à moi et me l’arrache brutalement. « Warum ? » dis-je, dans mon allemand hésitant. « Hier ist kein warum » (ici il n’y a pas de pourquoi), me répond-il en me repoussant rudement à l’intérieur.
L’explication est monstrueuse, mais simple : en ce lieu, tout est interdit, non certes pour des raisons inconnues, mais bien parce que c’est là précisément toute la raison d’être du Lager. Si nous voulons y vivre, il nous faudra le comprendre, et vite. » (29)
On voit la différence entre le bon et le mauvais « sans pourquoi » : le mauvais consiste en la prescription d’un nouvel interdit étendant le champ de l’impossible et écrasant la vie humaine, tandis que le bon « sans pourquoi » consiste à transgresser un interdit afin de forcer l’impossible vers la création d’une possibilité nouvelle rendant la vie humaine plus vaste et plus haute.
Par ailleurs, Soona a parfaitement raison de considérer son fils comme ayant été à l’initiative de la rencontre amoureuse. Mary le résume très bien :
« Ce jour-là, dans ma voiture, j’étais face à l’incertitude totale quant à mon avenir, et je songeais à Vili Fualaau. J’aimais vivre seule, cela m’arrivait parfois, j’étais parfaitement heureuse de l’existence elle-même, de mon rôle de mère et d’enseignante. Je ne songeais nullement à rencontrer un partenaire. Je ne cherchais rien, jusqu’à ce que je sois brutalement accostée par Vili. A présent, je n’avais plus beaucoup de chance d’y échapper. J’étais là, dans ma voiture, hébétée. Mais aussi la tête pleine d’incrédulité et de colère. Car je savais intimement, à ce moment-là, qu’il était devenu mon compagnon pour la vie, et j’espérais être sa compagne.
Mais nous étions trop amoureux, et je sentais surtout que les règles de la société contemporaine allaient nous perdre et nous blesser.
Je savais que nous venions de franchir une barrière déterminante dans notre relation. » (138)
Tout cela place Vili à des années lumières de toute considération en termes de « victime traumatisée » ! Du reste, le meilleur moyen de s’en rendre compte, c’est de l’écouter et de juger sur pièce. Voilà comment il raconte sa première rencontre avec la police, liée à cette affaire :
Vili : « Les flics se sont pointés à l’école pour venir me chercher. J’avais séché un cours, pour aller fumer dans les toilettes, en sortant je suis tombé sur la principale, Mme Baily, et une autre femme que je connaissais pas.
- Oh ! Vili ! Justement nous te cherchions.
Merde. J’allais me faire gauler pour avoir séché le cours. On s’est tous retrouvés dans le bureau du conseiller d’éducation, à côté de celui de la principale. Ça avait l’air sérieux. J’attendais que les emmerdements me tombent dessus. Et voilà que cette bonne femme dit qu’elle est inspectrice. Là, je me demande ce que j’ai bien pu faire… Un truc que j’aurai oublié, ou alors j’ai pas eu de bol, on m’aura vu fumer aux alentours de l’école… Je pensais vraiment qu’elle était venue me coincer pour un truc de ce genre, mais la voilà qui me balance aussi sec de ne pas me faire du souci et que j’ai pas d’ennuis…
Là, je me demandais encore plus ce qui se passait. J’ai bien pensé à Mary, mais sans y croire vraiment, jusqu’à ce qu’elle me demande :
- Tu connais Mme Letourneau ?
Evidemment… voilà pourquoi elle était là.
Ça m’a scandalisé. Je connais pas de grands mots pour le dire : scandalisé ! Cette espèce de tordue de flic, ce rat humain avec ses petits yeux vicelards, ses grandes oreilles et son nez de fouine ! Elle posait la question mine de rien : si je connaissais Mary !
Et elle raconte qu’elle est déjà au courant de notre liaison, et de toute l’affaire sexuelle.
Putain, j’avais la trouille ! Je savais que Mary pouvait aller en prison, à cause de notre différence d’âge.
La flic a dit qu’elle s’appelait Maley, et elle s’est mise à faire la gentille avec moi, polie et attentive, comme si j’étais malade. Elle m’a emmené comme ça, dans sa voiture, jusqu’au poste de police du centre-ville. Elle avait même pas prévenu ma mère ni rien, et pendant le trajet elle s’est mise à vouloir discuter de « mon cas » et à me demander des trucs du genre : « Est-ce que Mary t’a manipulé ? », « Est-ce qu’elle t’a forcé à faire des choses avec elle ? » J’avais beau lui dire qu’il n’y avait rien de tout ça dans l’histoire, elle marmonnait et elle arrêtait pas de m’interroger. Elle voulait absolument que Mary m’ait forcé à faire l’amour. Et moi je répétais : « Mais non… Non… et non. »
Elle me traitait comme un gosse de cinq ans ! Elle me parlait comme à un môme ! Elle se foutait de moi ou quoi ?
On est arrivé au poste, on s’est assis à son bureau, et là elle a téléphoné à ma mère pour tout lui raconter sur Mary. Elle en débitait, des conneries ! Et moi je me disais : « Gagné ! Merci, salope ! Merci ! Grâce à toi je vais me faire botter le cul à la maison. »
Après ça, elle a demandé si je voulais rentrer chez moi, ou qu’on m’emmène quelque part ailleurs. J’ai répondu ailleurs, je voulais pas rentrer à la maison. Après ça, elle a dit qu’elle me ramènerait quand même chez moi, mais qu’elle avait encore quelques questions à poser à ma mère. Elle les a posées. Pendant ce temps-là je me demandais ce qui s’était passé. Qu’est-ce qui avait bien pu arriver à Mary ? J’étais vachement inquiet que Mary ait fait une connerie, se suicider ou un truc comme ça.
La flic Maley avait bien vu que ça m’embêtait qu’elle ait appelé ma mère, alors elle a dit que si elle me battait elle aurait des problèmes, donc qu’elle n’avait pas intérêt à me toucher. Ouais… super ! Encore merci !
Après son coup de fil, elle a demandé si j’avais faim, et elle m’a emmené dans un restaurant chinois. Là, elle a commencé à me raconter qu’elle avait déjà eu à s’occuper de cas de mineurs comme le mien. Puis elle a dit :
- Est-ce que tu veux que tout ça s’arrête ?
Là, j’étais pas sûr de ce qu’elle voulait dire. Que s’arrête ma liaison avec Mary ou qu’elle arrête de me gonfler avec ses questions ? Alors j’ai répondu : « Ouais. » Au hasard. Je savais plus où j’en étais, et ce qui attendait Mary.
On mangeait, elle était en train de poser encore des questions sur Mary, et tout à coup elle demande un truc complètement bizarre.
- Est-ce que tu pourrais avoir une relation avec une femme comme moi ?
Alors là… j’ai seulement répondu que je savais pas… J’aurais bien dit carrément : « Non », mais je voulais pas la mettre en rogne. Après ça on est retournés à son bureau.
Chaque fois que j’essayais de lui expliquer ma liaison avec Mary, elle m’interrompait :
- « Incident » avec Mary.
Elle voulait pas du mot « liaison ». Mais ça voulait dire quoi « incident » ? On a un incident, avec une femme ? Elle tournait comme ça autour de petits détails, et à un moment elle a demandé :
- Est-ce qu’elle a essayé de t’enlever tes vêtements ?
- Je me rappelle pas.
J’en avais marre. Je voulais plus parler à cette femme, plus rien lui dire. Mais elle continuait :
- Est-ce que Mary t’a forcé à faire quelque chose ?
- Sais-tu ce que signifie « rapports sexuels » ?
- Combien de fois l’as-tu fait avec Mary ?
Ça me paraissait un chiffre raisonnable. J’ai pas dit zéro, parce que Mary était enceinte et qu’ils auraient fait un test pour savoir de qui était le bébé. Mais je lui ai pas dit la vérité non plus, la vérité c’est entre deux et trois cents fois. Parce que j’avais peur qu’on lui colle des charges en plus, et qu’on l’enferme pour le restant de sa vie. Je savais que c’était déjà sérieux, mais si notre liaison n’avait pas l’air normale pour les autres, alors là, ça deviendrait vraiment grave pour elle.
Six, je trouvais que ça avait l’air normal, moi.
Pendant quatre, cinq, peut-être six heures je suis resté là à me faire chier avec cette flic. J’aurais voulu être ailleurs, j’en avais marre qu’elle me pose tout le temps les mêmes questions sur les mêmes trucs. J’en suis arrivé au point où je regrettais presque d’avoir sauté Mary. J’étais mal, je commençais à me sentir coupable de tout ça. Je me disais : « Si seulement je pouvais remonter le temps, j’aurais plus jamais l’idée de baiser mon prof. J’y penserais pas une seconde ! » Après toute cette salade avec la flic, ça m’a passé. Je regrette pas. Mais sur le moment… merde ! J’en pouvais plus.
J’ai commencé à dessiner n’importe quoi sur du papier, un ange, parce qu’à ce moment-là j’étais fana des anges, et quand j’ai eu fini la flic Maley a dit que ça lui plaisait beaucoup et elle l’a accroché dans son bureau. Maintenant elle doit raconter à tout le monde qu’elle est mon amie ! Tu parles d’une amie ! » (225-228)
Ce récit est à la fois drôle et très choquant. Extrêmement comique par ce que la position d’énonciation de Vili fait surgir de grotesque dans le rapport à lui des adultes qui le prennent pour une victime, mais aussi franchement sinistre et dégoûtant par ce qui s’y révèle du comportement de la commissaire chargée de l’interroger. Ce qui ressort de tout cela avec la dernière brutalité, et qui sera une constante du rapport des flics et autres autorités au jeune Vili, c’est qu’à aucun moment il n’est écouté, à aucun moment ce qu’il peut avoir à dire de ce qui a eu lieu ne sera pris en compte. Sa parole est entièrement et définitivement niée a priori du fait même de son assignation, à la fois juridique et d’opinion, en tant que mineur, à la catégorie de victime. « Victime » se révèle ici pour ce que c’est : une catégorie violente et barbare de négation de l’expérience et de la subjectivité réelles de celui qui est envisagé de l’extérieur comme relevant de son extension.
Le pire est que la commissaire ait pu oser poser une question telle que : « est-ce que tu pourrais avoir une relation avec une femme comme moi ? ». La réponse est évidemment « non ». Mais de quel droit en déduire que dans ce cas, le jeune homme ne saurait désirer avoir une relation avec Marie ? Ici opère le recouvrement de la singularité absolue du désir et de l’amour par l’idéologie des « critères de rencontre » propagée depuis par les sites de rencontre (tel âge, telle taille, tels loisirs, etc.) !
Vili fait le bilan de son rapport aux autorités avec une parfaite lucidité :
« J’y comprend rien. Qu’est-ce qui s’est passé au fond ? Ils ont arrêté Mary. Voilà ce qui s’est passé. Elle s’est encore fourrée dans le pétrin. Comment elle fait pour se coller tout le temps dans la merde comme ça ?
La première fois, pour la première arrestation, on ne pouvait pas y échapper. Ces saletés de flics sont arrivés, l’air au courant de tout, me racontant qu’ils étaient désolés pour moi, qu’ils allaient me sortir de là, j’avais qu’à leur raconter ce qui s’était passé. Tous le genre sympa les mecs, j’avais qu’à leur déballer mon histoire, et ils allaient m’aider, ils voyaient bien que j’étais une pauvre victime et tout un tas de trucs comme ça.
M’aider ? Sans blague ? Vraiment m’aider ? Tout ce qu’ils ont fait c’est de foutre ma vie en l’air et celle de Mary avec. Si c’est ça aider quelqu’un ! Pourquoi ne pas nous foutre la paix tout simplement ? Comme si j’étais une victime ! Moi ? Tu parles. Des conneries tout ça. Rien que du flan. Le seul mal qu’on m’a fait, c’est eux qui l’ont fait en débarquant. C’est comme ça que tout a commencé à aller de travers. Dès que Mary a été arrêtée, tout le monde s’est pris pour un fichu expert en la matière, sans blague, ils ont commencé à décortiquer ce qui s’était passé, à porter des jugements sur tout, sans savoir le plus petit morceau de vérité sur nous deux.
Tous ces experts à la noix passaient leur temps à dire qu’on m’avait fait du mal, que j’étais traumatisé à cause de mon âge, que c’était horrible qu’une femme occupant un tel poste de confiance ait pu en tirer avantage. Mais de quoi ils parlaient tous ces imbéciles ? Non seulement ils n’écoutaient pas ce que j’avais à dire, mais ils ne s’adressaient même pas à moi !
Je pensais exactement comme dans cette chanson à la mode que j’écoutais souvent : « Allez tous vous faire foutre ! » » (23-24)
Les procès :
Venons-en maintenant aux procès de Mary Kay Letourneau. Les choses se sont déroulées en deux étapes. Dans un premier temps, sur le conseil de son avocat, elle a accepté de plaider coupable et de se déclarer « malade mentale », « délinquante sexuelle », ce qui revenait à accepter la qualification juridique de sa relation avec Vili comme relevant d’un « viol », en échange de quoi elle ne serait en prison que le temps du procès et ne serait pas jugée comme « criminelle ». Seulement, cela signifiait aussi qu’elle s’engageait à suivre un traitement pour sa « maladie mentale » (psychiatres, thérapies de groupe avec de réels violeurs patentés…) et surtout qu’à l’issue du procès elle acceptait de cesser définitivement de voir et Vili, et ses propres enfants !
Mary Kay : « Après ma première arrestation, on m’avait laissée en liberté. En attendant que le juge statut sur mon sort, j’avais accepté de suivre un programme d’aide psychologique. Et d’y perdre mon temps à subir les expertises et les évaluations mentales. On voulait me faire entrer dans une de leurs boîtes, me cataloguer. Tout le monde était convaincu que je souffrais de certains désordres de la personnalité.
Lorsque nous avions choisi ce système de défense avec mon avocat, j’y croyais. D’abord David Gehrke avait confirmé ce que m’avait dit la police : si je plaidais coupable pour viol, je ne serais condamnée qu’à subir le programme d’aide aux délinquants sexuels. D’après lui, c’était là « mon unique option ».
Ensuite les options se sont réduites et précisées : ou bien j’acceptais le programme, ou bien j’allais en prison pour sept ans et demi. En dépit de tout ce que j’avais pu dire, de mon espoir de régler l’affaire entre les deux familles, pour éviter les médias, je n’avais que deux solutions : accepter d’être une malade mentale, ou être enfermée. Je me pose toujours des questions sur la législation de notre Etat : pourquoi la loi n’a-t-elle rien prévu entre ces deux options ? » (231)
Elle ajoute : « La première audience avait été fixée au mois d’août, je devais en principe y plaider coupable de viol. Je savais qu’à la fin du délai accordé par la cour, je devrais aller en prison en attendant que le juge reçoive les rapports des nombreux psychiatres et psychologues qui s’étaient penchés sur mon cas. Ils avaient trois semaines pour rendre leur dossier. Ce qui signifiait trois semaines de prison préventive à partir du mois d’août car, selon la loi de l’Etat, quiconque plaide coupable d’agression sexuelle doit rester enfermé dans l’attente de son procès.
…
La séance devant le tribunal a été courte. Les médias en ont fait trop en clamant plus tard que j’avais supplié qu’on « m’aide ». Alors que j’avais dit : « Aidez-nous tous… » Ils n’ont ni écouté ni retranscrit correctement les trois malheureuses phrases que j’ai eu le droit de prononcer.
Lorsque j’ai déclaré : « j’ai mal agi », j’étais sincère. Ce que j’avais fait était mal, contre les principes de ma religion, car j’étais encore mariée. J’avais donc tort, moralement autant que légalement. Moralement vis-à-vis de l’Eglise, et légalement parce que j’avais rompu mon contrat de mariage.
Lorsque j’ai déclaré : « Cela ne se reproduira plus, je vous en prie, aidez-moi », je voulais en fait dire que j’allais divorcer, et que la situation serait différente. Je ne voulais pas dire que je ne reverrai plus Vili, je n’ai jamais voulu dire cela. Seulement que je ne me mettrais plus dans ce genre de situation.
Et lorsque j’ai dit : « aidez-nous tous », il est vrai que je réclamais de l’aide, et cela a pu paraître très ambigu. Aidez-nous tous… Ne détruisez pas deux familles, laissez-nous nous aimer, donnez-nous la chance d’élever notre enfant, laissez-moi continuer à être la mère que j’avais toujours été.
Mais pour pouvoir comprendre, encore fallait-il écouter chacune de ces trois phrases.
Je n’avais pas le droit de plaider plus longtemps ma cause. Mon avocat l’avait fait. Et lorsqu’un juge vous demande en fin d’audience, à brûle-pourpoint, sèchement, d’un air presque méprisant : « Accusée, avez-vous quelque chose à ajouter ? »… Mon Dieu, j’aurai eu tant à dire que j’en tremblais.
La première audience passée, je me préparais à entrer en prison, espérant que j’allais supporter cette nouvelle épreuve sans trop de dégâts. On m’avait enlevé Audrey, qui par bonheur avait été confiée à Soona et Vili. Je devais subir encore d’autres tests psychologiques. Les trois semaines d’incarcération devaient durer jusqu’au 29 août, jour de mon retour devant le tribunal, cette fois pour y entendre la sentence. D’après mon avocat, je pouvais, en restant plus longtemps incarcérée, bénéficier d’une consultation avec l’un des meilleurs psychiatres, agréé par le tribunal, le docteur Copeland. Quel que soit le délai, et le temps que cela prenne, je devrais suivre en attendant un traitement destiné aux délinquantes sexuelles. Je ne comprenais toujours pas que l’on puisse me considérer comme telle.
La date de la sentence tardait à venir, j’étais dans le flou. Les trois semaines de prison sont devenues six, puis neuf semaines. Durant lesquelles j’ai eu l’insigne honneur de recevoir le traitement du docteur McGuire, psychiatre renommé. Il était convaincu que j’appartenais à la catégorie des maniaco-dépressifs. J’ai accepté de prendre un médicament qui devait avoir un effet sur ce désordre du comportement. Son effet principal s’est révélé en une semaine, je perdais mes cheveux par paquets. Chaque fois que je me lavais la tête, ils me restaient entre les mains. C’était effrayant comme sensation. On aurait dit que je suivais une chimiothérapie.
Et je devais tenir deux semaines encore, malgré les effets de cette drogue qui me perturbait considérablement. Plus mes cheveux tombaient vite, plus le temps passait lentement.
J’ai toujours eu une excellente mémoire, la capacité d’organiser énormément de choses dans ma tête. Ma mémoire aussi s’en allait. Le plus pénible était de commencer à faire quelque chose, puis au beau milieu de me retrouver complètement perdue, l’esprit vide, tout idée effacée de mon cerveau.
Ensuite, il fut décidé que je devais passer entre les mains du docteur Copeland, celui que nous attendions, David et moi. Il avait enfin pu se rendre disponible pour un rendez-vous en prison. Il acceptait de m’intégrer dans son programme de réhabilitation.
David ne pouvait pas assister à ce rendez-vous, il avait envoyé à sa place un de ses collaborateurs. J’attendais avec lui, dans la salle des avocats de la prison, de rencontrer ce docteur Copeland.
Il a posé une première condition, il acceptait de me prendre dans son programme à la condition expresse que je n’aie plus aucun contact avec mes enfants pendant dix mois. Aucun contact, c’est-à-dire pas d’appels téléphoniques, pas de cartes postales ou de lettres, pas de nouvelles du tout.
J’étais pétrifiée. Ensuite il m’a expliqué que la grande majorité des délinquants sexuels dont il s’occupait étaient des violeurs, des pères de famille incestueux envers leurs filles.
Je lui ai demandé immédiatement :
- Bon, dites-moi combien de ces pères violeurs ont accouché d’une fille ? Vous en avez combien dans ma situation ?
Il ne m’a pas répondu.
Je lui ai dit que j’acceptais ses conditions concernant l’interdiction de voir mes enfants, mais je voulais que sur le délai de six mois il prenne en compte la longue période pendant laquelle nous avions déjà été séparés et n’avions plus eu aucune vie de famille.
Il a refusé, froidement. Et il a ajouté, pour faire bonne mesure, que je devais également m’engager à ne pas parler de ce programme aux médias ni à qui que ce soit d’autre. On voulait encore me museler, me priver de mes droits constitutionnels.
En regagnant ma cellule, j’ai su que je ne pourrais pas supporter ce programme de réhabilitation pour délinquants sexuels. Il ne me concernait pas. Je n’étais pas une délinquante, je n’avais violé personne, et je n’avais pas besoin de leur réhabilitation.
Les gens qui organisaient ce genre de choses, l’Etat lui-même, ne voulaient pas comprendre ce qui s’était passé entre Vili et moi. Ils étaient incapables de faire la différence entre un violeur patenté et moi. Je n’entrais pas dans les catégories dont ils s’occupaient, ils n’y trouveraient jamais ma place, puisqu’elle n’existait pas.
Je me réconciliais peu à peu avec l’idée qu’il vaudrait peut-être mieux passer sept ans et demi en prison (c’était la peine que je risquais), plutôt que d’essayer de convaincre la société qu’il s’agissait pour nous d’amour, rien que d’amour. Rien à voir avec la définition de l’abus sexuel !
Plus tard, le remplaçant de David m’a apporté en prison une lettre dans laquelle David me recommandait de me conformer à la loi et de suivre le programme. J’étais tellement en colère que je lui ai dit en face :
- Je me fous de ce genre de loi, je vais même la combattre à partir de maintenant !
Je lui ai tourné le dos et je suis partie, en le plantant là, bouche bée.
Oh oui, j’allais me battre contre ça, depuis ma cellule de prison s’il le fallait !
Je voyais clair à présent. La loi voulait me faire passer pour folle, la loi m’avait séparée de mes enfants, et ça, c’était le pire des abus. »
On voit les malentendus intenables auxquels conduit ce type de défense. La première contrepartie au fait de se déclarer malade est de perdre le droit à la parole, à s’expliquer, ou presque. C’est là un grave paradoxe parfaitement mis à nu par Althusser dans L’Avenir dure longtemps, quand il revient sur le non-lieu dont il a « bénéficié » après le meurtre de sa femme. Il s’agit ici du droit français et non américain, et qui concerne un cas de figure très différent de celui qui nous occupe. Dans le cas d’Althusser, il y a réellement eu une crise de folie extrêmement grave dont il s’est très difficilement et très lentement remis, et il s’agissait d’une affaire de meurtre. Néanmoins, la radicalité de son « cas » lui permet d’aller au fond du problème, problème concernant également deux systèmes juridiques aussi différents que le droit français et le droit anglo-saxon. Il raconte comment il a échappé à la comparution devant la cour d’assise, et les graves conséquences qui s’en sont suivies :
« Gravement atteint (confusion mentale, délire onirique), j’étais hors d’état de soutenir la comparution devant une instance publique ; le juge d’instruction qui me visita ne put tirer de moi une parole. De surcroît, placé d’office et mis sous tutelle par un décret de police, je ne disposais plus de la liberté ni de mes droits civiques. Privés de tout choix, j’étais en fait engagé dans une procédure officielle que je ne pouvais éluder, à laquelle je ne pouvais que me soumettre.
Cette procédure comporte ses avantages évidents : elle protège le prévenu jugé non responsable de ses actes. Mais elle dissimule aussi de redoutables inconvénients, qui sont moins connus.
… Quand je parle d’épreuves, je parle non seulement de ce que j’ai vécu de mon internement, mais de ce que je vis depuis lors, et aussi, je le vois bien, de ce que je suis condamné à vivre jusqu’au terme de mes jours si je n’interviens pas personnellement et publiquement pour faire entendre mon propre témoignage. Tant de personnes dans les meilleurs et les pires sentiments ont jusqu’ici pris le risque de parler ou de se taire à ma place ! Le destin du non-lieu, c’est en effet la pierre tombale du silence.
Cette ordonnance de non-lieu qui a été prononcée en ma faveur en février 1981 se résume en effet dans le fameux article 64 du Code de procédure pénale, en sa version de 1838 : article toujours en vigueur malgré les trente-deux tentatives de réforme qui n’ont pu aboutir. Il y a quatre ans, sous le gouvernement Mauroy, une commission s’est de nouveau saisie de cette délicate question, qui met en cause tout un appareil de pouvoirs administratifs, judiciaires et pénaux unis au savoir, aux pratiques et à l’idéologie psychiatrique de l’internement. Cette commission ne se réunit plus. Apparemment, elle n’a pas trouvé mieux.
Le Code pénal oppose en effet depuis 1838 l’état de non-responsabilité d’un criminel ayant perpétré son acte en état de « démence » ou « sous la contrainte » à l’état de responsabilité pur et simple reconnu à tout homme dit « normal ».
L’état de responsabilité ouvre la voie à la procédure classique : comparution devant une cour d’assises, débat public où s’affrontent les interventions du Ministère public qui parle au nom des intérêts de la société, témoins, avocats de la défense et de la partie civile qui s’expriment publiquement et du prévenu qui présente lui-même son interprétation personnelle des faits. Toute cette procédure marquée par la publicité se clôt par la délibération secrète des jurés qui se prononcent publiquement soit pour l’acquittement, soit pour une peine d’emprisonnement, où le criminel reconnu tel est frappé d’une peine de prison définie, où il est « censé » payer sa dette à la société et donc se « laver » de son crime.
L’état de non-responsabilité juridico-légale, en revanche, coupe court à la procédure de comparution publique et contradictoire en cour d’assises. Elle voue préalablement et directement le meurtrier à l’internement dans un hôpital psychiatrique. Le criminel est alors lui aussi « mis hors d’état de nuire » à la société, mais pour un temps indéterminé, et il est censé recevoir les soins psychiatriques que requiert son état de « malade mental ».
Si le meurtrier est acquitté après son procès public, il peut rentrer chez lui la tête haute (en principe du moins : car l’opinion peut s’indigner de le voir acquitté, et peut le lui faire sentir. Il se trouve toujours des voix averties dans ce genre de scandale pour prendre le relais de la mauvaise conscience publique).
S’il est condamné à l’emprisonnement ou à l’internement psychiatrique, le criminel ou le meurtrier disparaît de la vie sociale : pour un temps défini par la loi dans le cas d’emprisonnement (que des réductions de peine peuvent raccourcir) ; pour un temps indéfini dans le cas de l’internement psychiatrique, avec cette circonstance aggravante : considéré comme privé de son jugement sain et donc de sa liberté de décider, le meurtrier interné peut perdre la personnalité juridique, déléguée par le préfet à un « tuteur » (homme de loi), qui possède sa signature et agit en son nom et place – alors qu’un autre condamné ne la perd qu’en « matière criminelle ».
C’est parce que le meurtrier ou le criminel est considéré comme dangereux, tant à son égard (suicide) qu’à celui de la société (récidive), qu’il est mis hors d’état de nuire par l’enfermement soit carcéral, soit psychiatrique. Pour faire le point, notons que nombre d’hôpitaux psychiatriques sont encore restés, malgré des progrès récents, des sortes de prisons, et qu’il y existe même pour malades « dangereux » (agités et violents) des services de sécurité ou de force dont les profonds fossés et barbelés, les camisoles de force physiques ou « chimiques » rappellent de mauvais souvenirs. Les services de force sont souvent pires que nombre de prisons.
Incarcération d’un côté, internement de l’autre : on ne s’étonnera pas de voir ce rapprochement de condition induire dans l’opinion commune, qui n’est pas éclairée, une sorte d’assimilation. De toute façon, l’incarcération ou l’internement demeure la sanction normale du meurtre. Hormis les cas d’urgences, dits aigus, qui ne font pas question, l’hospitalisation ne va pas sans dommage, tant sur le patient, qu’elle transforme souvent en chronique, que sur le médecin, contraint lui aussi de vivre dans un monde clos où il est censé tout « supposé savoir » sur les patient et qui vit souvent dans un tête-à-tête angoissant avec le malade qu’il maîtrise trop souvent par une insensibilité d’affectation et une agressivité accrue. »
De plus, alors que « l’idéologie de la « dette », et de la « dette acquittée » à la société, joue malgré tout en faveur du condamné qui a purgé sa peine et, dans une certaine mesure, protège même le criminel libéré…, il n’en va pas du tout de même dans le cas du « fou » meurtrier. Quand on l’interne, c’est évidemment sans limite de temps prévisible, même si l’on sait ou devrait savoir qu’en principe tout état aigu est transitoire. Mais il est vrai que les médecins sont le plus souvent, sinon toujours, bien incapables, même pour les aigus, de fixer un délai même approximatif pour un pronostic de guérison. Mieux, le « diagnostic » initialement arrêté ne cesse de varier, car en psychiatrie il n’est de diagnostic qu’évolutif : c’est l’évolution de l’état du patient qui permet seule de le fixer, donc de le modifier. Et avec le diagnostic, de fixer et modifier bien entendu le traitement et les perspectives de pronostic.
Or, pour l’opinion commune, qu’une certaine presse cultive sans jamais distinguer la « folie » des états aigus mais passagers de la « maladie mentale », qui est un destin, le fou est tenu d’emblée pour un malade mental, et qui dit malade mental entend évidemment malade à vie, et, par voie de conséquence internable et interné à vie : « Lebenstodt » comme l’a si bien dit la presse allemande.
Tout le temps qu’il est interné, le malade mental, sauf s’il parvient à se tuer, continue évidement de vivre, mais dans l’isolement et le silence de l’asile. Sous sa pierre tombale, il est comme mort pour ceux qui ne le visitent pas, mais qui le visite ? Mais comme il n’est pas réellement mort, comme on n’a pas, s’il est connu, annoncé sa mort (la mort des inconnus ne compte pas), il devient lentement comme une sorte de mort-vivant, ou plutôt, ni mort ni vivant, et ne pouvant donner signe de vie, sauf à des proches ou à ceux qui se soucis de lui (cas rarissime, combien d’internés ne reçoivent pratiquement jamais de visites – je l’ai constaté de mes yeux et à Sainte-Anne et ailleurs !), ne pouvant de surcroît s’exprimer publiquement au-dehors, il figure en fait, je risque le terme, sous la rubrique des sinistres bilans de toutes les guerres et de toutes les catastrophes du monde : le bilan des disparus.
…
Il faut enfin en venir à ce point étrangement paradoxal. L’homme qu’on accuse d’un crime et qui ne bénéficie pas d’un non-lieu a certes dû subir la dure épreuve de la comparution publique devant une cour d’assises. Mais, du moins, tout y devient matière à accusation, défense et explications personnelles publiques. Dans cette procédure « contradictoire », le meurtrier accusé a du moins la possibilité reconnue par la loi, de pouvoir compter sur des témoignages publics, sur les plaidoiries publiques de ses défenseurs, et sur les attendus publics de l’accusation ; et par-dessus tout il a le droit et le privilège sans prix de s’exprimer et s’expliquer publiquement en son nom et en personne, sur sa vie, son meurtre et son avenir. Qu’il soit condamné ou acquitté, il a du moins pu s’expliquer lui-même publiquement, et la presse est tenue, du moins en conscience, de reproduire publiquement ses explications et la conclusion du procès qui clôt légalement et publiquement l’affaire. S’il se juge injustement condamné, le meurtrier peut clamer son innocence, et l’on sait que cette clameur publique a fini, et dans des cas très importants, par emporter la reprise du procès et l’acquittement du prévenu. Des comités peuvent publiquement prendre sa défense. Par tous ces biais, il n’est ni seul ni sans recours publics : c’est l’institution de la publicité des procédures et débats que le légiste italien Beccaria, au XVIIIème siècle, considérait déjà, et Kant après lui, comme la garantie suprême pour tout inculpé.
Or, je regrette, ce n’est pas exactement le cas d’un meurtrier bénéficiant d’un non-lieu. Deux circonstances, inscrites avec la dernière rigueur dans le fait et le droit de la procédure, lui interdisent tout droit à une explication publique. L’internement et l’annulation corrélative de sa personnalité juridique d’une part et le secret médical d’autre part. » (36-43)
Malgré l’extrême différence des circonstances, on voit bien qu’on touche là à ce à quoi Marie Kay a été confrontée : l’impossibilité de se défendre réellement, c’est-à-dire publiquement. Impossibilité pour elle, en tant que « malade mentale » ; impossibilité pour Vili Fualaau également, en tant que « victime mineure ». D’ailleurs, l’attitude de l’opinion publique aux Etats-Unis a parfaitement reflété cette impasse duale. D’un côté, il y avait les plus conservateurs – appelons ça « la droite » – qui envisageaient Marie Kay comme une criminelle qu’il fallait enfermer, de l’autre, les plus libéraux – appelons ça « la gauche » – qui l’envisageaient comme une malade mentale qu’il fallait soigner et protéger d’elle-même. Deux modes de recouvrement de la situation d’amour tout aussi stupides et brutaux, absurdes et arrogants, l’un que l’autre ; deux orientations aussi oppressives l’une que l’autre. A tout prendre, sans doute valait-il mieux pour cette femme d’être prise pour une « criminelle » et avoir de ce fait le droit de s’expliquer et de se défendre publiquement. Telle était bien son intention au moment du deuxième procès, qui se révèle malheureusement avoir été le plus terrible des procès, à cause de la lâcheté désastreuse de son lamentable avocat. Après avoir été relâchée suite au premier procès, elle a évidemment immédiatement désobéit à la règle de cesser de voir Vili, et fût bientôt prise en « flagrant délit » par la police. Le jour du deuxième procès :
Marie : « Deux autres gardes viennent enfin me chercher pour m’escorter jusqu’à la salle d’audience, un homme et une femme. L’heure de mon entrée en scène a sonné.
Tandis que nous descendons par l’ascenseur dans la cour spéciale du quatrième étage, l’un des gardes plaisante, plus amical qu’hostile :
- Alors, Mary, c’est encore toi la star aujourd’hui !
Le parcours se termine en silence. Mais les portes du couloir sont à peine entrouvertes, que déjà j’entends crier : « la voilà… la voilà… »
Je me suis préparée mentalement à l’assaut des médias. Je savais que les journalistes seraient présents au moment de l’audience, mais ça… ça… rien n’aurait pu m’y préparer.
Aussi loin que porte mon regard, tout le long du couloir vers la salle d’audience, des douzaines, peut-être des centaines de représentants des médias. Des caméras de télévision perchées sur des épaules, des reporters en rangs serrés brandissant des appareils photos et encore des caméras qui tournent, cliquettes, des flashes dans tous les sens. Une galerie de visages surexcités, toute la panoplie des présentateurs de télévision est là, regards inquisiteurs, une véritable armée qui tente de passer de force entre les gardes et moi. Ils sont vraiment tous là, à débiter leurs ragots sans fin, leurs questions stupides, uniquement préoccupés de sourire, toutes dents dehors, dans l’espoir d’obtenir une réponse. Je vis un vrai cauchemar. Je voudrais me glisser rapidement au travers de cette marée humaine, me faufiler dans la salle d’audience avant que ma maigre escorte et moi-même ne nous retrouvions submergées par l’océan des journalistes. D’où sortent-ils ? On dirait que tous les journalistes d’Amériques se sont donné rendez-vous à la même porte. Je me demande s’ils sont aussi nombreux pour les affaires de meurtre. Ont-ils seulement conscience de ce qu’ils font ? Et ces photographes qui se contorsionnent pour une malheureuse photo ! Il y en a même un allongé par terre, à mes genoux, qui me mitraille depuis le sol. Les moteurs des caméras bourdonnent à mes oreilles, je perçois le grésillement des flashes dans mon dos. Pensent-ils réellement tirer quelque chose d’une photographie de ma nuque ? !
Je lance un coup de pied à celui qui se traîne à mes genoux, une bonne ruade. Il ne semble même pas y prêter attention, et continue à prendre ses clichés comme un robot. Je finis malgré tout par sourire, car en dépit des bousculades, des cris et des questions, je réalise l’absurdité totale du comportement de ces gens. Une meute désordonnée. Aucun sens commun. S’ils reculaient un peu, de manière à nous laisser un passage décent, s’ils posaient au moins leurs questions l’un après l’autre, je pourrai m’arrêter et leur parler. Mais devant ça… Impossible !
J’aimerais bien les questionner moi aussi. « Qui êtes-vous ? D’où venez-vous ? Que faites-vous là ? Pensez-vous rendre service à la société ? Est-ce cela que vous appelez du journalisme ? » Je voudrais aussi leur demander pourquoi ils n’ont pas désigné d’avance un photographe et un cameraman de télévision pour filmer toute la séquence. S’ils sont réellement obligés de couvrir l’événement, ils n’ont qu’à se mettre d’accord, et se partager les images ensuite. De cette façon ils auraient au moins obtenus des clichés convenables. Je songe aux centaines de rouleaux de pellicules tournant en même temps, aux kilomètres de prises de vue gâchées. Nous n’avançons presque plus. Soudain je me sens prise à bras-le-corps, coincée par les épaules comme un pantin, et presque transportée par les deux gardes qui serrent les rangs autour de moi. Solidaires dans la tourmente.
L’homme, plus grand et plus musclé, me prévient :
- Ne t’écarte pas de nous, Mary.
Je suis bien heureuse qu’il réussisse à nous frayer un chemin dans cette foule opaque. Nous nous heurtons ensemble aux portes de la salle d’audience, elles s’ouvrent soudainement, et nous nous retrouvons littéralement catapultés à l’intérieur.
Elles se referment derrière nous dans un claquement sec. Me voici brutalement isolée, dans un autre monde. Comme si je passais d’une émeute en place publique à la rigueur d’une église.
La salle est fraîche, l’atmosphère presque glaciale. Le silence règne, pas un bruit, et la vingtaine de personnes présentes, avocats, huissiers, fonctionnaires, quelques journalistes et membres du public, demeurent parfaitement immobiles, le regard braqué dans ma direction. Je me sens assez ridicule, insecte bizarre plaqué contre la porte, dans cet uniforme rouge vif qui ressemble plus à un pyjama qu’à un vêtement. Comme une intruse, j’ai presque envie de lever les bras pour m’excuser du dérangement, et de dire à ces gens que je me suis trompée d’endroit. Ce formalisme glacial m’est toujours étranger.
J’aimerai bien surprendre ces visages durs et impassibles, déconcerter tous ces gens en costumes sombres qui déjà me condamnent. Il y a une caméra de télévision non loin de moi, ils veulent filmer le spectacle jusqu’au bout, regarder s’effondrer la bête, l’horrible femme qu’ils cherchent à crucifier. J’ai du mal à tenir mes mains tranquilles. Refuge de mon angoisse, elles tremblent sur la table devant moi.
Encore suffoquée par le contact de la foule, je refais lentement surface et commence à reconnaître certains visages. Mon avocat David Gehrke, des amis, un ou deux psychologues, et même le procureur Lisa Johnson.
David Gehrke s’est occupé de mon cas par hasard. Peu de temps après ma première arrestation, on m’a dit que j’aurais besoin d’un avocat. Mais je n’en avais pas. Un ami m’a parlé de David et de sa famille qui habitaient dans le voisinage. Je me suis souvenue de sa femme Suzan et de leurs deux enfants, à peu près du même âge que les miens. Nous avions partagé quelques goûters d’anniversaire, des randonnées scolaires, je savais que Suzan était également institutrice. Mais j’ignorais à quoi ressemblait David.
…
Nous nous sommes revus hier au soir, pour discuter des événements d’aujourd’hui.
- Ne vous inquiétez pas, Mary, j’ai beaucoup à dire.
David est maintenant confronté à la situation la plus énorme de sa carrière d’avocat. Exposé aux médias, contraint aux interviews et aux débats télévisés. Cette affaire est aussi importante pour moi que pour lui.
Beaucoup à dire, affirme-t-il. Bien sûr, mais au fond de mon cœur, je souhaite qu’il dise les choses que je voudrais dire moi-même. Je lui ai demandé de rester ferme cette fois, de donner à la cour ma version des faits. La dernière fois nous nous sommes montrés conciliants, doux comme des agneaux, voire repentants. Devant le juge, j’ai dû prononcer des mots tels que « Je suis désolée », « Je m’excuse », « J’ai besoin d’aide ». Tout cela pour apaiser la cour et obtenir sa clémence. Aujourd’hui je ne souhaite apaiser personne, je veux simplement être franche et dire la vérité. J’en ai besoin comme de boire à une source.
David m’a expliqué que la procédure durerait environ trois quarts d’heure, peut-être une heure. Mais nous sommes là depuis deux heures, et le procureur, une femme, n’a pas encore fini d’établir ses accusations : à l’entendre, je suis une inconsciente, une menteuse, en qui on ne peut avoir confiance, puisque j’ai ouvertement méprisé la cour, le juge, la société, la communauté, écarts éminemment prévisibles selon elle. Je suis un danger public.
J’ai compris, depuis le début déjà, que cela n’était pas la justice, mais la justification de la justice par elle-même, et celle des politiques qui la font. Si je veux connaître la justice, il faudra m’y prendre autrement.
Alors que défilent les témoins de l’accusation – l’officier de police qui nous a découverts dans la voiture, l’officier de probation, le psychiatre désigné par la cour, et même le procureur Lisa Johnson, j’attends stoïquement, les mains jointes pour garder mon calme.
David se lève enfin.
- Il est difficile pour moi d’être ici, Votre Honneur. Je sais que je vous ai déçue, et que j’ai déçu Mary… Je suis un ami de Mary, et aussi son avocat. J’essaie également de prendre en compte les intérêts des enfants directement concernés par cette affaire. Je parlerai d’eux brièvement tout à l’heure…
David parle longuement de loyauté, de sérénité, de la difficulté d’être juge, et de celle de comprendre ce qui s’est passé. Et combien il est difficile de prendre la décision d’enfermer quelqu’un pour sept ans et demi, de le séparer de son enfant… Il évoque même le jugement de Salomon.
- Vous avez pris la bonne décision le 14 novembre dernier, Votre Honneur… mais…
Et il enchaîne en rappelant que tous ceux qui ont critiqué alors la décision du juge étaient dans l’ignorance des faits, ou avaient le cœur trop dur. Mais pas le juge qui m’a honorée de six mois de prison, d’un traitement psychiatrique et d’une liberté sur parole.
- Nous avons tous reconnus que Mary était malade et qu’elle avait besoin d’aide.
Malade. Chaque fois qu’il use de cet argument pour ma défense, mon cœur se remplit de colère. David n’a pas trouvé d’autre moyen légal pour assurer ma défense.
Il n’en finit pas d’apaiser la cour, de dire qu’il est désolé que sa cliente ait méprisé les règles et les lois fondamentales de notre pays. Et la liberté de chaque individu de disposer de lui-même ?
J’attends qu’il arrête de jouer ce jeu, j’espère qu’il va enfin parler de moi, de ce que je pense et ressens, qu’il ne va pas trahir ma confiance. Mais rien… Je crois comprendre à présent où il voulait en venir, et ma gorge se noue. Il ne va pas le dire. Il n’osera pas. Je voudrais pouvoir le tirer par la manche, pour qu’il arrête de parler, et lui demander : « David, que signifie ce discours ? Vous parlez en mon nom ou au vôtre ? Vous me défendez, ou cherchez-vous seulement à briller aux yeux de vos collègues ? »
Il est là, en train de raconter à tout le monde à quel point je suis malade, il retombe dans le même piège trop simple, pour arriver à la même solution trop bête :
- Mary est malade, qu’on la fasse soigner, il lui faut un traitement plus long.
Je ne m’attendais pas à ce qu’il ait de nouveau recours à ce genre d’argument. Je commence à être en colère. Je ne crois pas à ce discours. Je voudrais pouvoir me lever pour parler et me défendre moi-même. Tout cela ne sert à rien. Mon avocat retombe dans la même chausse-trappe que la première fois, l’alternative étant : « Ou vous faites soigner Mary, ou vous la mettez en prison. »
Personne ne peut et ne veut envisager d’autre solution ? J’ai besoin d’être soignée, de suivre un programme sérieux, d’avaler des pilules ou je ne sais quoi, de raconter ma vie au psychiatre ! Parce que je suis amoureuse ?
Il ne veut pas leur dire. Le mot amour dans cette histoire leur fait tellement peur. L’admettre serait si simple. Mais la passion dérange. Ce consensus entre la défense et l’accusation pour me considérer non comme une femme passionnée mais comme une malade mentale, pour éviter la vérité à tout prix, me donne la nausée. David continue son laïus. C’est sans espoir.
- Votre Honneur, nous avons des destins d’enfants dont vous devez maintenant tenir compte. Et de nouveau la tâche n’est pas facile pour vous. Il y a ce jeune garçon, qui sera déçu de la sentence, qui risque peut-être de devenir suicidaire, qui se sent responsable aujourd’hui, comme hier. Sa vie a été complètement bouleversée, il s’est retrouvé l’otage des chaînes de télévision, exposé au ridicule, jeté hors de son école… Il y a cette petite fille qui a besoin d’une mère… et enfin les autres enfants de Mary…
Vili n’est l’otage de personne, à part des décisions de justice qui nous empêchent de nous voir. Il se moque pas mal des reportages à la télévision, il est bien capable d’envoyer promener qui il veut quand il veut.
- Le paradoxe, Votre Honneur, est que pour protéger ce jeune garçon, il faille mettre Mary en prison. Ce qui le déprimera davantage, causera encore plus de dégâts, avec des conséquences plus graves. La société n’a pas besoin de se protéger de Mary Letourneau. Son obsession n’est dirigée que vers une seule personne. La seule qui ait besoin d’être protégée de Mary Letourneau, c’est Mary Letourneau ! Il faut la protéger d’elle-même, et l’enfermer n’est pas la solution pour y parvenir. Elle est déjà sous surveillance par crainte de suicide, Votre Honneur… La justice… si difficile à rendre…
La justice ! Elle est absente de cette cour. D’amour et de liberté il n’est jamais question. Tout ce beau discours mériterait que je me lève pour applaudir. Ou alors que je demande à la cour de l’oublier complètement. Il ne me concerne pas. Ce ne sont pas les mots que je voulais entendre. J’ai écouté le long monologue de mon avocat, il a même su se montrer émouvant parfois, mais il n’a pas dit à la cour ce que je voulais qu’elle sache.
Soudain, c’est à moi que le juge s’adresse :
- Madame Letourneau, avez-vous quelque chose à ajouter ?
Je regarde David, l’œil féroce. Il avait affirmé que je n’aurais pas à prendre la parole aujourd’hui. Qu’il ne s’agissait que d’une formalité ! Quelle infamie ! Il savait que je voulais m’exprimer, que je voulais crier enfin à la face du monde ma version de l’histoire, et hier il m’a convaincue du contraire.
- On ne vous laissera pas parler, Mary.
Il m’a trompée. Il regarde ailleurs, en rangeant son paquet de dossiers.
Et moi, je regarde le juge, désespérée, le suppliant des yeux, essayant de lui faire comprendre que j’aurais moi aussi des choses à dire, tant de choses que je suis prise au dépourvu. Je voudrais ouvrir la bouche, me défendre seule, hurler la vérité.
Au lieu de cela, je baisse la tête. Il est trop tard, je ne m’y suis pas préparée…
La sentence tombe, elle était prévisible. Sept ans et demi de prison.
En entendant le juge Lau, une femme, prononcer la phrase qui me condamne, je ressens presque du soulagement, un poids de moins sur les épaules. Au moins n’aurai-je plus à subir l’humiliation du programme de soutien psychologique. Me voilà libre de me battre pour gagner ma cause.
On vient de m’infliger sept ans et demi de prison, et pourtant ma tête est plus légère, à la limite de l’euphorie. Les menottes se referment sur mes poignets, sans que je m’en rende vraiment compte. Je dois avoir l’air égaré. J’entends à peine les paroles de réconfort que l’on chuchote autour de moi. Je veux sortir d’ici, de cette cour, retourner en prison, au fond de ma cellule, d’où je pourrai vraiment entamer le combat vers la liberté, et la reconnaissance de la vérité. Je veux retrouver ma dignité d’être humain.
Au moins ne suis-je plus la fausse malade qui avait soi-disant besoin d’aide, et suppliait un juge de lui pardonner ce dont elle se sent fière au contraire. Ils ont abattu leurs cartes, cette femme amoureuse est une criminelle et une violeuse. Ils ont eu ce qu’ils voulaient.
Au dehors, la presse se rue sur moi. Cette fois le délire est à son comble.
« Mary, par ici, Mary, par là… Comment vous sentez-vous ? Que pensez-vous ? Qu’allez-vous faire ? Que pensez-vous de … »
Des questions sans fin, hurlées de tous côtés, abrutissantes et braillées sur tous les tons. Ils imaginent que je vais m’arrêter pour leur faire un long discours ? Leur donner un compte rendu détaillé de mes émotions dans un couloir ? Ou bien leur faut-il simplement un résumé de quinze seconde pour le flash de midi ?
Je les vois défiler comme au ralenti, tous ces visages, ces bouches glapissantes, suppliantes, avides, souriantes, quémandeuses. Des chiens qui aboient après leur proie.
Nous sommes presque arrivés mes gardes et moi, nous atteignons enfin le refuge béni de l’ascenseur, lorsque le dernier reporter se dresse devant nous. C’est une femme. De toute évidence, elle ne travaille pas pour la télévision, son visage n’est pas maquillé, ses cheveux sont tirés en arrière et noués en queue de cheval. Elle tient son bloc devant elle, de manière agressive, presque comme une arme de défense. Ses mots me transpercent :
- Mary, est-ce que ça valait la peine ?
Je ne peux que lui sourire. Comme je voudrais arrêter le temps, et cette foule en furie, pour tout lui expliquer…
Peut-on respirer sans oxygène ? Peut-on vivre sans amour ?
Si seulement elle savait de quoi elle parle. » (32-40)
Tout ce qui est raconté ici est révoltant au dernier degré. D’abord, il y a l’absurdité prédatrice absolue du journalisme. La couverture publique du procès n’est d’aucune protection pour l’accusée, le harcèlement journalistique extérieur à la salle d’audience ayant pour principale fonction de recouvrir complètement la publicité du déroulement du procès lui-même. L’attitude de la « meute désordonnée » des journalistes avère la corruption totale de l’espace public, la vacuité du journalisme, l’imposture de l’espace médiatique. Mais le plus terrible est évidemment la monstrueuse veulerie de l’avocat de la défense, dont toute la plaidoirie n’est qu’une trahison ouverte de celle qu’il est supposé défendre. Avec un tel avocat, il n’y avait guère besoin d’accusateurs ! On a en quelque sorte avec lui la quintessence de l’humanisme dans toute son infamie ! Le lecteur sain d’esprit et pour qui l’amour est une chose qui compte n’a qu’une seule envie : l’étrangler une bonne fois ! Il a poussé la trahison jusqu’à annuler pour Marie ce qu’Althusser appelait à très juste titre « le droit et le privilège sans prix de s’exprimer et de s’expliquer publiquement en son nom et en personne » sur son amour pour Vili. La trahison est telle que l’accusée se trouve à la fin soulagée d’être déclarée coupable et condamnée en conséquence ! La prison vaut mille fois mieux que la « thérapie » car elle est au moins le lieu d’où il redevient possible pour elle de se battre au nom de la vérité. Et comme Althusser, elle le fera finalement publiquement en publiant un livre commun avec Vili (et Soona). D’où le sentiment paradoxal de liberté qui la saisit à l’issue du procès, malgré la lourde condamnation et la perspective de longues années d’enfermement. Du reste, à sa sortie de prison, elle s’est mariée avec Vili Fualaau, devenu entre-temps « majeur », et devint ainsi Mary Kay Fualaau.
« Le procès vient de se terminer. Le troupeau des médias, les histrions de la cour, tous ces gens qui ont toujours voulu me condamner peuvent rentrer chez eux. Sept ans et demi de prison m’attendent. Quatre-vingt-neuf mois, plus de dix mille jours. Une condamnation historique désormais, elle a fait le tour du monde. Le visage d’une femme amoureuse court la planète, sous des titres infamants : « Elle a recommencé ! »
J’ai quitté la salle d’audience avec soulagement, une curieuse sensation de liberté. C’est étrange, car je sors de là pour entrer en cellule, et pour longtemps, pourtant je me sens libérée. Libérée de mes fers. Du système qui m’a déjà contrainte à subir un traitement de redressement psychologique pour attentat à la pudeur et pour viol. Je ne suis plus obligée d’abandonner mes enfants, ou, du moins, je peux lutter pour les reprendre. J’ai retrouvé le droit à la liberté de parole. Alors, qui porte les fers ?
Je suis sorti du tribunal menottes aux mains, une fois de plus. J’ai marché lentement, avec assurance, laissé le temps aux caméras de filmer chacun de mes pas. C’est tellement nécessaire pour les journalistes, je fais partie de leur gagne-pain. Je leur sers de proie. Mais eux aussi devraient me servir. Je n’ai honte de rien, je revendique cette condamnation comme la plus stupide qui soit. Ce jugement comme le plus inique. M’écouteront-ils ?
Le besoin d’appeler mes enfants m’obsède en permanence, il faut que je leur explique ce qui se passe, qu’ils sachent que tout ira bien maintenant. Je veux faire avancer les choses dans la bonne direction, puisque je ne serai plus enfermée dans cette institution de fous. Dieu merci, j’en suis débarrassée.
J’entends encore vibrer dans ma tête chaque mot de leur rapport :
« Trois ans minimum de thérapie pour inadaptation sociale, mentale, et perversion sexuelle ».
Et ils n’ont cessé de faire référence à Vili, en qualité de « victime ». C’est surtout ce mot-là qui attise ma fureur contre ces gens. « Victime »…
Il tourne et tourne dans ma tête comme un vent de folie. La leur.
« Pourquoi lui fallait-il un garçon de cet âge ? Elle affirme qu’il est intellectuellement et moralement en avance. »
Ils n’ont jamais compris Vili. Ils ne l’ont jamais vu, jamais rencontré, encore moins écouté. Et ils prétendent juger nos relations. Je suis coupable d’attentat à la pudeur ? Depuis quand ?
La seule chose que je suis prête à accepter, c’est que nous avons eu des rapports sexuels, mais rapports sexuels ne signifie pas abus sexuels !
Ils n’ont cessé de dire qu’en ayant plaidé coupable je n’avais pas admis l’importance du concept d’abus sexuel. Ils ont raison dans un sens, et tort dans l’autre. Je n’ai pas admis ce concept, c’est vrai. Mais je vois bien la faille dans leur législation. C’est un strict point de droit qui veut établir que des relations sexuelles entre nous équivaudraient à un abus sexuel. Ils n’ont pas pris en compte un cas tel que le nôtre, où les deux parties sont consentantes. Et l’amour dans tout ça ? Ce mot-là, ils ne l’ont jamais pris en considération. Jamais. Et l’enfant que nous avons eu ? Notre petite Audrey est une enfant de l’amour. Ne le savent-ils pas ?
…
Dans cette prison je serai libre de vivre. Je sais que je ne peux pas sortir, que je ne peux pas dépasser les limites de la clôture, elle est haute et couronnée de fil barbelé, mais dans les lumières aveuglantes qui illuminent tout le secteur, j’entrevois la lueur de l’espoir.
…
Je ne cherchais pas à tomber enceinte, mais Dieu était avec moi. C’était à Madison Park, devant la mer, cette nuit d’hiver et d’étoiles filantes. Oh oui, c’est vrai, cet endroit n’est pas pour moi, mais maintenant je ne suis plus seule ! On ne pourra plus mettre ma détermination et ma volonté à l’épreuve ici, puisque je porte le deuxième enfant de Vili. Il naîtra en octobre.
J’ai passé un an et demi à résister, à me battre contre la violence d’un mari et la bêtise d’une société qui m’enferme et s’emprisonne elle-même dans ses propres lois.
Dieu m’accorde un peu de paix. Il est avec moi et Il n’est pas le seul, Vili aussi est avec moi.
Mais moi je suis en cellule comme une vulgaire criminelle. Je ne veux pas que mon enfant naisse en prison. Qui, à part Dieu, dois-je supplier pour que l’on m’aide ?
J’appartiens à une société protégée par des lois morales tellement rigides et si puissantes que nos droits civils ont été balayés sans scrupule. Ceux de Vili et les miens.
Aidez-nous. Nous avons pris, je le sais, un chemin différent des autres, le chemin le moins emprunté, mais nous ne sommes plus au Moyen-Âge, où l’on brûlait les femmes, les « pécheresses », les « sorcières », qui osaient aimer hors de leur mariage. Seigneur, j’ai obéi aux lois de ma religion, j’ai tout fait pour que l’erreur de ma première union ne se termine en désastre pour personne d’autre que moi. J’ai été assez punie.
L’amour ne connaît pas de lois. L’amour est arrivé dans ma vie comme la foudre, venu du cœur et du corps de ce jeune guerrier, de ce poète, mon âme sœur. Mon double. Pardonnez au moins, si vous ne comprenez pas.
Vili a quinze ans à présent, il est père, et personne ne veut toujours l’entendre. Je vous en prie : écoutez-le ! Il n’est pas une victime ! Je ne suis pas une criminelle.
Notre seul crime, c’est l’amour. » (293-297)
Pour télécharger le texte en pdf :