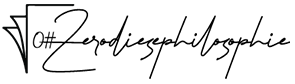Ecrit philosophique de Julien Machillot
Décembre 2019
Meetic et Metoo
Suite à l’apparition du mouvement #Metoo aux Etats-Unis, un vaste mouvement féministe multiforme d’opinion – #Balancetonporc, #Noustoutes, etc. – s’est installé en France, prenant la forme de ce que j’appellerai un exclusivisme idéologique terrorisant d’une rare violence. Il se présente d’un côté comme un mouvement de luttes contre les « violences sexuelles et sexistes faites aux femmes », mais aussi contre les « violences conjugales » et ce qui a été rebaptisé par le néologisme de « féminicides », et d’un autre côté comme une campagne de dénonciations publiques « systématiques » par les supposées femmes-victimes, de leurs supposés hommes-bourreaux, qui ont fait récemment pendant plusieurs semaines la « une » des grands médias. Concernant le deuxième pan de ce mouvement féministe, ces dénonciations sont en fait largement réservées – et, disons le tout de suite, c’est tant mieux ! – aux milieux bourgeois, en particulier au monde du cinéma, c’est-à-dire à des femmes ayant accès aux grands médias parce qu’elles sont déjà elles-mêmes des femmes publiques par la force de leur profession (actrices, journalistes…), dénonçant des hommes eux-mêmes en général publics et ayant d’une manière ou d’une autre des positions de pouvoir. La porosité inflammable de la situation idéologique française en regard d’un mouvement venu des Etats-Unis s’inscrit à mon sens (bien que ça n’explique rien) en ceci que ce mouvement a en quelque sorte pris le relais de l’ancienne campagne de criminalisation de la « pédophilie » qui faisait rage ici il y a une dizaine d’années (et qui tend à se réinscrire à l’intérieur des campagnes actuelles). Après les enfants, les femmes. Dans le grand naufrage du dit « patriarcat », les femmes et les enfants d’abord ! – où l’on peut goûter la tournure ironiquement paternaliste de la chose.
Par « exclusivisme idéologique terrorisant », j’entends une idéologie qui se présente comme exclusive de toute autre hypothèse possible. Donc : pour laquelle toute autre hypothèse ou opinion ne sera pas examinée à l’aune d’une argumentation rationnelle mais comme relevant de la dénonciation publique et de la condamnation morale car envisagée a priori comme étant nécessairement le fruit de la domination (en l’occurrence masculine) dans ce qu’elle a de plus barbare. Ce qui fonde son caractère franchement terrorisant, c’est que toute hypothèse est ainsi évaluée par cet exclusivisme à l’aune d’une cartographie identitaire de la situation : homme barbare, homme repenti, femme émancipée ou soumise, etc. Attitude qui plus est profondément inégalitaire puisque renvoyer toute idée ou opinion à son fondement identitaire supposé, cela revient à refuser de discuter et évaluer les idées en elles-mêmes sur un plan de stricte égalité avec les autres (et tout particulièrement, ici, avec les hommes) et à s’envisager soi-même de ce fait comme représentant de la supériorité identitaire de l’opinion qu’on soutient !
L’exclusivisme idéologique terrorisant de ce militantisme féministe consiste, en cela homogène à ce qu’a été l’ancienne campagne contre les pédophiles, à traiter l’ensemble des questions relatives à ce qu’on appellera de manière générique les « violences sexuelles » sur le plan univoque et autoritaire de la moralisation publique des mœurs prescrivant la criminalisation étatique des hommes. Encore une fois, une des choses qui m’a le plus frappé ces derniers temps, c’est qu’avant d’être (momentanément ?) éclipsées par l’actuelle grève massive contre la réforme des retraites, il ne se passait plus une semaine entière sans qu’une nouvelle dénonciation publique d’un homme par une femme vienne faire la « une » des grands médias et boucher le trou de l’invraisemblable vacuité journalistique des pseudo informations circulantes. Bien qu’on ne puisse pas tout à fait s’empêcher de se dire que tout compte fait c’est bien fait pour ces hommes, et bien qu’il y ait un fond parfaitement légitime derrière tout ça – le fait de se défendre contre des agressions tout de même ignobles – il y a quelque chose dans la tournure qu’ont prises les choses ces derniers temps qui me paraît tellement faux voire abject que je veux ici essayer de faire le point là-dessus.
D’abord, je pense qu’il y a quelque chose de profondément dégradé, pour ne pas dire de carrément pourri, dans le rapport des hommes et des femmes aujourd’hui. Je pense aussi et par conséquent que la question d’une transformation radicale positive du rapport des hommes et des femmes est une grande question de notre temps, et même une des questions les plus importantes, les plus cruciales concernant l’avenir de la figure de vie collective à laquelle les orientations prises aujourd’hui nous destinent. Par ailleurs, une telle transformation ne construira quelque chose de positif que si elle se place sous l’exigence d’un principe radical d’égalité stricte, réelle, vraie, des hommes et des femmes. Or ici les difficultés commencent, car la question de savoir ce que peut bien signifier une telle égalité réelle est aujourd’hui d’autant plus obscure qu’elle est à mille lieux d’être débattue publiquement, ou même d’être reconnue par les féministes comme une question sérieuse et même absolument centrale, méritant un vaste examen, et notamment des impostures qui se présentent comme incarnant son principe – par exemple ladite « parité » et plus généralement toute conception de l’égalité comme limitation.
Ce que portent ces mouvements féministes relève uniquement du registre d’un côté de la délation, dénonciation publique qui, livrée à elle-même de manière incontrôlée, ouvre tôt ou tard nécessairement à toutes les calomnies et aux rumeurs les plus infâmantes et de l’autre de la revendication des condamnations par la justice et des moyens de criminalisation par l’exécutif, le législatif étant sommé de faire de la notion de « victime » la catégorie juridique centrale de toute l’affaire (se souvenir sur ce point de la grande dérive sarkozyste de la justice comme « réparation aux victimes »). C’est ce que j’appellerai une forme de « moralisation-criminalisation ». Et c’est précisément cette forme qui représente à mon sens un véritable exclusivisme terrorisant. Pourquoi ? Pour les raisons que je viens de décrire évidemment, mais qui renvoient à quelque chose de plus fondamental : si on repart de la notion circulante ou générique de « violences sexuelles (et sexistes) », la « moralisation-criminalisation » consiste de manière très précise à envisager les rapports de la sexualité et de la violence comme se ramenant de manière exclusive à un pur rapport d’extériorité. Il y aurait d’un côté le fait universel normal et par lui-même pacifique de la sexualité, et de l’autre des méchants hommes qui livreraient la sexualité aux rapports de violence. L’enjeu serait donc de purifier la sexualité des scories de violence qui n’exprimeraient fondamentalement qu’une forme de codification des rapports de domination masculine imposés depuis des lustres par les hommes sur les femmes, et rendre ainsi aux femmes leur entière « liberté sexuelle ». Or, là où le bât blesse, c’est que bien que les violences dénoncées soient évidement de l’ordre des contingences empiriques, n’étant le fruit d’aucune nécessité d’essence, à un autre niveau, c’est la sexualité elle-même qui est violente. Autrement dit, il existe aussi un rapport intrinsèque ou immanent de la sexualité à la violence. On pourrait même dire, en prenant soin de ne pas s’enfoncer dans un inutile pathos, qu’il existe un « traumatisme » de l’être humain en tant qu’être sexué. « Traumatisme » devant être pris en son sens le plus sobre si je puis dire. Cela signifie simplement qu’il y a chez chacun une dimension immaîtrisable de la sexualité, « immaîtrisable » ne signifiant pas ici que nous serions nécessairement voués à devenir des gens malades ou des salauds, mais au sens où, pour le dire dans des termes lacaniens, il y a une dimension de réel de la sexualité qui ne se laisse jamais entièrement symboliser et donc pacifier par l’ordre symbolique, ceci non parce que cet ordre serait « patriarcal », mais parce qu’aucun ordre symbolique ne peut l’inscrire exhaustivement en son sein. S’il est bien vrai que beaucoup de gens vivent finalement assez tranquillement leur sexualité au long cours, et c’est tant mieux, la vérité est que c’est en définitive sans doute plutôt l’exception que la norme. La réalité absolument massive je crois, aussi bien chez les hommes que chez les femmes, je ne crois pas qu’il y ait de grandes différences de ce point de vue-là, si ce n’est peut-être dans les réponses précaires apportées pour stabiliser au mieux l’existence dans ces conditions, est que la sexualité encombre toujours la vie de manière parfaitement excessive, sans qu’on puisse y faire grand-chose. Or ce point-là, cette immanence de la violence à la sexualité, est précisément ce qui du rapport de notre humanité à la sexualité ne peut par définition pas être moralisé. Par définition, en effet, la morale n’envisage ces deux termes que sous l’angle contingent de leur extériorité empirique. Je dirai donc que de la même manière que l’ancienne campagne de criminalisation des pédophiles reposait entièrement sur la forclusion totale de l’existence de la sexualité infantile, les campagnes féministes actuelles reposent sur celle des rapports intrinsèques et immanents de la sexualité et de la violence. J’insiste sur le fait que c’est à un autre niveau que cette réalité se situe, car il ne s’agit en aucun cas de s’appuyer là-dessus pour justifier quelque violence empirique que ce soit. Mais c’est là une donnée fondamentale et absolument incontournable si on cherche à établir les conditions réelles d’une transformation positive possible du rapport des hommes et des femmes dans le monde actuel.
Il faut donc admettre ce point, et en tirer la conséquence qui s’impose, qui est qu’il faut condamner fermement ce mouvement de « moralisation-criminalisation » en affirmant que toutes ces questions doivent être traitées sur un tout autre plan. Quand je dis « condamner », ce n’est pas d’une condamnation morale qu’il s’agit, mais d’une condamnation strictement politique. Il ne s’agit pas de condamner une illusion ou une méchanceté. Le vice fondamental de ce mouvement général se situe en effet ailleurs. Car la dénégation morale de la violence intrinsèque de la sexualité travaille elle-même de fait du côté de son retour dans la violence physique extrinsèque. C’est là une loi qui se déduit de la dialectique du réel et du symbolique : dès qu’on cesse un instant de travailler à la symbolisation du réel insymbolisable, celui-ci s’impose dans la vie collective par effraction sous la forme de la violence la plus brutale et la plus à nu, sous cette forme de violence soustraite à toute subjectivation parce qu’elle cesse d’avoir besoin de raisons pour s’exercer, parce qu’elle cesse d’avoir pour condition le minimum de légitimité subjective qui accompagne les formes ordinaires d’agression et de violence entre les gens. La « moralisation-criminalisation » travaille à ce titre du côté d’une augmentation potentiellement exponentielle de la violence entre les hommes et les femmes – dans la mesure où elle travaille très activement à rendre toute discussion sérieuse impossible entre eux, la situation étant sur ce point franchement affolante – et non pas du côté de sa neutralisation. Cette violence brute se répand aujourd’hui largement, prenant la forme, à travers des violences verbales voire physiques, d’une séparation de type identitaire (les femmes contre les hommes, les hommes contre les femmes). En réalité, cette violence n’est réellement complètement à nu que dans ses formes les plus extrêmes, qui se répandent de manière tout à fait inquiétante dans la jeunesse, mais pas seulement. Dans sa forme générale, on a plutôt affaire à ce qu’on pourrait appeler des « subjectivités désubjectivées », ou des « légitimations insubjectivables », le caractère « désubjectivé » et « insubjectivable » signifiant simplement que c’est en dernière instance l’élément de force, de violence, ou encore de séparation, qui surdétermine les nouvelles formes de subjectivation du rapport entre les hommes et les femmes, faisant de ce rapport un dé-rapport, qui est très sensible jusque dans les discussions en apparence les plus intellectualisées, où ce qui prédomine est un rapport d’extériorité dénué de toute « amitié » véritable possible dans le traitement des questions discutées. La loi sous-jacente qui structure la situation actuelle est une loi de séparation, de type « les uns auront Sodome, les autres auront Gomorrhe ».
Du côté des hommes, l’exacerbation intolérable de la violence envers les femmes s’alimente de la désubjectivation sans recours des positions symboliques traditionnelles qui étaient celles des hommes pendant longtemps et par conséquent du statut central et dominant qu’ils tenaient dans les anciennes configurations de la vie collective, sans que rien des nouvelles coordonnées symboliques ouvre la voie à de nouvelles formes de subjectivation singulière à même de stabiliser le statut des hommes dans le nouveau contexte. Or cette difficulté réelle est elle-même violemment recouverte par le dogme de l’effacement de la différence symbolique des sexes, différence entièrement renvoyée du côté des illusions de la domination dite « patriarcale ». Mais il faut sur ce point souligner une chose : s’il est possible pour les femmes d’affirmer aujourd’hui qu’elles ne voient pas de différence pour elles entre être les femmes qu’elles sont et être les hommes qu’elles auraient pu être, cette possibilité n’est absolument par réversible pour les hommes. C’est là un noyau de subjectivation devenu dominant qui est nécessairement unilatéral, et ceci pour une raison somme toute très simple et compréhensible : d’un côté le progrès essentiel du côté des femmes est d’avoir pu conquérir depuis quelques décennies les positions qui étaient largement réservées aux hommes, à commencer par la généralisation du travail des femmes, mais aussi les positions de pouvoir et de puissance de toutes sortes ; de l’autre côté, il est difficile pour les hommes de désirer conquérir les positions qui étaient celles des femmes jusque-là, avec tout ce que cela suppose de réclusion de l’existence dans l’espace de la vie privée. Autrement dit, s’il y a bien un mouvement d’effacement conquérant et pour une très grande part positive et qu’on ne peut que saluer des frontières symboliques du côté des femmes, du côté des hommes en revanche cette nouveauté se donne essentiellement dans un mouvement de perte de l’exclusivité des positions symboliques traditionnelles sans que rien de l’ancienne situation des femmes ne soit réellement incorporable puisqu’entièrement envisagé sous le dogme de l’aliénation millénaire des femmes par les hommes, les tentatives d’incorporation en apparence louables de ce côté n’étant à mon avis que l’invention de nouvelles supercheries, telles que le formalisme du partage équitable des tâches et de l’éducation des enfants dans le couple, très à la mode chez les jeunes trentenaires notamment, et qui n’est là encore qu’un pur et simple recouvrement de la question de l’égalité réelle par une égalité toute formelle (pour reprendre des vieux termes marxistes) dont il n’y a rien d’autre à attendre que des catastrophes quant à ce que vont devenir les enfants ainsi placés au centre fondateur totalement exorbitant de l’équilibre des couples. Ceci étant établi, cela explique aussi pourquoi il y a un élément incontestable de déséquilibre des formes de violence provenant des hommes ou des femmes : la violence des hommes est beaucoup plus sujette à son enfoncement dans les formes extrêmes, absolument brutales parce qu’entièrement désymbolisées, puisque c’est précisément d’une défaillance symbolique du statut des hommes dans la vie collective qu’elles s’alimentent, et prenant, dans ses formes les plus nues, le caractère de « violences sexuelles », puisque le réel de l’immanence de la violence à la sexualité n’a plus aucun support symbolique sur lequel se pacifier et se stabiliser.
Du côté des femmes maintenant, car il y a une violence toute particulière des femmes massivement structurée et déployée par les campagnes féministes, la situation est un peu différente. En réalité, c’est une violence beaucoup plus subjectivable, précisément parce ce mouvement prend la forme, a minima, de campagnes d’opinion. Mais là aussi, on a affaire à une forme de « subjectivité désubjectivée » ou de « légitimation insubjectivable ». Pourquoi ? Pour en donner une caractérisation très générale, je dirai qu’on a affaire dans les campagnes féministes actuelles à un recouvrement de la question infinie de la justice au nom d’une conception « finitudinaire » de la justice. « Finitudinaire » (néologisme que je propose) : justice envisagée sous le signe de la finitude, entièrement circonscrite par le recours aux formes ordinaires de la justice étatique. Autrement dit la question de la justice est une vraie question, ceci d’autant plus que les misères que les hommes font parfois massivement subir aux femmes n’a strictement aucun équivalent du côté de ce que peuvent faire les femmes. Mais dans la manière dont les campagnes féministes actuelles traitent cette question de la justice, ce qui est perdu, c’est précisément l’Idée de justice. D’ailleurs, les récentes manifestations contre lesdites « féminicides » revendiquaient des « moyens » pour sauver les femmes, sans qu’ait été portée à aucun moment l’exigence d’une vaste délibération publique véritable portant sur l’idée même de justice. Ces manifestations ne faisaient par conséquent sur ce point pas autre chose que porter les idées archidominantes sur ces questions. C’est là s’enfoncer dans l’empirisme politique ambiant le plus mortifère. Or sur cette question de la justice, je pense qu’il faut absolument en revenir aux leçons des grecs. D’une part à la leçon de la tragédie grecque, d’autre part à la leçon de la philosophie platonicienne. La grande leçon de la tragédie grecque, notamment de l’Orestie d’Eschyle, c’est que la justice n’existe que dans sa rupture radicale d’avec le cycle des vengeances, des vendettas, c’est-à-dire par sa capacité à mettre définitivement fin au devenir infini des violences sanglantes, ou au moins d’y travailler activement en vue d’une paix nouvelle permettant de reconstruire la vie collective sur de nouvelles bases. La grande leçon de la philosophie de Platon, et notamment de la fameuse République, sans doute le plus grand best-seller de l’histoire de la philosophie, c’est que la justice relève de l’Idée et non pas de l’Etat, ce qui signifie aussi qu’elle relève de la pensée dans ce qu’elle a d’universalisable, et non pas de l’opinion dominante du moment articulée à l’institution judiciaire d’un régime politique particulier. Autrement dit la leçon de la tragédie grecque, au rebours de la criminalisation sans fin des particuliers ou même de leur criminalisation à des fins supposément dissuasives, place la justice sous l’orientation d’une paix universelle, tandis que la leçon platonicienne, au rebours de la moralisation à outrance des mœurs, dispose l’Idée de justice comme le lieu d’une capacité politique populaire et non étatique nouvelle. Or, le principal effet des campagnes féministes actuelles est de structurer massivement le rapport des femmes aux hommes comme un rapport de règlement de compte. C’est là la dimension insubjectivable de l’affaire : l’élévation du règlement de compte au rang de légitimité subjective adossée à l’Etat. C’est cela qui opère aujourd’hui la corruption subjective intolérable activement portée par le féminisme contemporain, dans la mesure où ce qu’il organise in fine est le recouvrement d’un enjeu politique crucial qui concerne prioritairement les femmes. Cet enjeu fondamental, c’est de constituer une capacité à faire face aux situations de violence masculine qui soit précisément porteuse d’une Idée neuve de la justice. C’est-à-dire qui fasse de la justice un nouveau lieu d’« idéation » (sur le terme d’idéation, lire le séminaire d’Alain Badiou : Pour aujourd’hui : Platon !). Un nouveau lieu d’idéation signifierait un nouveau lieu de subjectivation réelle : tout à la fois affirmative parce que soustraite au moralisme, et autonome parce que non dépendante de la médiation judiciaire et étatique au sens large. Plus précisément, la justice comme lieu d’idéation possible des femmes signifierait, au croisement de la double leçon grecque antique, la création d’une capacité collective populaire et non étatique des femmes (mais aussi avec les hommes) orientée par l’exigence de construction d’une paix universelle, ce qui veut dire – eu égard à l’absence cruelle de paix véritable gangrenant d’innombrables pans de la vie collective – une redistribution générale des rapports des hommes et des femmes à des fins de refondation radicale de la vie collective sur de nouvelles bases, plus justes pour tout le monde parce qu’égalitaires. Précisons que quand je dis « non étatique », cela signifie une subjectivité non adossée à l’Etat et non pas évidemment le renoncement total à aller devant la justice. Il s’agit plus précisément d’établir que dans une telle construction d’une capacité collective des femmes à faire face aux situations le recours à la condamnation par les tribunaux doit rester une médiation absolument seconde et non fondatrice de cette capacité. Cela suppose notamment d’un point de vue subjectif de rompre sans concession avec la catégorie de victime qui en tant que catégorie judiciarisée opère l’introduction dans le droit d’une zone d’indiscernabilité mortifère entre justice et vengeance dont le corollaire est la dépendance subjective totale à l’espace de l’Etat, de ses lois et de ses institutions.
Mais venons-en à un autre point essentiel. Encore une fois, c’est sur un tout autre plan que celui de la « moralisation-criminalisation » qu’il faut traiter l’ensemble des questions ayant trait aux violences dites « sexuelles » s’il est requis, comme je l’affirme fermement, qu’il est nécessaire de compter l’existence d’un plan d’immanence de la violence dans la sexualité comme réalité commune aux hommes et aux femmes quels qu’ils soient. Quel est donc le plan d’épreuve singulier qui soit à même de traiter en son fond l’existence des rapports aussi bien intrinsèques qu’extrinsèques de la sexualité et de la violence, capable de faire leur part à ces deux dimensions de choses relativement hétérogènes ? En vérité il n’y en a qu’un seul possible, c’est celui de l’amour. Et ceci pour une raison essentielle. L’amour vrai est toujours la construction d’une pensée à deux sur le monde, dans l’épreuve radicale de la différence des sexes, donc d’une pensée soustraite à la détermination identitaire et purement narcissique de l’un ou du moi. Ceci au point que la souffrance intime de la vie sans amour ne se résume pas à la souffrance subjective très particulière qui est l’effet d’un manque « sans objet », mais consiste plus profondément en ceci que l’existence n’a alors jamais de garantie réelle de ne pas être, fût-ce dans les pensées les plus hautes et les actes les plus exigeants, enfoncée dans le fourvoiement narcissique voire pathologique de qui n’utilise la médiation des principes que pour intensifier ses intérêts purement égoïstes. Autrement dit, la vie sans amour est nécessairement une vie sans garantie symbolique réelle – je veux dire « pour soi-même, à ses propres yeux » – que notre vie ne participe effectivement pas de la corruption du temps et des multiples et infiniment ingénieuses positions d’impostures qui permettent, s’agissant notamment des hommes, de vivre en ayant à la fois le beurre de la pseudo radicalité telle qu’elle s’articule dans la pensée dite « critique » avec l’argent du beurre d’une vie finalement tout à fait incorporée au monde tel qu’il est et parfaitement conforme à ce qui la conforme. Une telle garantie passe nécessairement par la médiation de l’autre, du regard de l’autre, mais de l’autre pris dans sa plus grande altérité, telle que seule l’Idée d’amour peut organiser l’épreuve durable de la compossibilité d’une vie entière en partage avec cet autre. En un mot, la vie sans amour est la vie dans laquelle rien ne nous protège vraiment de ne pas devenir, au mieux un pauvre fou, au pire un sinistre salaud, sans parler de la gamme infinie des médiocrités ordinaires distribuées entre ces deux extrémités. Ceci dit, cette garantie symbolique ou protection subjective dont je parle concerne l’amour vrai et non pas la vie de couple en général. Ici il faut discriminer sévèrement. Au vrai, il y a autant de vies sans amour dans les vies de couple que dans celles des célibataires. La vie de couple n’est pas un critère de l’existence de l’amour, parce que celui-ci est malheureusement lui aussi, comme tout ce qui concerne les choses cruciales de la vie humaine, le lieu de toutes les impostures et de tous les fourvoiements. A ce titre, il convient de compléter la généalogie des campagnes féministes actuelles. En dehors des campagnes contre la pédophilie, il y a eu l’apparition et le développement massif de tous les dispositifs de rencontre sur internet et les réseaux sociaux, dont le grand symbole il y a dix ans était le site Meetic (on est passé depuis de Meetic, dont le slogan était « Start Something Real » à AdopteUnMec, dont le slogan, significatif, est : « Le site de rencontre où les femmes prennent le pouvoir » !). Il faut voir Meetic et #Metoo comme les deux faces d’une même pièce, car relevant d’une même conception sécuritaire de l’amour et plus généralement des relations entre les hommes et les femmes. D’un côté « l’amour assurance tous risques », notamment pour les femmes, de l’autre la neutralisation par la morale et l’Etat de tous ceux qui continuent à représenter un risque, en particulier du côté des hommes. On a avec Metoo la clôture se refermant, la boucle entière du dispositif sécuritaire ouvert par Meetic. Metoo vient en quelque sorte acter dans le réel ce qu’Alain Badiou disait de manière quasi prophétique il y a dix ans à propos de Meetic : « Ajoutons tout de même que, le risque n’étant jamais éliminé pour de bon, la propagande de Meetic, comme celle des armées impériales, consiste à dire que le risque sera pour les autres ! Si vous êtes, vous, bien préparé pour l’amour, selon les canons du sécuritaire moderne, vous saurez, vous, envoyer promener l’autre, qui n’est pas conforme à votre confort. S’il souffre, c’est son affaire, n’est-ce pas ? Il n’est pas dans la modernité. De la même manière que « zéro mort », c’est pour les militaires occidentaux. Les bombes qu’ils déversent tuent quantité de gens qui ont le tort de vivre dessous. Mais ce sont des Afghans, des Palestiniens… Ils ne sont pas modernes non plus. L’amour sécuritaire, comme tout ce dont la norme est la sécurité, c’est l’absence de risque pour celui qui a une bonne assurance, une bonne armée, une bonne police, une bonne psychologie de la jouissance personnelle, et tout le risque pour celui en face de qui il se trouve. » (Alain Badiou avec Nicolas Truong : Eloge de l’amour.) Donc, Meetic a préparé et anticipé Metoo, le double dispositif assurant la séparation entre les civilisés inscrits en bonne et due forme sur les sites de rencontre et les barbares à qui il convient de faire publiquement la peau. Car avec Meetic d’un côté et Metoo de l’autre, ce qui disparaît, c’est l’amour. Car l’amour n’est ni l’amour assurance tous risques, l’amour sans amour, sans le hasard de la rencontre, ni le risque criminel ou l’aventurisme pervers. Meetic, Metoo et l’Amour sont sur un bateau. Meetic et Metoo jettent l’Amour à l’eau : la chasse à la baleine est ouverte.
Seul l’amour, l’amour vrai, peut être le lieu d’une maîtrise de l’élément sexuel immaîtrisable dans la mesure où lui seul peut l’inclure comme élément dans quelque chose de plus vaste le forçant ainsi à relativiser son incidence sur la subjectivité personnelle mais en le comptant comme un élément actif à part entière, ce qui n’est évidemment pas le cas pour les autres grandes figures de la pensée comme la science, l’art (encore que…), où la politique, qui n’ont que faire de la vie sexuelle ratée des pauvres animaux humains dans leur processus créatif propre. Pour le dire autrement, l’amour est le seul lieu où l’on puisse faire violence à la violence de la sexualité en la remettant en quelque sorte « à sa place », y compris en passant provisoirement s’il le faut par le fait de donner à la sexualité la place exorbitante qu’elle exige. Il ne s’agit pas du tout d’un processus pacifique car toutes les catégories de « satisfaction sexuelle individuelle » ou d’ « épanouissement sexuel dans le couple » ne sont que des calembredaines laissant croire, versant hédoniste du moralisme sécuritaire visant la violence extrinsèque de la sexualité, et l’hédonisme n’est jamais qu’une morale, qu’il serait possible de soustraire la sexualité à sa violence intrinsèque, ce qui n’est qu’une autre manière d’en forclore le réel. Tout le problème vient en fait ici de ce que, comme le disait Lacan, « il n’y a pas de rapport sexuel », ce qui n’est qu’une autre manière de dire qu’il y a une violence intrinsèque de la sexualité, concentrée dans la dimension toujours unilatérale de sa jouissance. Ce pourquoi l’amour n’est pas le lieu d’une pacification de la sexualité mais bien plutôt d’une violence à sa violence, l’amour étant le seul et unique lieu subjectif où la violence faite à la violence sexuelle immanente ne soit pas de l’ordre d’une répression strictement extérieure donc mortifère mais de l’ordre d’une violence intériorisable. Seulement, qu’est-ce qui fait que cette violence à la violence est intériorisable ? Qu’est-ce qui opère exactement dans l’amour ici ? C’est le fait que l’amour relève de la pensée. Mieux encore, c’est le fait que la pensée amoureuse est une pensée violente et dont la violence est à la mesure de sa radicalité. Et cette radicalité de la pensée est une violence de séparation d’avec l’ordre des choses. C’est là le point crucial : si « les amoureux sont seuls au monde », comme le dit à juste titre le poète, c’est d’abord et avant tout parce qu’il est une puissance de rupture tout à fait radicale et sans concession avec l’ordre des choses. Et si ce n’est pas le cas, c’est que ce n’est pas de l’amour, un point c’est tout, car ce qu’on appelle amour dans ce cas n’est rien d’autre que la vie de couple envisagée comme variable des modes de socialisation établis. Pour formaliser ce point décisif, on dira que l’amour est le lieu où la dialectique objective du réel et du symbolique décrite plus haut a chance de se réarticuler en dialectique subjective de la « sublimation » (terme psychanalytique) et de l’ « idéation » (terme philosophique). La sublimation est une figure singulière du déplacement subjectif : elle est le déplacement du pulsionnel vers le passionnel, et de ce fait une sorte de recodification de l’intensité existentielle (de la pulsion à la passion) susceptible de bouleverser le sujet. Mais ce qui opère ce déplacement, cette sublimation, c’est l’idéation, soit l’Idée de l’amour en tant que lieu de la radicalité de la pensée. L’idéation, c’est la participation à l’Idée de l’amour. La participation est un processus subjectif relevant de la pensée, de la radicalité de la pensée. Une pensée n’est elle-même « radicale » qu’à la mesure de ce qu’elle est capable de créer en termes de vérité nouvelle dans le monde, en exception du monde, donc en termes de singularité existentielle, d’universalité générique et d’absoluité immanente. L’amour cristallise la dialectique toute particulière par laquelle la sublimation de la violence sexuelle intrinsèque infinie est relevée et métamorphosée de force par l’idéation dans ce que la pensée amoureuse – pensée de la différence en générale et singulièrement de la différence des sexes – recèle de radicalité intrinsèque infinie.
Pour conclure : les hommes sont évidemment au moins aussi nuls en amour que les femmes, c’est peu de le dire, mais du point de vue de ce que sont censées porter les femmes en termes d’énoncés et de subjectivité progressistes, il faut dire qu’il y a une honte toute particulière du côté des femmes dans la situation actuelle – je parle ici essentiellement des femmes qui ont grandi dans les classes moyennes des pays riches et qui sont toutes autant qu’elles sont – sauf exceptions rarissimes – en tout cas dans les générations adultes jeunes (mais même bien au-delà) des femmes actives, pétries jusqu’au bout des ongles par le consensus déployé des propagandes féministes dont je viens de parler. Il faut dire que les hommes ne valent souvent pas beaucoup mieux dans cette affaire, bien que la situation pour eux soit évidemment en général un peu plus compliquée, mais finalement leur position consiste la plupart du temps à choisir entre le pire et le moins pire, entre soumission soumise et réaction réactionnaire, donc entre conformisme féministe (le moins pire) et conformisme conservateur (le pire), mais j’affirme que la honte est désormais dans le camp des femmes en regard de la nécessaire réinvention de l’égalité politique et de l’amour, car toute cette propagande est au fond régie par la volonté des femmes de partager le gâteau avec les hommes et peut-être même si possible de s’en réserver à la fin les meilleures parts, c’est-à-dire de se faire une place de choix dans le monde tel qu’il est, sous le signe de l’ambition dévorante ou sous celui de la satisfaction tranquille, et certainement pas de travailler activement de manière courageuse et engagée à la transformation radicale de ce monde sinistre et détestable sous tant de rapports que nous avons qu’on le veuille ou non en partage. Ce qui est honteux, en un mot, c’est la manière dont le féminisme ne fait en définitive que travailler à la redistribution de la domination dans des pays soumis à des Etats dont le caractère redistributif est en grande voie d’extinction s’agissant de tout ce qui concerne non pas les rapports hommes/femmes mais la garantie des conditions minimales d’existence pour toutes les populations et notamment les plus pauvres. Donc : Femmes, encore un effort pour vous émanciper, avec et non pas contre les hommes ! Cela vaut du reste mille fois pour les hommes aussi !
Pour télécharger le texte en pdf :