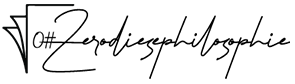Cours de philosophie de Julien Machillot
Ecole des Actes – 14 mars 2020
3
Critique de l’humanisme de Francis Wolff
« Toujours dans ce monde, il y aura lutte, sans décision ni victoire,
entre celui qui aime ce qu’il n’y a pas parce que cela existe,
et celui qui aime ce qu’il y a parce que cela n’existe pas. »
Bernardo Soares : Le livre de l’intranquillité.
Francis Wolff, dans son nouveau livre Plaidoyer pour l’universel (Fayard, 2019), prétend fonder une conception humaniste de l’humanité sensée redonner vie à des valeurs universelles. Je montrerai qu’en fait d’universel, on a affaire avec un tel humanisme à un universel purement abstrait, entièrement désabsolutisé malgré ses prétentions, prétendant se tenir à peu de frais au-dessus de l’humanité, et en définitive parfaitement homogène, malgré les apparences, au scepticisme dominant.
J’avais dit dans mon cours précédent que le scepticisme humaniste consiste à désabsolutiser toute figure d’universalité en assignant l’universel à l’humanité. C’était sans doute aller un peu vite en besogne. En effet, la thèse fondatrice de Wolff n’est pas seulement que l’humanité est seule source de toute valeur (reformulation contemporaine, à mon sens, quoique réorientée, de l’énoncé de Protagoras « l’homme est la mesure de toute chose »), mais aussi que l’humanité a une valeur intrinsèque démontrable. Une valeur intrinsèque = une valeur non dérivée d’autre chose que d’elle-même, non conditionnée, une valeur inconditionnelle, or inconditionnel signifie absolu (non relatif), donc une valeur absolue. Assigner l’universel à l’humanité, c’est donc a priori chercher à absolutiser l’humain plutôt que désabsolutiser l’universel, ce qui entre donc en contradiction avec ce que j’avais dit. Raison pour laquelle je propose d’examiner les choses un peu plus en détail aujourd’hui.
Je procéderai en deux temps :
I/ présenter la démarche de Wolff (montrer en quoi c’est une démarche « humaniste » et ses thèses fondatrices) ; critiquer le noyau fondamental de sa doctrine, qui nous conduira, entre autre, à la question de la science universelle dont je ne ferai par ailleurs qu’une critique limitée.
II/ plus important : critiquer de manière très sévère sa prétendue éthique universelle de l’humanité, établir la nécessité de se séparer radicalement de ce genre de doctrine stupide et mortifère qui, en se voulant humaniste, s’avère être profondément barbare.
-I-
Le « triangle dialogique » et la rationalité inhumaine de la pensée
La démarche de refondation de l’humanisme par Wolff est classiquement aristotélicienne, de manière revendiquée, et aussi largement d’inspiration kantienne. Cette démarche consiste à proposer une définition de l’homme de manière à en déduire son bien universel. Définir l’homme, c’est-à-dire déterminer ce qu’il en est de l’essence de l’homme, au sens de son être pensable, et inférer de cet être le bien proprement humain. Il s’agit donc de proposer une définition éthique et pas seulement épistémologique de l’humanité où on déduit, de l’essence de l’homme, une éthique universelle valant pour toute l’humanité. Il faut donc pour cela identifier un propre de l’homme, qui ne soit pas une propriété parmi d’autres, mais qui soit une propriété essentielle, une propriété fixant l’humanité dans son essence, son être singulier.
Wolff part de la définition classique selon laquelle « l’homme est un animal rationnel », ou « un animal doué de raison », ou encore « animal qui possède le logos ». Tout le problème étant de déterminer le sens du concept de raison.
La raison, c’est pour lui « la disposition anthropologique au langage, c’est-à-dire la capacité des hommes à se parler les uns aux autres à propos du monde, autrement dit à raisonner ensemble ». La raison est donc essentiellement assignée au langage et à la relation de dialogue. Le logos, c’est à la fois le langage et le rationnel. L’idée, c’est que la rationalité se forge et s’éprouve dans le dialogue. Cette assignation de la raison au langage est ce qui conduit Wolff à parler de « raison dialogique », qu’il oppose à une supposée raison classique. « Dialogique » = Dialogue + Logique = dialogue rationnel.
L’idée n’est pas tout à fait que le langage serait le propre de l’homme parce que seule l’humanité serait douée de langage. En réalité, l’aptitude au langage existe chez bien d’autres espèces animales. Seulement, chez les autres espèces, le langage serait entièrement réductible à sa fonction de communication, alors que la structure du langage humain est telle que le langage ne serait pas tant chez l’homme un moyen de communication que le mode d’être de l’humanité. Thèse qui s’inscrit donc de plein pied dans le vieux tournant langagier du 20ème siècle.
Telle est la définition proposée de l’humanité : l’homme est un animal doué de raison dialogique, du fait de la structure entièrement singulière du langage humain. Et c’est de cette raison dialogique, de cette structure langagière propre, qu’on pourrait déduire le bien humain, le bien universel de l’homme en tant qu’homme.
La différence avec la conception classique de la raison, c’est que la raison dialogique introduit la relation dans la notion de raison, là où la raison classique est accusée d’être monologique, relevant donc d’un monologue de la pensée faisant de la raison une figure de l’un. Mais ce qu’on peut constater immédiatement, c’est que la requalification humaniste de la raison consiste à tirer la raison du côté du langage et non de la pensée. En revanche, de manière classique, la raison, l’idée de rationalité, se divise en deux : il y a d’un côté la raison théorique, c’est la rationalité entendue comme le rationnel et qui conduit à la science ; il y a d’un autre côté la raison pratique, c’est la rationalité entendue comme le raisonnable et qui conduit à la morale ou éthique. Il faut donc noter que la notion de raison consiste à ne reconnaître l’existence de la pensée que du côté de la science et du côté de la morale. Il n’y a pas par exemple de pensée politique à proprement parler, sinon du côté de sa moralisation (ou de sa scientifisation). La notion de raison est par conséquent conforme à ce qui constitue pour moi le cœur du scepticisme contemporain, et qui est d’être un scepticisme dont l’enjeu est fondamentalement politique.
Qu’est ce qui fait du langage le propre de l’homme ? Le langage humain au sens de la rationalité dialogique, se fonde sur la puissance de la prédication, dont une des caractéristiques principales est d’avoir pour condition l’usage de la négation. Ni la communication animale (dite communication analogique), ni l’intelligence artificielle numérique, ne peuvent avoir recours à la négation assertive. Asserter, c’est formuler une proposition affirmative ou négative. Or, écrit Wolff, « « parler l’humain », c’est asserter, c’est-à-dire affirmer ou nier, prétendre que ce que l’on dit est vrai et que ce qui le nie est faux ; c’est dire quelque chose à quelqu’un qui pourrait justement dire ou penser le contraire. Ainsi considérée, la négation n’est pas d’abord un connecteur logique, c’est un opérateur pragmatique qui rend possible le dialogue : ce que l’un dit doit pouvoir être contredit par l’autre ». On toucherait là à la singularité du langage humain.
Quelle est la théorie du langage engagée ici ? L’idée c’est que « il n’y a pas de langage ni de rationalité humaine sans le oui et le non du dialogue. L’humanité commence avec la négation ». La négation rend possible les deux dimensions constitutives du langage humain : la relation d’interlocution et la relation d’objectivité (télécharger le schéma en annexe ici). La relation d’interlocution consiste à parler à quelqu’un, et la relation d’objectivité consiste à parler de quelque chose. Dans la relation d’interlocution, il y a deux termes : un locuteur disant « je » s’adressant à un interlocuteur en l’appelant « tu ». La relation d’objectivité inscrit un troisième terme, l’objet dont on parle. Cela forme donc un triangle, qu’on appelle alors le « triangle dialogique ». La relation d’objectivité détermine donc pour les interlocuteurs l’existence d’un monde objectif, extérieur à eux, à propos duquel ils discutent. Et la relation d’interlocution détermine l’existence d’un monde commun, que les deux interlocuteurs ont en partage. Or cette structure langagière triangulaire est ce qui ouvre à la puissance propre du langage humain, la prédication. La capacité propre du langage humain est la capacité de prédication. La prédication consiste à formuler des propositions (ou assertions, phrases, énoncés on peut appeler ça comme on veut) dans lesquelles on va distinguer entre d’un côté le sujet S dont on parle, et qui est le même pour les deux interlocuteurs, et de l’autre le prédicat P attribué par le locuteur au sujet S, et qui peut toujours être autre pour les deux interlocuteurs. Exemple : l’un dit : « le chat est noir » ; l’autre répond : « le chat est blanc ». « Le chat », c’est le sujet S dont on parle, et « noir et blanc » sont deux prédicats P attribués au sujet. On peut également dire « le chat n’est pas noir », ou « ceci n’est pas cela » : assertion négative liée à la structure prédicative de la phrase. Prédication et négation marchent ensemble. Donc cela revient à dire que la proposition de base du langage humain est « S est P ».
Il y a trois choses intéressantes à noter :
1/ Ce qu’il faut bien comprendre : le sujet S est en position d’objet du monde objectif : c’est parce qu’il y a un consensus préalable entre les deux interlocuteurs concernant l’existence effective du chat, qu’ils peuvent ensuite se contredire sur le prédicat qu’il convient de lui assigner. Wolff insiste sur ce point : « L’objet est « même » en deux sens : objectivement, il demeure identique ; interlocutivement il est commun. » Autrement dit, ce que les interlocuteurs peuvent ne pas partager, ce sont les prédicats assignables à l’objet, mais non l’objet lui-même !
2/ Cette puissance langagière de la prédication est une puissance infinie au sens stricte. La prédication est ce qui ouvre tout l’univers de la syntaxe, et la syntaxe est ce qui fait qu’à partir d’un nombre limité de mots du vocabulaire on peut inventer une infinité de phrases. La prédication ouvre le langage à sa complexification immanente infinie. Il faut noter que même un enfant de cinq ans peut formuler des phrases qu’il n’a jamais entendu en s’appuyant sur ce qu’il a appris.
3/ Autre point, plus intéressant encore, c’est que ce triangle dialogique se donne comme l’expression, du côté du langage humain, d’une différence anthropologique discernable chez les bébés avant même l’âge de un an. Quelque chose qu’on appelle le triangle référentiel dont Wolff fait la « scène primitive » de l’humanité. Cela concerne donc les bébés avant qu’ils ne sachent parler. C’est le fait que tout bébé a la faculté de porter son attention sur un objet dans le cadre d’une attention conjointe avec quelqu’un. Si on pointe du doigt un objet, le bébé peut lui aussi pointer du doigt le même objet. C’est donc un phénomène de décentrement prélangagier du rapport à soi : lorsque le bébé pointe du doigt un objet dans le cadre d’une telle attention conjointe, ce n’est plus lui-même mais un objet du monde, extérieur, qui devient le centre de l’attention conjointe. Et il paraît que ça ne marche qu’avec les humains, et pas avec les primates par exemple. Le bébé primate peut aussi occasionnellement pointer du doigt un objet, mais uniquement pour signifier qu’il veut qu’on lui donne l’objet, donc dans le cadre d’une prescription. Wolff en conclut que dans cette « scène primitive », « deux bébés fixent d’un commun accord implicite le même objet sans autre but que de constituer à la fois un monde d’objets hors d’eux et un monde commun entre eux. Elle contient déjà tout ce qui fait l’humanité de l’homme ». Et donc, la structure prédicative du langage vient en quelque sorte se greffer sur ce triangle référentiel prélangagier en constituant tout à la fois la relation d’objectivité avec le monde extérieur et la relation d’interlocution dans le partage d’un monde commun.
Ce qui fait la force d’une telle proposition, c’est sa capacité à déterminer une différence anthropologique essentielle apparemment indubitable avec une économie de moyens tout à fait remarquable. Tout cela est bien beau, et sans doute pas faux, mais le point qui m’embête, qui me chiffonne, c’est que la thèse de Wolff, est que, je cite, « la rationalité humaine est inscrite dans le triangle dialogique ». Or c’est ce que je ne crois pas, ou pas tout à fait. Si on admet que la rationalité humaine est inscrite dans ce triangle dialogique – pourquoi pas ? – il faut je crois ajouter aussitôt que la rationalité dont l’humanité est capable ne se résorbe pas complètement dans cette figure de la raison dialogique. Pour le dire autrement, je crois qu’il faut admettre qu’il y a une rationalité inhumaine qui travaille dans l’homme cette rationalité humaine et qui lui permet seule d’accéder aux figures les plus hautes de la pensée. J’appellerai donc « rationalité inhumaine » cette dimension de la rationalité de la pensée humaine qui ne se laisse pas réduire au cadre de la prédication. Je dirai que la rationalité humaine dialogiquement déterminée concerne en fait ce qu’il y a de compatible entre le langage et la pensée. Mais il y a aussi en l’homme une rationalité inhumaine, c’est-à-dire une capacité inhumaine à la rationalité qui concerne cette fois ce qu’il y a d’incompatible, d’hétérogène, entre la pensée et le langage dont par ailleurs elle ne peut pas se passer. Le fait qu’on pense avec et par le langage ne signifie pas que la pensée soit entièrement réductible à une structure langagière. C’est là tout le point ! La définition de l’homme par la raison dialogique rabat entièrement la pensée sur la puissance du langage prédicatif. C’est la première chose que je tiens à réfuter, et qui touche le noyau central, le centre fondateur, de l’humanisme de Wolff, puisqu’il y va de la définition même de l’être de l’humanité, à partir de quoi l’humaniste prétendra déduire le bien propre de l’homme, donc l’éthique humaniste. Il s’agit donc de montrer que le langage humain n’est pas seulement ce qui rend possible la pensée, mais aussi ce qui la limite, de telle sorte que la pensée ne pense vraiment que lorsqu’elle est amenée à déjouer les limitations de la pensée pour accéder à sa propre puissance infinie. Montrer, donc, que la puissance infinie de la pensée ne se résorbe pas dans la puissance infinie de la prédication, que la pensée relève d’un infini supérieur à celui du langage et en regard duquel le langage apparaît comme un faux infini.
Je ferai trois objections concernant ce que j’appellerai le réductionnisme humaniste de la pensée et qui consiste, donc, à rabattre exhaustivement la rationalité de la pensée sur le triangle dialogique du langage prédicatif, c’est-à-dire sur la rationalité langagière humaine. En outre, je soutiendrai à partir de là que ce qui constitue l’opération sceptique fondamentale de l’humanisme contemporain (bien qu’il ne se présente aucunement comme un scepticisme) est, à travers l’assignation de l’universalité à l’humanité, le recouvrement de la pensée par le langage par assignation sans reste de la pensée au langage.
Avant de formuler ces objections, une remarque introductive d’ordre générale. Il y a tout de même quelque chose de triste quand on lit les pages dont je viens de présenter succinctement les contenus, c’est l’impression dont on ne peut à aucun moment se départir qu’à travers tout ça on en revient finalement aux vieilles platitudes de l’intersubjectivité. J’appellerai ici tout simplement « intersubjectivité » l’articulation triangulaire de la double relation d’interlocution et d’objectivité. Un des motifs les plus récurrents et intéressants à mon sens des séminaires de Lacan par exemple, c’était la critique chaque fois sulfureuse et salvatrice de tout ce qui s’avançait sous les airs faussement innocents de l’intersubjectivité. Mais plus généralement, on a la sombre impression d’un retour en arrière proprement spectaculaire, où toutes les vieilles platitudes humanistes font retour avec une sorte d’arrogance bon enfant, comme si au fond toutes les critiques antihumanistes des 19ème et 20ème siècles n’avaient pas eu lieu, comme si de Nietzsche, Marx et Freud au moment philosophique français des années 60/70, rien de tout cela ne méritait plus d’être pris au sérieux. En plus l’intersubjectivité ça sent toujours sa vieille morale à 2 francs 50 (je n’ose même pas convertir ça en euros pour voir ce que ça donne…). L’intersubjectivité, c’est toujours l’idée qu’il faut reconnaître l’autre comme étant un sujet comme soi-même, il faut donc le respecter, le reconnaître comme son égal, et accepter le dialogue rationnel et raisonnable. Le dialogue, c’est démocratique, il faut être ouvert aux autres, et a contrario refuser le dialogue c’est objectiver son prochain, c’est le réduire à l’état de chose et lui refuser la considération qu’il mérite, c’est donc devenir inhumain, blablabla. Cela conduit à des choses proprement stupides et franchement honteuses, comme on le verra concernant la pseudo-éthique humaniste universelle, un peu moins somme toute avec la conception de la science universelle qui reste un peu plus digne, grande tradition humaniste portant les sciences aux nues oblige.
Autre remarque :
On ne peut pas ne pas être extrêmement frappé par l’étrange consonance de certaines formules clefs de la description du triangle dialogique par Wolff et le commentaire que fait Heidegger d’un fameux vers de Hölderlin : « nous sommes un dialogue ». Heidegger, qui ne pouvait certes pas connaître le poème achevé de Hölderlin « Fête de paix », qui ne fut découvert qu’en 1954, soit trois ans après la publication de « Approche de Hölderlin », cite ainsi le fragment d’une des versions du poème préparatoire inachevé :
« L’homme a expérimenté beaucoup.
Des Célestes, nommé beaucoup,
Depuis que nous sommes un dialogue
Et que nous pouvons ouïr les uns les autres. »
« Nous – les humains – nous sommes un dialogue. L’être de l’homme a son fondement dans le langage ; mais celui-ci ne prend une réalité-historiale authentique que dans le dialogue. […] Mais que signifie donc « un dialogue » ? Evidemment, le fait de parler les uns avec les autres sur quelque chose. Le langage est alors le médiateur qui nous fait venir et arriver les uns aux autres. » (Approche de Hölderlin, p.49) Ici, on retrouve le triangle dialogique, que Wolff exprime pour son compte en répétant Heidegger presque mot pour mot ! La filiation directe est encore plus claire dans ce qui suit : « Nous sommes un dialogue, cela signifie en même temps toujours : nous sommes un dialogue. L’unité d’un dialogue consiste en ce que chaque fois, dans la parole essentielle, soit révélé l’Un et le Même sur lequel nous nous unissons, en raison duquel nous sommes Un et ainsi authentiquement sommes nous-mêmes. » On reconnaît ici l’émergence du monde commun par la constitution de la relation d’interlocution. Puis s’ouvre la deuxième dimension du triangle dialogique : « Là où doit être un dialogue, la parole essentielle doit être relative à l’Un et au Même. Sans cette relation, un dialogue de controverse est même, et précisément alors, impossible. Mais l’Un et Même ne peut être révélé qu’à la lumière de quelque chose qui persiste et demeure. Persistance et demeurance ne se manifestent pourtant que lorsque brillent constance et présence. » On a donc ici ce que Wolff traduit en termes de relation d’objectivité. C’est là où il va se séparer de Heidegger, puisque pour celui-ci cette relation ouvre plutôt à la dimension du temps, qui seule peut articuler la muabilité des prédicats à l’immuable de la présence : « Mais cela ne se produit que dans l’instant où le temps s’ouvre dans ses extensions. C’est depuis que l’homme se pose dans le présent de quelque chose qui persiste, c’est depuis lors qu’il peut s’exposer au Muable, à ce qui vient et à ce qui passe ; car seul ce qui persiste est muable. C’est uniquement depuis que le « temps qui déchire » se trouve déchiré en présent, passé et avenir, que subsiste la possibilité de s’unir sur quelque chose qui demeure. Un dialogue, nous le sommes depuis le temps où « il y a le temps ». Depuis que le temps est amené à exister et à persister, depuis lors nous sommes dans l’Histoire. Être-un-dialogue [relation d’interlocution] et être dans l’Histoire [relation de subjectivité plutôt que d’objectivité], ces deux choses sont d’ancienneté égale, elles forment un tout solidaire, elles sont une seule et même chose. » (p.50) ([…] = ajouts de ma part) Alors que le dialogue est pour Heidegger au nouage du langage et du temps, il sera pour Wolff au nouage du langage et du rationnel. Par-là, Wolff substitue à l’insondable herméneutique du temps la plate position réaliste – parfaitement académique – de celui pour qui, délivré sans pensée et sans état d’âme des apories sceptiques de la philosophie moderne, l’existence du « monde extérieur » ne fait plus question d’aucune façon et depuis belle lurette. C’est qu’il n’y va plus pour lui, comme ce fût le cas pour Heidegger, d’un enjeu de renouement à la question de l’Être, mais seulement de celui d’une hypostase cosmopolitique de l’Homme. Mais dans les deux cas, qu’on ait affaire à l’Histoire et au temps ou au « monde extérieur » et à l’objet, est fondamentalement raté ce qui se joue dans le vers de Hölderlin, et est fastidieusement incorporé au maigre tournant langagier du 20ème siècle ce qui ne saurait s’entendre qu’au croisement de la nature, du divin et de la référence à la Grèce antique, telle que réactivée par la Révolution française. Certes, Heidegger n’a pas tort de déduire du dialogue qu’est l’homme la capacité humaine décisive à la nomination des dieux. Mais cela ne signifie pas qu’il faille rabattre la catégorie poétique de dialogue sur le fait du langage. L’événement fondamental n’est pas pour Hölderlin l’avènement du langage mais le surgissement, au sein de la Grèce antique, d’une capacité des hommes à vivre et marcher sur terre comme des dieux. La réduction du dialogue au langage est ce qui ouvre à la conception de l’humanité comme Histoire. Mais à cette conception, il faut opposer, comme le soutient à juste titre Judith Balso, celle de l’humanité comme Existence, où le rapport de l’homme au divin n’est pas que de nomination de l’être, mais relève d’une disposition intérieure, se manifestant de manière toujours exceptionnelle et temporaire, à transformer le monde pour le rendre meilleur. Le monde ne devient pas « parole », contrairement à ce qu’avance Heidegger, non plus qu’il n’est le lieu d’une pure extériorité, non, le monde n’est ni révélé par la parole, ni donné pour la discussion, il est transformé par l’homme. Ce qui se marque, dans le poème définitif « Fête de paix », par le fait qu’il ne s’agit pas pour le poète que l’homme soit « authentiquement » parole, « mais [que] bientôt nous serons chant ». La lecture heideggérienne est manifestement réductionniste : de la même manière qu’il y a une rationalité inhumaine de la pensée qui ne se laisse pas réduire à la rationalité dialogique de la prédication langagière, il ne s’agit pas de ramener l’humanité au dialogue qu’elle est – de manière supposément authentique et originelle – mais de déterminer les conditions à partir desquelles, de dialogue, l’humanité puisse se transformer et devenir chant. A la lumière de la lecture de Wolff s’éclaire rétroactivement que Heidegger, n’ayant été le pourfendeur de l’humanisme qu’à la mesure de ce qu’il véhiculait de métaphysique, aura été, aussi bien, le fondateur d’un humanisme plus moderne, plus au goût du jour, en un mot plus sceptique – scepticisme de celui qui finira, au seuil terminal de son œuvre, par déclarer que « seul un dieu peut nous sauver » !
Passons aux objections :
1/ Ma première objection partira de ce que j’ai dit concernant la puissance infinie de la syntaxe telle que rendue possible par la structure prédicative du langage. On a bien affaire, certes, à de l’infini. Mais la vraie question est : Quel type d’infinité est réellement à l’œuvre là-dedans ? S’agit-il d’un infini langagier capable de soustraire la pensée humaine à la finitude où tout le monde cherche à la réduire aujourd’hui, ou bien d’un infini compatible avec l’idéologie dominante de la finitude ? En réalité, si on examine ça de près, force est de constater qu’il s’agit d’un infini qui se laisse recouvrir par les opérations de la finitude, c’est-à-dire qu’on a affaire à ce que Badiou appelle dans L’Immanence des vérités un infini constructible. Un infini constructible, c’est en quelque sorte l’idée d’un infini chapoté par le fini. Pourquoi ? On est là dans la traduction philosophique de la doctrine des grands cardinaux, propre à la théorie mathématique des ensembles. Un infini constructible est un infini qui se laisse entièrement construire par un ensemble déjà-donné d’éléments, cet ensemble fût-il lui-même infini. Autrement dit, c’est un infini qui ne porte en lui rien de nouveau par rapport à ce qui le constitue et qui existait antérieurement à lui. Un vrai infini (un infini non constructible) en revanche porte en lui quelque chose qui n’existe pas sans lui, qui n’existait pas avant lui. Un infini est constructible parce que si grand soit-il, il est en quelque sorte « finitisé » dans la mesure où il reste comme collé à ce qui le constitue et qui limite définitivement sa grandeur. C’est le cas par exemple du premier infini, l’infini dénombrable (qui est l’ensemble des nombres entiers): bien qu’il y ait passage à la limite et que l’infini dénombrable soit réellement infini (ce n’est pas un infini potentiel auquel on n’accède jamais, ce n’est pas un infini auquel aucun nombre particulier n’accède, car l’infini dénombrable est un nombre à part entière), il reste qu’il n’est composé de rien d’autre que de l’ensemble infini des nombres finis qui le composent ; son extension reste comme collée à sa finitude intrinsèque : il est entièrement recouvert par les nombres finis qui lui appartiennent. C’est pourquoi, dit Badiou, la maxime fondamentale de l’idéologie de la finitude n’est pas tant « tout ce qui est, est fini » que « tout ce qui est, est constructible ». Ce qui veut dire que le principe de finitude ne procède pas tant à la négation de l’infini qu’à sa tentative de domestication. La constructibilité compose par conséquent le système d’oppression propre à l’idéologie de la finitude. L’oppression opère par recouvrements. Montrer que tout ensemble est constructible, fût-ce un ensemble infini, c’est montrer qu’on peut entièrement recouvrir cet ensemble par des éléments finis qui sont déjà-donnés, qui sont pris dans un stock disponible de base. C’est un phénomène de recouvrement, un peu comme le recouvrement d’un toit par un ensemble de petites tuiles qui finissent par recouvrir entièrement le vide, et l’enjeu est de montrer qu’il n’y a besoin de rien d’autre que de ce qui est déjà-là, déjà-admis et universellement disponible, pour penser tout ce qui est rationnellement pensable ou pour faire tout ce qui est possiblement faisable. A contrario, un infini non constructible, donc un infini véritable, que rien ne parvient à finitiser, qui est donc infini dans son extension (dans sa grandeur) mais aussi dans son être (dans sa structure rationnelle interne), est un infini qui comporte dans sa composition quelque chose de radicalement nouveau par rapport à ce qui était antérieurement disponible, si bien qu’il n’est pas rationnellement constructible, c’est-à-dire accessible par ces matériaux disponibles.
En quoi l’infinité à l’œuvre dans la prédication est-elle constructible ? L’infinité de la prédication, dans sa dimension empirique, c’est qu’on peut parler de tout et de rien sans limite, on peut se contredire à l’infini à propos de toute chose, on peut formuler une infinité de phrases quelconques ou importantes sans jamais épuiser les possibilités ouvertes par la syntaxe, on peut complexifier à l’infini, voire formuler des énoncés potentiellement infinis dans leur longueur… Cet infini est fondamentalement un infini syntaxique, au sens où la prédication a besoin d’une syntaxe pour se développer, on a besoin de pouvoir faire des phrases avec sujet, verbe, complément etc. (le chat est blanc, ceci est cela, ces énoncés, si simples et basiques soient-ils, nécessitent déjà toute une syntaxe) et c’est l’ensemble des règles syntaxiques de construction des phrases dans la langue qui ouvrent la potentialité infinie du langage. Néanmoins, si la syntaxe fixe les règles du rapport des mots entre eux dans la phrase, et si ces rapports sont infinitisables, le stock de mots disponibles de la langue est quant à lui fini (quelques milliers), et l’ensemble des règles de syntaxe compose à son tour un ensemble fini et surtout c’est un ensemble consensuellement admis qui règlemente de l’intérieur l’infinité possible des phrases formulables. Quelle que soit la phrase que je vais formuler, même s’il s’agit d’une phrase que personne n’a encore jamais prononcée, elle va respecter les règles admises de la syntaxe. L’infini en question est donc constructible, au sens où il se laisse construire par le croisement de l’ensemble fini des prédicats disponibles et de l’ensemble normatif admis des règles syntaxiques. L’infini syntaxique est donc parfaitement compatible avec l’idéologie de la finitude, raison pour laquelle l’humanisme peut accepter d’en faire une composante de l’essence de l’homme. Et par conséquent, si on rabat l’infinité dont est porteuse la pensée sur l’infinité syntaxique langagière, on s’assure une conception de la pensée elle-même constructible et maintenue sous le boisseau de la finitude normative de l’existence humaine. Il reste donc maintenant à démontrer, et ce sera l’objet de mes deux autres objections, que ce rabattement réductionniste de la pensée sur l’infini langagier n’est pas possible.
Je veux montrer que toute pensée vraie, toute pensée aux prises avec la création d’une vérité nouvelle, et donc aux prises avec la découverte d’un nouvel horizon d’absoluité, a toujours pour effet soit de rompre la relation d’interlocution, c’est-à-dire de faire imploser le monde commun, soit de briser la relation d’objectivité, c’est-à-dire de faire exploser le monde extérieur, qui sont, on l’a vu, les deux relations constitutives, du triangle humaniste dialogique. Pour donner une image, je dirai volontiers que lorsqu’on introduit la pensée dans les circuits du triangle dialogique, alors se produit une surcharge qui fait sauter les plombs de la prédication. Et cela, je crois qu’on peut le montrer assez clairement.
2/ Commençons par la relation d’objectivité. La prédication consiste, selon cette relation, à porter des jugements qu’on croit vrai ou à réfuter des jugements qu’on croit faux à propos d’un objet extérieur, donné comme appartenant au monde objectif, c’est-à-dire existant indépendamment des interlocuteurs qui en parlent. Donc la prédication prend la forme d’un jugement, mais plus précisément d’un jugement sur ce dont les interlocuteurs ont au préalable consensuellement établi l’existence. C’est comme ça que fonctionne le jugement. Sans cet accord préalable, le jugement ne peut pas s’exercer. Alors, oui, dans les discussions courantes, dans les discussions de tous les jours, c’est la plupart du temps comme ça que ça se passe. On pourrait dire que c’est effectivement comme ça que fonctionne la circulation des opinions. Que ce soit pour dire « la choucroute est bonne » ou « l’immigration est un problème », c’est bien comme ça que fonctionne le langage dans son registre le plus commun. C’est comme ça aussi que ce qui est de l’ordre de la pensée est rabattu dans le registre de l’opinion. On pourrait donner une sorte de liste à la Borges d’objets consensuellement établis sur lesquels s’exerce le jugement plus ou moins savant ou ignorant, et si on examine la liste de près, on verra tout de suite qu’il y a quelque chose qui ne va pas, qui ne colle pas. Soit la liste suivante : « crise des migrants » ou « problème de l’immigration » (du côté de la politique), « vide physique » ou « matière noire » (du côté de la science), « vers-librisme » ou « art contemporain » (du côté de l’art), ou encore « abus sexuels » ou « identités de genre » (du côté de l’amour ou du rapport entre les hommes et les femmes en général). Voilà une liste d’objets dont l’existence est plus ou moins consensuellement établie, où chacun y va de son opinion, dans une discussion qui peut d’ailleurs être aussi infinie que vaine dans bien des cas, c’est-à-dire que chacun y va du choix des prédicats qu’il va attribuer à ces objets apparemment objectivement déterminés, objectivation légitimée et renforcée par tout un tas de discours supposément savants et constitués en autant de disciplines universitaires (sciences humaines, etc.). Sauf que quand on est réellement confronté au réel de ce qu’il y a à penser, donc à la pensée même, ce qui se passe est en réalité tout à fait différent ! Pourquoi ? Pour répondre à cette question, on va faire un détour par la science pour examiner ce qui se passe au niveau de la relation d’objectivité, dans la mesure où la thèse de Wolff, c’est que la science procède à l’universalisation des processus de prédication et, en ce sens, à l’autonomisation de la relation d’objectivité. Universalisation qui fait de la science autre chose qu’une croyance, ou que ce qu’il appelle une croyance de croyance croyable par quoi il définit les savoirs en général. La science n’est pas un savoir, car elle seule échappe à la croyance pour conquérir un véritable point de vue universel, ce qu’il appelle le point de vue de nulle part. C’est là son optimisme humaniste, si je puis dire, et c’est ce qu’il y a encore de plus digne dans sa démarche. Comment justifie-t-il la capacité de la pensée scientifique à accéder à de l’universel, sur la base de la capacité prédicative du langage humain ? C’est cette question qui m’intéresse, car on voit bien que le rabattement de la pensée sur le langage n’interdit pas pour l’humaniste une certaine capacité d’accès à la connaissance universalisable. Le lien entre structure prédicative du langage et science universelle s’établie par ce que Wolff appelle la question de l’ethos scientifique de l’homme. L’ethos, mot grec pour dire l’être ou la manière d’être de l’homme. Il y a quelque chose dans la manière d’être proprement humaine de l’homme qui le porte à se rendre capable de science. C’est une thèse à mon avis très juste et très intéressante. L’idée c’est qu’il y a trois choses qui caractérisent la manière d’être scientifique de l’homme : « l’impersonnalité », « le désintéressement » et « le doute systématisé ». L’impersonnalité, c’est l’idée que ce qui fait la vérité d’une découverte scientifique est interne à cette découverte, et ne dépend pas de celui qui l’a découverte. Donc c’est l’idée d’un anonymat intrinsèque du scientifique : certes, on connaît tous le nom de Galilée, mais Galilée avait raison parce qu’il avait raison, et non pas parce qu’il s’appelait Galilée. Donc la capacité du scientifique n’est pas celle d’exister en tant que lui-même, en tant que personne, mais d’exister en tant qu’humain. Le désintéressement, c’est l’idée que « la connaissance scientifique n’a d’autre fin qu’elle-même ». Donc ça conduit à séparer la science de ses usages pratiques, à séparer science et technologie. Et le doute systématique, c’est l’idée qu’on ne prend rien pour argent comptant, que tout doit être minutieusement prouvé, démontré (doute méthodique) ; que tout est sans cesse remis en cause et en chantier, le doute comme moteur de l’histoire des sciences (doute épistémologique) ; qu’il y a une vocation de la science à critiquer les croyances reçues, les préjugés (doute institutionnel). Le lien entre ces trois dimensions de l’ethos scientifique de l’homme et la prédication est assez clair et évident. Déjà dans la scène primitive, le bébé fait l’épreuve d’une capacité à se décentrer en prenant un objet tiers comme objet d’une attention conjointe avec un autre être humain. L’accès au langage prédicatif radicalise cette capacité puisqu’il est inscrit dans la structure langagière elle-même que c’est le monde objectif et le monde commun qui constituent le centre des choses et non soi-même ou un fragment d’humanité limité. La science et l’ethos qu’elle porte en elle comme sa condition propre ne font d’une certaine manière que radicaliser cette capacité de décentrement, pour accéder, sous des conditions déterminées et contrôlables, au point de vue de nulle part, c’est-à-dire au dépassement de tout point de vue particulier au profit d’une connaissance universelle.
Une remarque : cette universalité est décrite par Wolff comme un idéal, on ne sait jamais très bien si la science accède réellement à l’universalité ou non ; la question ne se pose jamais en ces termes pour Wolff, ce qui est à mon avis un problème, car d’une certaine manière sa faiblesse ici est non pas d’avoir une conception sceptique de la science, mais plutôt de ne pas prendre le scepticisme assez au sérieux précisément. La réponse sceptique pourrait être de dire ‘oui, oui, bien sûr, ça marche comme ça, mais comme vous le dites vous-mêmes, le point de vue de nulle part est un idéal, il est donc certainement intrinsèquement inaccessible et ne contredit en rien la thèse sceptique de l’impossible accès réel, effectif, à une connaissance universelle déterminée’. Mais laissons ce point de côté. Admettons que c’est peut-être un procès un peu facile, et laissons ce point de côté, même si je crois qu’il est tout à fait sérieux, car cela renvoie au fait qu’il y a quelque chose qui manque gravement dans la théorie humaniste de la science universelle, à savoir le statut des mathématiques dans tout ça, ce qui est d’autant plus curieux qu’on s’attend en le lisant à l’examen du rapport de l’extrême singularité du langage mathématique dans la structure prédicative générale du langage humain…
Je n’ai rien à redire concernant les trois caractéristiques de l’ethos scientifique de l’homme telles que l’humaniste les détermine, sinon peut-être ceci, qu’à mon avis il manque une quatrième dimension de cet ethos dont il ne parle pas, qui me semble pourtant irréductible aux trois autres, non déductibles de l’une d’elles, et à mon avis cette quatrième dimension, Wolff la laisse de côté pour cause. Cette quatrième dimension, c’est la dimension du désir qui anime les trois déterminations de l’ethos scientifique de l’homme, et qu’on peut appeler le désir d’explorer l’inconnu. C’est le désir de creuser l’inconnu, de découvrir et connaître des choses entièrement nouvelles, qui le pousse à mettre en doute ses croyances, à accepter la position intrinsèque d’anonymat dans la pensée, et qui anime de l’intérieur son désintéressement. C’est donc peut-être une composante plus radicale, plus fondatrice, de l’ethos scientifique de l’homme que celles identifiées par Wolff. Or pourquoi mettre de côté cela ? Pourquoi ne pas en parler ? Certainement pour la raison suivante : mettre en avant l’exploration de l’inconnu, c’est mettre au jour le fait que ce qui fait avancer la science, c’est toujours la destitution des objets établis sur lesquels portaient les discussions au profit de la découverte d’existence de nouveaux objets, cette découverte conduisant elle-même à la mise en crise radicale du système des prédicats disponibles, puisque ce qui caractérise ces nouveaux objets, c’est précisément qu’il n’existe pas pour eux de prédicats disponibles dans la langue. Autrement dit, ce qui fait toute l’importance de l’exploration scientifique de l’inconnu, c’est qu’elle fait de toute pensée scientifique la pensée d’un imprédicable, mettant en défaut la prédication. La prédication, c’est la délibération des prédicats disponibles à attribuer à un objet consensuellement établi. Mais la pensée scientifique, c’est la pensée d’un imprédicable, c’est-à-dire d’un objet indiscernable du point du régime établi des prédicats disponibles, donc un objet pour lequel il y va d’abord non pas tant des prédicats à lui attribuer que de la thèse de son existence. En tant que pensée d’un imprédicable, la pensée scientifique fait de la vérité une vérité d’existence des objets avant d’en faire une vérité de correspondance des prédicats aux objets. Il n’y a donc pas seulement autonomisation de la relation prédicative d’objectivité en regard de la relation d’interlocution, mais mise en cause immanente ou mise en crise intrinsèque de la relation d’objectivité elle-même. Bien sûr, la pensée ne se sépare pas du langage prédicatif, elle ne pratique pas d’autre type de langage, mais c’est uniquement par défaut, parce que la prédication est le seul langage disponible compatible avec les ressources de la pensée ; la pensée est toujours, lorsqu’elle se met réellement à penser, en butte aux limites structurelles de la prédication. La pensée procède donc toujours par mise en crise d’un régime de prédication établi et invention d’un nouveau régime de prédication, tout aussi limité en soi que le précédent, mais permettant d’incorporer les nouvelles pensées ainsi rendues universellement disponibles. Et en tant que toute pensée est pensée d’un imprédicable, il y a donc irréductibilité de la rationalité de la pensée à la rationalité langagière de la prédication. Pour le dire autrement, il y a incompatibilité entre la notion de vérité du point de la prédication et la notion de vérité du point de la pensée. Donc, non, la rationalité humaine n’est pas entièrement inscrite dans le triangle dialogique, ou plutôt, si c’est le cas, il n’en reste pas moins qu’il y a quelque chose de la rationalité inhumaine de la pensée qui ne se laisse pas inscrire dans la rationalité humaine, trop humaine, du triangle dialogique. Si on ne prend pas en compte cette dimension inhumaine de la rationalité, alors l’élévation par la classification aristotélicienne des degrés de la raison dialogique allant du jugement rendu possible par le triangle dialogique à la science universelle reste un miracle inexplicable.
2/ Passons maintenant à la relation d’interlocution. Pour montrer comment la pensée en vient à briser la relation d’objectivité, on a fait un détour par la science, parce que la science universelle est ce qui autonomise la relation d’objectivité du triangle dialogique selon Wolff. A contrario, ce qui autonomise dans la pensée la relation d’interlocution est pour lui l’éthique. Le problème c’est que l’éthique humaniste, on le verra tout à l’heure, est en fait un bouche trou de la politique, et même plus généralement un bouche trou de toutes les figures non scientifique de la pensée, à propos desquelles il y va de la question de la vraie vie. Donc, pour montrer comment la pensée en vient à briser la relation d’interlocution de l’intérieur et à faire imploser le monde commun contenu par la structure prédicative du langage, je ferai un détour par la politique et non par je ne sais quelle éthique générale. Partons du syntagme que j’ai cité tout à l’heure dans ma liste à la Borges des objets consensuellement établis sur lesquels l’opinion s’exerce à la prédication. Partons du syntagme « crise des migrants ». Il y a une première chose importante à souligner : ce syntagme n’est pas conçu comme un prédicat mais comme le nom antéprédicatif d’une chose sur laquelle vient s’exercer le jugement d’opinion. Autrement dit, il y a aujourd’hui un consensus cristallisé sur l’idée que « crise des migrants » serait le nom recevable d’une réalité à propos de laquelle il y aurait lieu d’exercer la prédication politique dans l’espace constitué par la relation d’interlocution dite « démocratique ». A partir de là, l’un dira « ce sont des envahisseurs », l’autre qu’il faut les accueillir pour « raisons humanitaire », ou qu’il faut être « humaniste » mais que « on ne peut pas accueillir toute la misère du monde », un autre proposera de distinguer entre deux prédicats : « migrants politiques » et « migrants économiques », et autres saloperies du même acabit. Mais la vérité, c’est qu’il n’y a pas de crise des migrants. L’objet « crise des migrants » n’existe pas. En vérité il n’y a ni « crise », parce que l’arrivée des gens qui viennent de loin dans des conditions abominables n’a strictement aucune raison d’être traitée comme un problème, au contraire (!), ni « migrants », car c’est d’une certaine manière un mot de « guerre » aux gens qui sont désignés comme ça, séparés ainsi par cette désignation du reste de l’humanité. On pourrait objecter que si on peut discuter sur « crise des migrants », c’est bien la preuve que c’est en fait un prédicat et non la mise en cause de l’objet même sur lequel ce prédicat s’applique, car qu’on soit d’accord ou pas avec ce syntagme, on parle bien d’une seule et même chose, d’un même phénomène existant, qu’on appelle ça « les gens qui arrivent, qui se déplacent dans le monde », « les prolétaires nomades » ou autrement, et qu’il est donc vain de jouer avec les mots comme ça. Ce à quoi je répondrai qu’effectivement, le syntagme « crise des migrants » n’est en fait qu’un prédicat du jugement, et qui plus est un prédicat qu’il faut prédiquer à son tour comme « dégueulasse », c’est un prédicat d’opinion élevé consensuellement au rang de nom antéprédicatif d’une réalité. Donc ce par quoi quelque chose de la pensée politique opère ici, qui n’est plus de l’ordre de l’opinion, se joue dans la destitution d’un nom antéprédicatif, nom ainsi réduit au rang de prédicat à combattre. Ce n’est donc pas au niveau des prédicats, mais au niveau du nom antéprédicatif que se joue le désaccord. Or la destitution du nom antéprédicatif signifie la destitution du monde commun lui-même, donc la rupture de la relation d’interlocution. Quand on en arrive là, cela signifie qu’il n’y a pas de discussion possible, c’est comme ça, il faut prendre acte de l’ampleur de la crise, c’est-à-dire prendre acte de l’existence d’une division irréductible, d’une adversité politique fondamentale, c’est-à-dire du fait qu’il y a des amis et des ennemis, que l’existence des ennemis n’est pas résorbable dans la relation d’interlocution, donc que la situation est une situation antagonique et non pas une situation de monde commun. Oui, cela fait aussi partie de la pensée et de l’humanité, positivement et non pas négativement comme inhumanité devant laquelle s’indigner et verser des larmes de crocodile ! Le problème de l’autonomisation éthique de la relation d’interlocution consistant à placer la pensée universelle de l’éthique dans la droite ligne de la structure prédicative du langage a pour résultat non pas la négation de toute figure d’adversité, mais la dénégation de toute figure de pensée qui serait porteuse en elle d’une figure d’adversité irréductible. Donc la négation de la politique ! Mais la négation de l’amour aussi bien, s’il est vrai qu’il n’y a d’amour vrai que dans l’épreuve que les amoureux sons seuls au monde, dans l’épreuve de la rupture de la relation d’interlocution ! Toute pensée porteuse d’une figure d’antagonisme est envisagée du point du triangle dialogique comme ne pouvant pas être de l’ordre de la pensée. Or, 1/ une telle pensée relève de la pensée et 2/ elle est bien ininscriptible dans le triangle dialogique. Elle relève donc d’une figure de pensée prouvant par son existence qu’il y a bien une rationalité inhumaine irréductible à la rationalité dialogique.
Nous pouvons maintenant conclure et répondre précisément à la question : pourquoi la pensée n’est pas du registre général de la prédication ? Parce que contrairement à ce que tous les enfants apprennent à l’école, les grandes décisions de pensée, et par conséquent les vraies discussions – quand ce sont des discussions où sont en jeu quelques vérités dignes de ce nom – ce sont la plupart du temps des décisions d’existence et non pas des jugements sur ce dont est consensuellement établie l’existence. La pensée véritable ne consiste pas tant, la plupart du temps, à attribuer le bon prédicat à un objet qu’à établir l’existence ou la non-existence de cet objet ! De ce point de vue, réduire la pensée à la prédication est un scandale ! Autrement dit la pensée n’est pas ce qui est conditionnée par la relation d’objectivité, mais bien plutôt ce qui met en question de la manière la plus radicale qui soit cette relation d’objectivité. Et par ailleurs, de la même façon, la pensée n’est pas ce qui est conditionnée par la relation d’interlocution, mais bien plutôt ce qui met en question de la manière la plus radicale qui soit cette relation d’interlocution. Parce que ça signifie que la pensée procède fondamentalement par vérités d’existence et non pas par vérités prédicatives. Vérité d’existence qui peut porter soit sur le monde extérieur, donc par la mise en cause de la relation d’objectivité, soit sur le monde commun, donc par la mise en cause de la relation d’interlocution. Wolff écrit quelque part : « Les interlocuteurs s’accordent sur ce dont ils parlent pour pouvoir être en désaccord sur ce qu’ils disent ». C’est en quelque sorte son leitmotiv. Mais non, ce n’est pas ça qui se passe ! Le cas intéressant, le cas de pensée, c’est lorsque les interlocuteurs sont en désaccord sur ce dont ils parlent et non pas lorsqu’ils sont en désaccord sur ce qu’ils disent de ce dont ils parlent ! Par ailleurs, dans l’espace de la politique, le cas dans lequel les interlocuteurs se mettent d’accord sur ce dont ils parlent pour être en désaccord sur ce qu’ils ont à en dire est souvent le pire des cas, comme en témoigne la plupart des consensus parlementaires. C’est, typiquement, Fabius, premier ministre de Mitterrand, déclarant tout à trac que « Le Pen pose les bonnes questions mais apporte les mauvaises réponses », cristallisant ainsi le sinistre consensus d’opinion sous le règne duquel nous vivons depuis bientôt 40 ans, tel qu’initié par l’arrivée de la gauche au pouvoir, selon lequel il y aurait « un problème de l’immigration » ! Au fond, le triangle dialogique fait comme si le partage entre relation d’interlocution et relation d’objectivité, comme si la polarisation entre monde commun et monde extérieur, était toujours-déjà là, immuable, parce qu’enracinée dans la structure prédicative du langage humain, donc dans l’être de l’homme. Mais ce qui se passe c’est que, au vrai, toute pensée est une refonte du partage entre subjectivité et objectivité procédant par thèse d’existence et non un jugement par prédication sur fond d’une polarisation monde commun/monde extérieur consensuellement établie ad aeternam. Autrement dit, la raison pour laquelle la pensée met au travail une figure de rationalité inhumaine au cœur de la rationalité dialogique humaine, c’est que la structure prédicative de la langue est un état de choses, tandis que la pensée est fondamentalement un processus de vérité. Toute pensée véritable est un processus qui construit une vérité nouvelle dans la guise d’un objet que le régime prédicatif du langage échoue à discerner par les prédicats disponibles dans ce que Badiou appelle « l’encyclopédie de la situation ». Or l’indiscernabilité de l’objet par quoi toute pensée vraie est pensée d’un imprédicable, c’est précisément ce qui fonde dans L’Etre et l’événement de Badiou la vérité à n’exister qu’au régime de l’universalité générique. « Générique », cela signifie que ce n’est pas identifiable, séparable par un prédicat, et que c’est donc indiscernable pour les opinions ou même les savoirs existants. L’universel générique, c’est précisément l’idée que la pensée procède comme processus de neutralisation du régime prédicatif du langage en vue de l’émergence d’un objet entièrement nouveau et inconnu, imprédicable ou indiscernable quoique rationnellement pensable, et qui seul mérite en définitive le nom de vérité.
On peut résumer cela de la manière suivante : le principal défaut du triangle dialogique, c’est qu’il opère le recouvrement par unification factice dans la finitude d’un triangle limité de deux orientations existentielles incompatibles qui divisent l’humanité en regard de ce qu’il en est de la pensée ; deux orientations irrésorbables l’une dans l’autre, qu’exprime dans l’œuvre du poète Fernando Pessoa le semi-hétéronyme Bernardo Soares, dans Le livre de l’intranquillité : « Toujours dans ce monde, il y aura lutte, sans décision ni victoire, entre celui qui aime ce qu’il n’y a pas parce que cela existe, et celui qui aime ce qu’il y a parce que cela n’existe pas » ; donc entre celui qui relève de la rationalité dialogique soumise à la prédication langagière, et celui qui relève de la rationalité inhumaine de la conquête de l’imprédicable par la pensée.
—————
On pourrait imaginer une objection à ce que je viens d’exposer. Une objection de la part de celui que j’appellerai l’humaniste prédicateur (réunissant les deux sens du mot prédication : prêcher et asserter, et comme la réduction de la pensée à la prédication relève à mon avis d’une faute impardonnable, je dirai : prêcher et pêcher). Ecoutons donc le prêchi prêcha du pêcheur prêchant qu’est l’humaniste prédicateur : « contrairement à tout ce que vous venez de soutenir, vous ne pouvez pas opposer votre conception de la pensée comme thèse d’existence à ma conception de la pensée comme jugement éventuellement universalisable fondé sur la puissance prédicative du langage, et ceci parce que l’existence pour la vérité de laquelle vous semblez faire si grand cas n’est jamais qu’un prédicat comme un autre ! Affirmer que le chat existe ou nier son existence, c’est exactement la même chose qu’affirmer ou nier qu’il est de couleur noire ! On a bien affaire dans les deux cas à la structure prédicative du langage ! Que l’astrophysique finisse dans les années à venir par établir que « la matière noire existe » ou que « la matière noire n’existe pas », il y aura bien inscription sans reste de la découverte scientifique, donc de sa pensée, dans un énoncé de type typiquement prédicatif ! Et s’il faut inventer de nouveaux prédicats pour nommer les contenus de cette fameuse matière noire dont on sait malheureusement que, si elle existe, elle ne se compose d’aucune des particules de la matière connue, et bien on en inventera pour combler le vide, on ne va pas en faire toute une histoire ! Alors – venez pas m’emmerder avec votre ‘rationalité inhumaine de la pensée’, qui sent d’ailleurs, vue les conclusions que vous venez de tirer de la mise en cause du prédicat « crise des migrants », son apologie communiste de la terreur et du totalitarisme ! »
A cette objection dévastatrice de gros lourdaud, voici quelle sera ma réponse :
« Le fait que ce soit vous, humaniste prédicateur, disciple revendiqué de Kant (outre Aristote), qui veniez me faire la leçon selon laquelle l’existence serait un prédicat comme un autre, c’est tout de même un peu fort de café ! Vous me mettez soudain dans l’étrange situation de devoir réactiver en l’actualisant la vieille démonstration de votre maître Kant par laquelle il avait définitivement mis fin dans l’histoire de la pensée à la possibilité des « preuves ontologiques », c’est-à-dire des preuves de l’existence de Dieu, dont l’honorable tradition remontait jusqu’au fin fond de la métaphysique médiévale ! C’est, du reste, une des rares perles de la philosophie kantienne ! Est-ce à moi de vous rappeler que pour ce faire, Kant a précisément dû démontrer que la faille rationnelle de toutes ces pseudo-preuves de l’existence de Dieu était d’envisager l’existence comme étant un prédicat comme un autre, qui pourrait être déduit comme n’importe quel autre prédicat (la bonté, la toute-puissance, l’infinité, etc.), du sujet « Dieu » ? Que cela revient précisément à donner à l’énoncé « Dieu existe » un statut fondamentalement différent pour la pensée, quoique homogène, d’un point de vue langagier, aux autres énoncés quant à eux bel et bien prédicatifs et du point de vue de la langue, et du point de vue de la pensée : « Dieu est bon », « Dieu est tout-puissant », « Dieu est infini », « Dieu est parfait », etc. ? Ma réponse à votre objection est donc la suivante : tout prédicat peut en droit être déduit d’un autre prédicat, même si en fait ce n’est pas toujours possible dans tous les cas. Par exemple : « le feu est rouge et brûlant » ; on peut très certainement déduire la rougeur du feu de son degré de chaleur. En revanche, l’existence ne peut être déduite d’aucun prédicat, ni en fait, ni en droit. D’où le fait par exemple encore une fois qu’on ne puisse déduire l’existence de Dieu d’aucun de ses attributs. Donc l’existence n’est pas un prédicat. Soyons un tout petit peu plus précis : d’un point de vue strictement langagier, grammatical, oui, vous avez raison, l’existence n’est jamais qu’un prédicat comme un autre. C’est bien la structure prédicative, donc syntaxique, de la langue, qui permet de formuler les phrases : « le chat existe », ou « Dieu n’existe pas ». Mais du point de vue de la pensée, il est strictement impossible d’envisager l’existence comme étant un prédicat comme un autre. Donc l’existence, en tant que catégorie de la pensée, n’est pas et ne peut en aucun cas être un prédicat comme un autre. Autrement dit, lorsque l’interlocution fait jouer au mot « existence » un rôle prédicatif (et du reste ça arrive tous les jours !), cela signifie qu’on est dans l’opinion et non dans la pensée. Il faut donc conclure que l’existence comme prédicat est l’impossible propre de la pensée – son point de réel – à l’aune de laquelle la rationalité de la pensée ne se laisse aucunement inscrire sans reste dans l’espace du triangle dialogique. Et cette impossibilité d’identifier l’existence comme étant un prédicat comme un autre est en quelque sorte le point ou la porte d’entrée dans la rationalité inhumaine de la pensée. C’est pourquoi je parle non pas d’existence, mais de vérité d’existence. Autrement dit, la vérité d’existence ne se laisse jamais déduire dans l’absolu, elle relève toujours d’une expérience, une expérience non empirique parce que singulière à la pensée et par laquelle la pensée touche à l’absolu et, si cela vous intéresse, cette expérience n’est autre que celle que théorise Badiou, dans L’immanence des vérités, au titre de l’index de l’œuvre. Ma réponse, je crois, met définitivement fin à ce qu’on pourrait appeler les preuves humanistes du tournant langagier du 20ème siècle, comme elle a mis fin il y a un peu plus de deux siècles aux preuves de l’existence de Dieu. »
-II-
L’universel constructible et la « valeur universelle » inconstructible
C’est sur le plan de ce qui est appelé « l’éthique », « éthique humaniste universelle » qu’on voit à l’œuvre à l’état pur le scepticisme contemporain, et qu’on peut ainsi identifier sa nature essentielle.
L’idée est que cette éthique permet de réaliser la sagesse, entendue comme l’unité du bien pour soi (du bonheur) et du bien en soi (du bien moral). Cette sagesse semble être de la nature la moins sceptique qui soit et je dois dire que je partage absolument cette thèse de compatibilité de bonheur et du bien, contre tous les renoncements faciles actuels, raison pour laquelle je suis contraint de m’expliquer avec les thèses de Wolff. Mais l’humaniste prétend à partir de là démontrer que le principe éthique fondamental est le principe dit de réciprocité. Alors que ce qui faisait l’universalité de la science était sa capacité à conquérir un « point de vue de nulle part » au-delà de tout point de vue particulier, la réciprocité est ce qui fonde l’universalité de l’éthique sur sa capacité à conquérir un « point de vue de toute part », c’est-à-dire dans la capacité de n’importe qui à prendre la place de tout autre être humain, donc de n’importe qui.
Par « principe de réciprocité », il ne faut pas chercher midi à quatorze heures, ça veut dire exactement toutes les futiles banalités qui vous viennent à l’esprit quand vous entendez ça : « ne fais pas aux autres ce que tu ne veux pas qu’ils te fassent », « ma liberté commence là où finit celle des autres », et tutti quanti ! C’est cela qui est sensé constituer le principe universel au fondement de l’éthique humaniste, déduite de l’essence langagière de l’homme ! Alors bien sûr on peut dire que tout ça ne mérite strictement aucune attention, que travailler là-dessus ne vaut pas cinq minutes de peine, tout ça est au fond méprisable, c’est d’ailleurs entre parenthèse toute la morale scolaire des fumeuses « valeurs républicaines », la morale officielle de l’éducation des enfants, en lisant ça on comprend mieux ce qu’il y a de proprement irrespirable et de pourri jusqu’à la moelle dans ladite « école républicaine ». Dans une telle éthique, c’est toute la question de l’éducation qui est en jeu. Mais cela vaut le coup je crois de regarder au moins une fois dans sa vie d’un peu près ce genre de choses, ne serait-ce que pour s’en libérer définitivement – il y a là d’ailleurs pour moi une règle de la pensée, qui est qu’on n’a jamais réellement mise à distance une chose tant qu’on n’a pas sérieusement travaillé à se réidentification en pensée – mais surtout, encore une fois, cela permet je crois d’aller au cœur de ce qui constitue le scepticisme contemporain. Je pense qu’effectivement le scepticisme d’aujourd’hui n’est jamais autant à l’œuvre que dans tout ce qui se donne sous l’étiquette « d’éthique », c’est-à-dire dans la morale, pour autant que le cœur du scepticisme actuel porte sur la politique. C’est « l’éthique » comme opérateur de recouvrement de la question politique. En même temps, pour identifier ce scepticisme, on a besoin d’un travail plus fondamental (que le seul niveau « éthique »), d’un travail de fond consistant à identifier son ontologie propre. Quelle est l’ontologie dont se supporte, sous le nom d’éthique, le cœur politique du scepticisme contemporain ? Cette ontologie, ce n’est pas autre chose que celle que Badiou a identifié dans L’Immanence des vérités sous le nom d’idéologie de la finitude. La finitude nomme le fondement ontologique du scepticisme contemporain tel qu’il se donne singulièrement sous la forme d’un scepticisme politique. L’idéologie de la finitude est l’ontologie du scepticisme politique, scepticisme qui, quand il est assumé dans toute sa généralité, est un scepticisme de la vraie vie dans toutes ses dimensions, non seulement politique, mais scientifique, artistique et existentiel au sens large. Mais chez Wolff on a en quelque sorte le scepticisme contemporain à l’état pur, c’est-à-dire concentré sur la question politique (encore que je n’ai pas lu son livre sur l’amour…).
On peut montrer que l’éthique humaniste de Wolff est belle et bien fondée sur un tel principe de finitude, d’une finitude immanente à la démonstration morale elle-même et qui la fonde, un principe de finitude qui se donne sous une forme qui va d’ailleurs bien au-delà du seul dispositif en question, car cela s’inscrit en fait dans quelque chose qui a commencé, dans la situation contemporaine, avec John Rawls et sa fameuse « théorie de la justice » qui est en fait une « théorie de l’équité », l’équité étant en quelque sorte le signifiant maître qui chapote tout ça.
La fondation de l’éthique, qui se veut rationnelle, a pour point de départ une « expérience de pensée ». Elle consiste à envisager les humains dans une situation abstraite de dialogue où ils sont réduits à leur pure dimension d’êtres dialogiques, et appelés par Wolff des « discutants impartiaux ». Donc une situation primitive et abstraite d’impartialité, de supposée neutralité pure, ouvrant à une « discussion libre » entre eux pour décider ensemble quelles vont être, écrit Wolff, les « règles éthiques régissant les relations humaines en général dans le monde commun où ils [sont] appelés à vivre ». Ce qui fait de cette situation une situation abstraite est que chacun des dits « discutants impartiaux » est placé dans une situation d’ignorance par rapport à lui-même. Personne ne connaît la situation qui sera la sienne dans le monde réel : riche ou pauvre, fort ou faible, homme ou femme, bon ou mauvais etc. L’idée, c’est donc que si chacun ignore tout de ce qu’il sera dans la réalité, tout de la situation qui sera la sienne, réduit par cette ignorance à l’état de pur interlocuteur supposément impartial, alors la discussion commune en viendra rationnellement et nécessairement à l’établissement de règles éthiques réellement universelles, c’est-à-dire justes et bonnes pour tout le monde. C’est cette expérience de pensée là que John Rawls a initiée, construction d’une situation abstraite connue sous le nom de « voile d’ignorance ». L’ignorance permettrait la neutralité dans la discussion, l’impartialité et donc l’universalisme rationnel des décisions morales partagées. Si on y réfléchit un peu c’est une idée tout à fait extraordinaire quand même, si on la replace dans le cadre de l’origine socratique de la philosophie ! La philosophie ne place plus l’humanité sous la prescription antique « connais-toi toi-même ! », mais sous la prescription moderne « ignores ce que tu es ! ». Donc défiance fondamentale envers la connaissance de soi. Le point de départ est un manque de confiance absolu envers les humains tels qu’ils sont, ou du moins dans le fait même de leur conscience de soi. En outre, s’ignorer soi-même, cela signifie que chacun est réduit à ce qu’il a de purement identique avec tout autre. Donc expérience de pensée totalement homogène à ce qui est à mon avis un des lieux communs les plus répandus et scandaleux de notre temps, qui consiste à voir dans la différence l’impossibilité propre de l’égalité : c’est notamment tous les féministes débiles qui expliquent que pour instaurer l’égalité entre les hommes et les femmes il faudrait commencer par nier la différence des sexes entre hommes et femmes, qui ne serait qu’une invention paternaliste ayant pour fonction de justifier la domination. La différence, c’est l’oppression, où ça y conduit nécessairement. Wolff écrit : « en tant qu’ils ne sont que rationnels, ils sont naturellement identiques, et a fortiori égaux ». L’égalité de départ est obtenue négativement, par la négation de ce que chacun connaît de lui-même. Donc il y a ici la défense de ce qu’on peut appeler une « ignorance méthodique forcée » qui a pour fonction d’inscrire le principe de finitude au cœur de la situation fondatrice de l’éthique. Car que se passe-t-il à partir de là ? Le point crucial est que chacun est mis dans une situation fondamentale de vulnérabilité. Dans la discussion qui va s’engager entre les « discutants impartiaux », chacun étant dans l’ignorance forcée de ce que sera sa situation réelle, tout le monde va chercher à se protéger en partant de l’hypothèse qu’ils pourraient bien se retrouver dans une mauvaise situation, voire dans la pire des situations. Imaginez qu’après une grande discussion de haute volée sur les grands principes de l’éthique humaine autour d’une table de nuage installée dans le pur ciel des idées, vous vous retrouviez soudainement projeté dans le monde réel sous la peau… d’un SDF dévoré par les poux en train mourir de froid en plein hiver ! Donc par peur, par crainte de se retrouver dans une situation d’infériorité, ils vont commencer par décider de la valeur égale de tous les êtres humains. Ils ne sont bien sûr pas censés éprouver de la peur puisqu’ils sont réduits à leur être purement rationnel, mais en tant qu’être rationnels ils savent en vérité quelque chose d’eux-mêmes, à savoir la possibilité de se retrouver dans une situation de grande vulnérabilité, et ils raisonnent à partir de là, c’est-à-dire à partir de leur intérêt personnel d’êtres conscients de leur finitude. Et je dois avouer qu’ici il y a quelque chose que je ne comprends pas bien, il y a à mon avis quelque chose qui cloche, qui ne marche pas : on parle de « discutants impartiaux » ; mais en réalité, la conscience de leur finitude fait des discutants des êtres en réalité extrêmement partiaux ! Chacun ne pense jamais qu’à soi-même ! Le principe de finitude est contradictoire avec le principe de neutralité impartiale ! Ou alors je ne comprends pas bien ce que signifie ici « impartial ». Personne ne pouvant s’assurer une situation plus favorable que celle des autres, chacun ne pense qu’à se retrouver dans la situation la moins pire possible. On a là un raisonnement purement sceptique : ne pouvant s’assurer le meilleur, on cherche à s’assurer tout du moins le moins pire. La rationalité à l’œuvre dans la discussion est une rationalité sceptique à l’état pur, qui s’enracine dans l’intérêt privé d’un être qui se sait intrinsèquement fini, fragile, vulnérable. Le croisement du principe de finitude et de l’identité rationnelle des êtres les conduits en fait à penser de façon typiquement sceptique. L’ignorance de sa situation réelle conduit chacun au scepticisme quant à la possibilité de tirer le meilleur pour soi, et c’est donc sceptiquement, c’est-à-dire par défaut, négativement, qu’ils sont conduits à penser le meilleur pour tout le monde. Cela n’a rien d’étonnant, puisque le scepticisme -moderne – est ce qui procède par définition d’un « on ne peut pas savoir ». L’ignorance méthodique de soi est donc un opérateur sceptique par excellence. Et c’est ça le principe de réciprocité auquel ils sont conduits. Ne sachant pas qu’elle est ma place, pouvant être n’importe qui, je suis forcé de me mettre à la place de tout le monde afin d’obtenir une garantie minimale quant à ce que sera ma place réelle. Ethique de la réciprocité, c’est ce que Wolff appelle, je l’ai dit, « le point de vue de toute part », c’est-à-dire que ça consiste à se mettre à la place des autres, à « se mettre à la place de tous ceux à qui on peut s’adresser ». En vérité, se mettre à la place des autres est toujours une stupidité et la « réciprocité » n’a à voir ni de près ni de loin avec un quelconque principe morale.
Wolff écrit donc : « Se sachant tous virtuellement vulnérables et ignorant leur degré de vulnérabilité réelle, ils se déclarent égaux a priori ». Plus loin : « Il n’y a donc qu’une seule valeur, celle qui est implicite dans le principe de réciprocité, mais elle est absolue [parce qu’en plus il y a une prétention à l’absolu là-dedans !] : la valeur égale de tous les êtres humains ». Valeur « au sens du prix que chacun accorde à son être », et se donnant comme « la condition formelle des relations humaines en général ». Alors là, franchement, je vais vous dire une chose, et vous penserez peut-être comme moi : si on m’accorde une telle valeur absolue dans ces conditions-là, personnellement je n’en veux pas, l’humaniste peut se la garder sa « valeur absolue » ! Je préfèrerais personnellement être traité comme un chien plutôt que d’être envisagé par les autres comme ça ! Je pourrais à la limite pardonner quelqu’un qui me maltraite, qui essaie de me tuer, mais je ne pourrais jamais pardonner à quelqu’un qui m’accorde de cette manière une telle valeur (je dis « qui essaie de me tuer », car la première chose qui est discutée par les discutants de Wolff est, je cite : « Afin de se protéger, tous s’engageront à ne pas agresser les autres à condition que tout le monde en fasse autant. » !!) ! La manière d’accorder de cette façon une valeur aux autres a quelque chose d’encore plus dégradant, d’encore plus explicitement barbare, que le fait de les humilier volontairement ou de tenter de les réduire à l’esclavage. Au moins, l’esclave, on ne fait pas semblant de lui accorder une valeur humaine. Le point crucial ici pour moi est le suivant : accorder de la valeur aux autres peut constituer une opération aussi violemment oppressive et humiliante que le fait de les envisager comme sans valeur ! Et d’ailleurs, que des êtres humains puissent accorder une telle valeur absolue à eux-mêmes et par dérivation à toute l’humanité à ce prix-là serait plutôt la preuve que l’humanité ne vaut franchement rien du tout ! Pour l’instant, tout ce que Wolff a réussi à prouver à mon sens, c’est que s’agissant de la « valeur absolue » de l’humanité, il n’y a pas de quoi sortir les violons ! Le contenu de la déduction consiste à prouver la valeur absolue de l’humanité, mais le type de déduction à l’œuvre, une déduction de type sceptique, prouve plutôt l’inverse, à savoir l’absence de valeur intrinsèque de l’humanité, puisque l’humanité s’avère ne pouvoir reconnaître sa valeur absolue que par défaut, négativement, contrainte et forcée par la conscience de sa finitude à laquelle il a fallu d’abord la réduire. Les conditions rationnelles d’attribution de la valeur absolue à l’humanité contredisent l’absoluité de cette valeur. La position d’énonciation, si logique soit sa construction interne, contredit l’objet déduit des énoncés. Parce qu’accepter d’avoir une telle valeur absolue, cela veut dire accepter « l’universelle vulnérabilité » comme étant la pierre de touche, le seul et unique critère de validation de toute prescription éthique existentielle. Donc, oui, je préfèrerais mille fois être traité comme un minable et un moins que rien par le dernier des abrutis plutôt que de laisser le sophiste humaniste m’accorder une telle « valeur absolue » ! Parce qu’au fond, accepter ça, c’est en fait accepter de se laisser inoculer la valeur absolue comme un suppositoire censé vous guérir de toute prétention à l’absolu ! C’est intéressant comme objection, parce que dans la manière dont j’affirme cela, je suis moi-même bien obligé de faire abstraction de ma situation réelle sans avoir besoin de l’ignorer : je suis prêt à accepter d’être placé dans une situation de grande vulnérabilité (être réduit à l’esclavage) sans en conclure à la nécessité du principe de réciprocité. Je n’ai aucune envie que qui que ce soit se mette à ma place et d’ailleurs se mettre à la place des autres n’est jamais ici qu’une manifestation supplémentaire de l’intérêt personnel. Donc non, il n’est peut-être pas si rationnel que cela, ou en tout cas si rationnellement nécessaire, de penser que les discutants dits impartiaux, placés dans leur situation d’ignorance, en concluraient nécessairement au choix du principe de réciprocité comme Wolff cherche à le leur faire dire. Ils pourraient tout à fait considérer qu’il y a d’autres enjeux infiniment plus importants dans la vie humaine et refuser de placer la pensée sous le signe de la finitude.
Un autre point, qui est pour Wolff une grande victoire et qui est plutôt à mon avis une grande défaite, c’est qu’effectivement, dans un tel raisonnement, qu’on parte de son intérêt ou qu’on soit désintéressé, le raisonnement arrive dans les deux cas au même résultat. Comme je viens de le montrer, ce n’est peut-être pas si vrai que ça. Mais admettons ce point un instant. Il écrit : « la raison dialogique ne distingue pas l’intérêt et la moralité ». Il y a réconciliation de la raison instrumentale qui raisonne rationnellement et de la raison pratique qui raisonne raisonnablement. Donc la raison dialogique en conclut à l’indiscernabilité de l’intérêt et du désintérêt. L’opération humaniste consiste en quoi ici ? Ce n’est pas que la capacité humaine à penser et agir de manière désintéressée soit frontalement niée, c’est qu’elle en vient à coïncider absolument avec l’intérêt pour tout ce qui touche aux enjeux éthiques de l’existence. Donc ce n’est pas une négation stricte, mais, encore une fois, une opération de recouvrement : le désintérêt, lorsqu’on l’envisage du point de vue de la finitude, se laisse éthiquement construire, c’est-à-dire recouvrir par le principe d’intérêt. Si c’est un infini, c’est un infini constructible qui n’apporte rien de plus à l’humanité, d’un point de vue éthique, que ce que l’intérêt rationnel bien compris pouvait par lui-même apporter. Je peux conclure ici mon objection de tout à l’heure : non, il n’est pas vrai que les « discutants impartiaux » en viendraient rationnellement et nécessairement au principe de réciprocité, parce que cela n’est vrai qu’à la condition qu’ils décident de penser sous le signe de leur finitude. Mais ils peuvent très bien décider de penser sous le signe de l’infini, c’est-à-dire en prenant pour point de départ une figure non constructible de désintéressement, faisant ainsi abstraction de la finitude violente dans laquelle on les a violemment enfermés. Il est donc tout aussi rationnel de penser que les « discutants impartiaux » refusent le « principe de réciprocité » au nom, précisément, du fait que l’humanité vaut mieux que ça. Et une telle décision reviendrait pour les « discutants impartiaux » à envisager « l’expérience de pensée » dans laquelle ils ont été placés pour ce qu’elle est : une prison, un immonde cul de basse-fausse dans laquelle l’humanité est jetée afin d’y faire définitivement oublier tout ce qui du désir de l’humanité relève de l’absolu.
Point fondamental : ce qu’il y a d’absolument terrible quand on lit tout ça, c’est le sentiment qui vous prend à la gorge qu’on a affaire à un raisonnement dont tout l’enjeu est d’enlever toute sa substance réelle à la vie humaine. Je veux dire : une fois qu’on a établi le principe de réciprocité, d’accord, et après ? Je ne serai pas agressé dans la rue, si je tombe malade je serai secouru et cela m’engage moi-même à secourir les autres, à être au mieux avec eux pour qu’ils soient au mieux avec moi. Bon, d’accord, et après ? Pourquoi est-ce qu’on vit ensemble ? En réalité, là-dedans c’est le fait même de la vie commune, la socialité si on veut, qui est envisagée entièrement par défaut. On vit ensemble parce que l’homme est un être qui ne peut pas ne pas vivre avec les autres. C’est ce que Kant appelle « l’insociable sociabilité » de l’homme. Donc la sociabilité par défaut, uniquement par défaut. Une vie collective sans contenus positifs, sans enjeux forts et universels, vidée de toute substance, de toute âme, de toute vie véritable ! C’est une éthique de la mort et non une éthique de la vie. Avec ça on peut peut-être apprendre à mourir (sauf qu’apprendre à mourir, ça ne veut strictement rien dire…), mais certainement pas apprendre à vivre, et encore moins à vivre collectivement ! Ceci est très clair lorsque Wolff écrit : « le fondement de l’universel éthique n’est pas le principe a priori de l’égalité et de la réciprocité entre discutants mais la conséquence a posteriori que chacun peut en déduire pour son propre bien et pour le bien de la communauté ». Donc : les discutants impartiaux en viennent à se mettre d’accord sur l’égalité a priori de tout être humain avec tout autre être humain ; a priori, c’est-à-dire que c’est en tant qu’humain que l’humain est d’égale valeur à tout autre, et non pas par ce qu’il fait dans la vie, etc. ; mais en même temps, cet accord sur l’égalité a priori résulte d’une décision a posteriori, puisque c’est non pas le point de départ de la discussion mais son résultat, tel qu’il se cristallise dans le principe de réciprocité. Ce qui signifie – c’est là le point, je cite – que « tout être humain rationnel choisirait de vivre selon les règles rationnelles de la réciprocité non parce qu’il considère tout interlocuteur comme son égal ( !!), mais parce que, destiné à vivre en communauté (il ne se suffit pas à lui-même) et dialogiquement rationnel (il peut échanger avec qui que ce soit), il sait qu’il ne peut trouver son bien que sous des règles d’égalité et de réciprocité ». On a bien affaire ici à l’égalité et la réciprocité pensées entièrement par défaut, non pas parce qu’on reconnaît à l’autre positivement une valeur égale, mais parce qu’on ne peut pas ne pas vivre en en ayant à supporter les autres. Encore une fois, je pose la question : qui serait prêt à ce qu’on lui accorde une valeur absolue de cette façon-là ? Et, a contrario, quel genre d’homme faut-il être pour consentir à accorder aux autres une telle valeur absolue dans ces conditions-là ? Parce que tout ça revient à dire : « Je sais que tu es un minable insignifiant dont la tête ne me revient pas, je serais spontanément plutôt porté à te faire la peau plutôt qu’à discuter raisonnablement avec toi, mais bon, je vais quand même t’accorder une valeur égale à la mienne et à tout autre, il le faut bien puisque c’est la seule façon pour que tu me fiches la paix et que ton existence cesse de menacer la mienne » ! C’est ça le raisonnement à l’œuvre ! Si ça c’est de l’humanisme, quelle est la différence entre être un humaniste rationaliste et un pur salaud ? Du point de vue de la subjectivité à l’œuvre, il ne doit pas y avoir tant de différences que ça !
Mais le point peut-être le plus crucial de toute l’affaire à mon sens, c’est qu’on a vraiment affaire à un humanisme qui prétend par-là se tenir à peu de frais au-dessus de la mêlée, qui se croit très au-dessus de ce qu’il appelle le conflit des valeurs. Autrement dit, l’humanisme est une éthique de la belle âme. En particulier, sa prétention est de distinguer entre bien universel et valeurs et là encore le raisonnement à l’œuvre est typiquement sceptique, c’est un raisonnement qui plus précisément articule scepticisme foncier et relativisme formel. En outre, la prétention suprême de cette distinction du bien et des valeurs, c’est de faire valoir le bien comme si universel qu’il serait le seul à ne pas se transformer en « arme des belligérants ». L’idée c’est que les valeurs sont des justifications partageables de l’action. A ce titre, la thèse humaniste fondamentale est qu’aucune valeur n’est universelle. Wolff écrit ainsi (goûtez-en une fois pour toute le style, car il y a beaucoup d’énoncés comme celui-ci où le lecteur a l’impression qu’on lui plonge la tête au fond d’une chiotte répugnante) : « Toute valeur est bonne à prendre au pays des hommes. N’importe quel signifiant vide, c’est-à-dire n’importe quel drapeau, peut devenir une valeur et n’importe quelle valeur peut devenir sacrée et donner sens à n’importe quelle vie, individuelle ou collective : nation, Allah, Christ, race, aryen, vraie croix, révolution, lieu saint, hérésie, sang, virginité, honneur, etc. » En fait de type de valeurs, Wolff en repère trois qu’ils met ensemble comme dans une grande tambouille immangeable : valeurs religieuses, fascistes… et communistes ! La notion de valeur elle-même est une notion sceptique et relativiste, dans la mesure où elle consiste à mettre dos à dos des orientations incompatibles de l’existence au nom des excès qu’elles justifient, et qui consistent toujours à faire la guerre à ceux qui ne partagent pas les mêmes valeurs que vous. Ici on retrouve de la manière la plus vulgaire qui soit le noyau du scepticisme politique contemporain, sous la forme du bilan réactionnaire antitotalitaire du 20ème siècle (Staline = Hitler) sur lequel s’empile le bilan réactionnaire antiterroriste du 21ème siècle (Staline = Hitler = Djihad). C’est comme ça que fonctionne le scepticisme politique : en mettant dos à dos des choses complètement désubstantialisées, soustraites à leurs enjeux humains fondamentaux, et en les réduisant par là au rang de « valeurs », c’est-à-dire de formes de « sens de la vie » entièrement substituables les unes aux autres dont le seul réel serait d’être de façon intrinsèque des fauteurs de guerre. De la même manière que le triangle dialogique visait à désubstantialiser la pensée de ses caractéristiques fondamentales par l’opération de recouvrement de la pensée infinie par l’infini syntaxique constructible, l’éthique humaniste vise à désubstantialiser les enjeux fondamentaux universels de la vie humaine par l’opération de recouvrement de la pensée politique singulière par la notion de valeur finie constructible (nulle valeur n’est universelle). Le bien universel qu’est censé être le « principe de réciprocité » n’est au fond rien d’autre qu’une actualisation de l’impératif catégorique de Kant, qui prétendait déjà pouvoir recouvrir toute situation éthique particulière par un critère déjà donné une fois pour toutes, donc faire de toute décision éthique une décision constructible. Une décision constructible, c’est une décision régulée par un critère toujours déjà donné, sur fond de l’acceptation de la soi-disant universelle vulnérabilité de tout être humain, c’est-à-dire sur fond d’une conception de l’humanité placée sous le signe de sa finitude constitutive.
A partir de là, le bien déterminé par l’humanisme prétend être plus universel que toute valeur quelle qu’elle soit, dans la mesure où ce bien porterait précisément sur la neutralisation de la portée toujours possiblement agressive voire guerrière de toute valeur. Autrement dit, le principe dit de réciprocité constitue une limitation, donc une régulation externe de toute valeur. En ce sens, le bien n’est universel que pour autant qu’il renvoie toute valeur à sa supposée finitude constitutive, et qu’il opère donc le recouvrement de toute portée éventuellement infinie d’une « valeur » partagée. La finitude constitutive de toute valeur, c’est l’idée que toute valeur doit être composable avec d’autres valeurs, dans le « respect de la diversité » des valeurs. On peut dire aussi que l’opération de recouvrement consiste en la destitution de toute Idée fondant pour l’humanité un enjeu de vérité universelle au rang de « valeur » composant un « sens de la vie ».
Ceci étant dit, le point n’est pas tellement d’effectuer une réfutation interne du dispositif humaniste moralisant. Car même si je crois avoir démontré que la déduction sceptique de la valeur absolue de l’égalité humaine n’a rien d’une déduction nécessaire, d’une déduction elle-même absolutisable, il n’en reste pas moins qu’elle reste rationnelle, donc possible. On touche ici à un autre point important de ce qui est identifié par Badiou dans L’Immanence des vérités concernant l’ontologie de la finitude opérant par recouvrement. En effet, le recouvrement consiste encore une fois non pas tant à nier l’infini qu’à le neutraliser en le plaçant sous le boisseau du fini. Donc il ne consiste pas tant à nier l’universel qu’à déterminer un concept de l’universalité qui soit strictement constructible. En guise de plaidoyer pour l’universel, on a en fait affaire à un plaidoyer pour l’universel constructible. C’est plutôt comme cela que Wolff aurait dû titrer son livre ! Cela signifie quoi ? Que tout ce qui est, et notamment tout ce qui est universalisable, est comme réfracté dans l’univers constructible par le dispositif global des opérations de recouvrement. Or, ce que montre la théorie des grands infinis de la théorie des ensembles, c’est que cet univers constructible est consistant, qu’il est cohérent donc plausible, c’est-à-dire qu’il ne peut pas être mis en cause uniquement pour des raisons de rationalité interne à son déploiement articulé. Ce qui est intéressant ici est que ça nous reconduit tout droit à ce qu’on a traité plus haut au titre de la pensée comme thèse non prédicative d’existence, comme vérité d’existence. Car si la réfutation ne porte pas sur la rationalité interne de l’univers constructible, donc sur une forme d’inconsistance interne de la déduction de l’universel constructible, quel va être le point de réfutation ? Badiou indique qu’il existe un théorème mathématique (appelé théorème de Jensen, sur « zéro dièse ») qui établit une condition très claire de non recouvrement par l’univers constructible. Je ne vais pas exposer ici les termes du théorème lui-même, mais directement la manière dont il se traduit ici. En réalité, on se situe ici au seuil d’une décision de pensée ; décision de pensée portant en elle l’enjeu d’une vérité d’existence. Pour le dire le plus précisément possible : Si, contrairement à ce que prétend l’humaniste, on peut soutenir qu’existe au moins une valeur universelle, alors cette valeur constitue une figure d’infinité qui ne peut pas être recouverte par l’universel humaniste constructible. La démonstration de ce point est très simple, très limpide ! L’universel humaniste est constructible précisément dans la mesure où sa fonction est de limiter, donc de finitiser toute valeur. D’où le fait que si l’universalité est accordée au bien, c’est uniquement afin que ce bien, situé au-delà de toute valeur, vienne interdire qu’une quelconque valeur puisse prétendre elle-même à l’universalité. Le principe de réciprocité n’est universel qu’afin d’empêcher qu’aucune valeur ne le soit. C’est ça, l’opération sceptique fondamentale de l’humanisme contemporain, telle que permise par le caractère constructible de l’universel humaniste. Autrement dit, l’existence d’une valeur universelle est l’impossible propre de l’éthique humaniste. C’est son impossible propre, en tant que c’est sa raison d’être. Par conséquent, si l’existence de ne serait-ce qu’une seule et unique « valeur » pouvant être dite universelle, donc intrinsèquement infinie, non limitable par le bien humaniste, était avérée, alors cela signifierait qu’il existe une valeur qui ne peut pas être recouverte par l’éthique humaniste, et donc qu’un autre univers existe que l’univers constructible. Et la conclusion à laquelle cela nous conduit, c’est que dans ce cas, on aura affaire à un universel non constructible, donc à un universel véritablement absolutisé. Ce qu’il s’agit de décider, c’est donc de l’existence d’une valeur universelle. Par ailleurs, la notion de valeur étant elle-même en vérité une catégorie du scepticisme, il conviendra de l’abandonner définitivement. Une « valeur universelle » est en fait une « Idée ». L’Idée est ce qui porte en elle la loi de son rapport au réel. La valeur est quant à elle une notion sceptique consistant à abstraire, séparer l’Idée de son rapport interne, en pensée, au réel, et prétendant ainsi déterminer un « bien » qui régulerait de l’extérieur le rapport de l’Idée à la réalité.
Ce qui faisait de l’universel humaniste un universel constructible, c’était l’idée d’un universel neutre, impartial, prenant la forme de n’importe qui se mettant à la place de n’importe qui, voire de tous les autres. La neutralité, l’impartialité est donc la structure même de la constructibilité de l’universel. On a affaire à ce qu’il convient d’appeler un universel abstrait, au sens précis où le bien universel en jeu est séparé de toute valeur particulière, il prétend planer à peu de frais au-dessus de l’ensemble composite des valeurs ainsi brutalement homogénéisées et les limiter de l’extérieur en dénonçant leur prétention à l’universalité comme étant un fourvoiement dans la figure de l’excès inhumain, conduisant nécessairement au pire. Or, la notion antihumaniste de valeur universelle porte au contraire en elle l’idée d’un universel concret : le bien n’est pas séparé de toute valeur et placé sur le piédestal d’une définition de l’humanité, parce que ce bien n’est rien d’autre qu’une valeur singulière universalisée. La valeur universelle court-circuite la séparation du bien et de la valeur et replace l’idée du bien dans les affaires et enjeux réels de la vie humaine. Autrement dit, l’idée du bien n’est rien d’autre que l’universalisation, donc l’infinitisation immanente d’une valeur singulière. Une valeur singulière : l’universel n’est donc pas neutre mais engagé dans les affaires du monde, il n’est pas faussement impartial mais délibérément partial, au sens où il prend parti, en situation, dans le cours de l’histoire humaine. On comprend mieux ici pourquoi la pseudo-éthique humaniste était vouée à se tourner en barbarie : en réalité, il n’est pas possible de fonder l’idée du bien autrement que par la prééminence d’une valeur singulière ; d’où le fait que l’humaniste est forcé d’enregistrer cela dans sa déduction du bien universel. Raison pour laquelle il parle de l’égalité comme « valeur absolue » déterminant la supposée « valeur intrinsèque » de l’humanité. C’est cela qui engage la raison humaniste à être une raison nécessairement sceptique, parce que seul le raisonnement par défaut inscrivant négativement l’égalité comme valeur absolue pouvait neutraliser tout effet infinitisant, donc émancipateur, de l’égalité ainsi reconnue. De la même manière que la religion chrétienne n’avait placé la terre au centre du monde et l’homme au sommet de la hiérarchie des êtres vivants doués de corps qu’afin d’enfoncer toute l’humanité dans la culpabilité de la matière et du pêché. En vérité, toute idée d’une « valeur intrinsèque » de l’humanité n’a jamais été qu’un opérateur barbare d’oppression des humains.
Reste, pour conclure, à déterminer ce qu’il en est de cette valeur universelle, de cette Idée dont je soutiens l’existence, et cette détermination ne se situe pas ailleurs que dans le travail en cours et à poursuivre d’une pensée philosophique sous condition de Hölderlin. Pour le dire de façon programmatique, cette valeur universelle n’est certainement pas autre chose que l’égalité, cette égalité que l’humaniste prétendait absolutiser par défaut. Toutefois, pensée en tant que valeur intrinsèquement universelle et non plus comme bien universel surdéterminant également toute valeur particulière, l’égalité ne sera plus déterminée de manière sceptique en étant placée sous le signe de la finitude, mais doit être pensée de façon affirmative et sous le signe de l’infini.
Télécharger l’annexe du cours ici
Télécharger le cours en pdf :