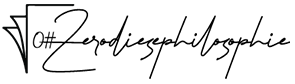Cours de philosophie de Julien Machillot
Ecole des Actes – 18 février 2017
Montaigne :
L’invention du scepticisme moderne
Leçon seconde
Apologie de Raymond Sebond, chapitre XII du livre II des Essais de Montaigne, le plus long chapitre, un peu plus de 200 pages.
Référence : Folio classique, éditions Gallimard ; édition présentée, établie et annotée par Pierre Michel.
Apologie de Raymond Sebond : enjeux
Raymond Sebond a été l’auteur au début du 15ème siècle d’une théologie naturelle, dont l’enjeu était de démontrer la compatibilité entre vérité rationnelle et vérité révélée, de montrer que l’homme peut donc, par sa nature propre, c’est-à-dire par les moyens rationnels de sa raison naturelle, accéder à la compréhension de ce qui se donne par ailleurs dans la foi religieuse sous la forme de vérités révélées par la grâce divine.
Montaigne a traduit cet ouvrage espagnol en français, et voici ce qu’il en dit vers le début de l’Apologie : « Sa fin est hardie et courageuse, car il entreprend, par raisons humaines et naturelles, établir et vérifier contre les athéistes tous les articles de la religion chrétienne : en quoi, à dire la vérité, je le trouve si ferme et si heureux que je ne pense point qu’il soit possible de mieux faire en cet argument-là, et crois que nul ne l’a égalé. »
Montaigne s’apprête donc, semble-t-il, à faire l’apologie de ce livre, à surenchérir les thèses et arguments de Sebond. Seulement voilà, ce n’est pas du tout ce qui se passe, les deux cents pages de ce chapitre procèdent à une critique particulièrement dévastatrice de la tentative de Sebond, et vont creuser un abîme absolument infranchissable entre la raison naturelle de l’homme et les vérités révélées de la religion chrétienne envisagée comme religion catholique. L’Apologie se donne page après page comme son exact contraire, non comme une défense ou plaidoyer en faveur des thèses de Sebond mais comme une critique au demeurant extrêmement violente et tranchante, au point qu’à la fin non seulement il ne restera rien des propositions de Sebond, mais en plus le système entier des thèses de Montaigne leur sera en tout point l’exact opposé.
Pour autant, l’usage du terme d’ « apologie » n’est pas ironique, Montaigne ne cherche aucunement à se payer la tête de Sebond, et il faut aussi écarter d’emblée l’idée que le terme serait un voile servant à couvrir une irréligion foncière voir un athéisme caché de Montaigne.
Il faut prendre au sérieux le terme d’ « apologie », c’est-à-dire : rendre compte de ce qu’est une apologie dès lors qu’elle se donne sous la forme paradoxale d’une réfutation systématique. C’est ce que je vais tenter aujourd’hui.
Qu’en est-il, donc, de cette apologie paradoxale ?
Je dirai que la notion d’apologie pointe l’existence essentielle d’un terrain commun, d’un enjeu commun entre les deux auteurs. Montaigne explique l’enjeu de lire et traduire ce livre, et raconte en particulier qu’il l’a traduit à la demande de son père, à qui ce livre avait été offert par un savant qui, je cite : « le lui recommanda comme livre très utile et propre à la saison en laquelle il le lui donna ; ce fut lorsque les nouvelletés de Luther commençaient d’entrer en crédit et ébranler en beaucoup de lieux notre ancienne créance. En quoi il avait un très bon avis (dit Montaigne), prévoyant bien, par discours de raison, que ce commencement de maladie déclinerait aisément en un exécrable athéisme ; car le vulgaire, n’ayant pas la faculté de juger des choses par elles-mêmes, se laissant emporter à la fortune et aux apparences après qu’on lui a mis en main la hardiesse de mépriser et contrôler les opinions qu’il avait eues en extrême révérence, comme sont celles où il va de son salut, et qu’on a mis aucuns articles de sa religion en doute et à la balance, il jette tantôt après aisément en pareille incertitude toutes les autres pièces de sa créance, qui n’avait pas chez lui plus d’autorité ni de fondement que celles qu’on lui a ébranlées ; et secoue comme un joug tyrannique toutes les impressions qu’il avait reçues par l’autorité des lois ou révérence de l’ancien usage,
Nam cupide conculcatur nimis ante metutum,
Car on foule aux pieds avidement ce qu’on avait auparavant redouté à l’excès (Lucrèce, de natura rerum, chant V),
Entreprenant dès lors en avant de ne recevoir rien à quoi il n’ait interposé son décret et prêté particulier consentement. » (p 139)
Ajoutons que Montaigne commence sa traduction de l’ouvrage en 1565, c’est-à-dire après la première séquence de la longue guerre civile.
L’enjeu commun, qui va justifier le terme de d’Apologie quoiqu’en le requalifiant, c’est la défense du catholicisme, c’est-à-dire plus précisément le renforcement de l’autorité des lois (donc de l’Eglise) et de la révérence envers l’ancien usage (donc les rites du culte chrétien) face à leur mise en cause par le « vulgaire », c’est-à-dire par un peu tout le monde, par n’importe qui.
On voit ici pointer une thèse centrale : « le vulgaire n’a pas la faculté de juger les choses par elles-mêmes ».
Or le vulgaire c’est en réalité le commun des mortels, tout le monde.
Plus loin dans l’Apologie, il écrira en effet : « nous sommes tous du vulgaire » (p309). Le vulgaire, c’est donc en définitive l’homme en tant qu’homme, c’est le statut de l’humanité tout entière qui est ainsi qualifié sous ce nom et cet énoncé. Le vulgaire, c’est l’humain une fois qu’on l’a soustrait à sa fausse singularisation par la raison.
Le présupposé est donc que l’être humain n’a pas la faculté de juger des choses par elles-mêmes, et il n’est pas exagéré de dire que l’ensemble du chapitre a pour enjeu de démontrer ce point.
Ce qui est en question est la capacité de la raison humaine à penser les choses pour ce qu’elles sont, à penser l’être de ce qui est, donc si le vulgaire, c’est tout le monde, ce qui est mis en cause par Montaigne n’est rien moins que la portée ontologique de la raison ou pensée humaine.
C’est donc une entrée en matière qui détermine la nature de l’opposition entre catholicisme et protestantisme : pour justifier que le critère de vérité religieuse ait l’Eglise comme lieu, et non le rapport en conscience de chacun aux énoncés de la bible.
Enjeu commun de défense du catholicisme et du renforcement du pouvoir de l’Eglise, donc. Seulement, entre le temps dans lequel écrit Sebond (début du 15ème siècle) et l’époque de Montaigne, environ un siècle et demi plus tard, la situation n’est plus du tout la même. Entre les deux, il y a eu précisément l’apparition du protestantisme. Si par conséquent l’Apologie de Raymond Sebond se donne sous la forme d’une critique radicale qui ne retiendra rien en définitive de sa doctrine, c’est parce qu’après le premier effondrement dans la guerre civile de la division ouverte par l’apparition du protestantisme, Montaigne fait le bilan de l’impuissance de l’intellectualité catholique face à la mise en cause de l’autorité de l’Eglise par les protestants et prend acte de la nécessité de changer de terrain. Il va marcher sur les pas d’Erasme, approfondir la brèche ouverte par l’humaniste chrétien qui a le premier commencé à employer le scepticisme comme arme de la Contre-Réforme, mais dans un élément qui ne sera plus celui de l’humanisme, et opérer le passage d’une hypothèse de métaphysique chrétienne, hypothèse héritée de toute la philosophie médiévale et enracinée chez Thomas d’Aquin par son partage entre théologie naturelle ou rationnelle (c’est-à-dire métaphysique) et théologie révélée, à une hypothèse profondément antimétaphysique de scepticisme catholique comme composant la nouvelle intellectualité pouvant seule travailler au renforcement de l’autorité de l’Eglise dans le nouveau contexte de division entre Réforme protestante et Contre-Réforme catholique.
Pour Luther, le critère de vérité de la foi, donc de vérité de l’interprétation des Ecritures est la conscience du croyant et n’est donc pas l’Eglise. Il n’est pas possible de soutenir sérieusement que l’Eglise soit le critère de vérité de la foi, car l’histoire de l’Eglise est pleine de contradictions, on ne peut en inférer une détermination simple et définitive du critère de la foi. Erasme, pour s’opposer à Luther, va donc procéder autrement : nier qu’il y ait un critère rationnellement déterminable de la foi, et établir qu’en l’absence de détermination possible d’un tel critère par la raison, il n’y a qu’une solution : s’en remettre à ce qui fait traditionnellement autorité en la matière, à savoir l’Eglise. Argument sceptique antirationaliste. Montaigne va en quelque sorte rationaliser, systématiser, l’antirationalisme de la foi, et en faire ainsi une véritable arme intellectuelle, pour les besoins de la Contre-Réforme.
Discours de la méthode dans l’Apologie de Raymond Sebond :
— Méthode du coup désespéré, tour secret comme préservatif à l’extrême nécessité. Terrorisme intellectuel, kamikaze spéculatif.
Ce changement de terrain magistral auquel procède Montaigne pour les besoins du temps clarifie la notion d’apologie, et ceci en particulier dans un texte du chapitre en question, texte qui constitue en quelque sorte le discours de la méthode de Montaigne, texte dans lequel l’auteur établit la méthode intellectuelle déployée tout au long de l’Apologie. Je vous propose de lire ce texte.
« Vous (Marguerite de Valois), pour qui j’ai pris la peine d’étendre un si long corps contre ma coutume (c’est en effet le chapitre le plus long des Essais), ne refuirez (refuserez) point de maintenir votre Sebond par la forme ordinaire d’argumenter de quoi vous êtes tous les jours instruits, et exercerez en cela votre esprit et votre étude : car ce dernier tour d’escrime-ci, il ne le faut employer que comme un extrême remède. C’est un coup désespéré, auquel il faut abandonner vos armes pour faire perdre à votre adversaire les siennes, et un tour secret, duquel il se faut servir rarement et réservément. C’est grande témérité de vous perdre vous-mêmes pour perdre un autre.
Il ne faut pas vouloir mourir pour se venger, comme fit Gobrias ; car, étant aux prises bien étroites avec un seigneur de Perse, Darius y survenant l’épée au poing, qui craignait de frapper, de peur d’assener Gobrias, il lui cria qu’il donnât hardiment, quand il devrait donner au travers tous les deux.
Des armes et conditions de combat si désespérées qu’il est hors de créance que l’un ni l’autre se puisse sauver, je les ai vu condamner, ayant été offertes. Les Portugais prirent 14 Turcs en la mer des Indes, lesquels, impatients de leur captivité, se résolurent, et leur succéda (et ils y parvinrent), à mettre et eux et leur maîtres, et le vaisseau en cendre, frottant des clous de navire l’un contre l’autre, tant qu’une étincelle de feu tomba sur les barils de poudre à canon qu’il y avait.
Nous secouons ici les limites et dernières clôtures des sciences, auxquelles l’extrémité est vicieuse, comme en la vertu. Tenez-vous dans la route commune, il ne fait mie bon être si subtil et si fin. Souvienne-vous de ce que dit le proverbe toscan : « Chi troppo s’assottiglia si scavez-za » (A trop s’amincir on risque de casser ; Pétrarque, Canzionere, XXII). Je vous conseille en vos opinions et en vos discours, autant qu’en vos mœurs et en toute autre chose, la modération et l’attrempance (mesure), et la fuite de la nouvelleté et de l’étrangeté. Toutes les voies extravagantes me fâchent. Vous qui, par l’autorité que votre grandeur vous apporte, et encore plus par les avantages que vous donnent les qualités plus vôtres, pouvez d’un clin d’œil commander à qui il vous plaît, deviez donner cette charge à quelqu’un qui fît profession des lettres, qui vous eût bien autrement appuyé et enrichi cette fantaisie. Toutefois en voici assez pour ce que vous en avez à faire.
Epicure disait des lois que les pires nous étaient si nécessaires que, sans elles, les hommes s’entremangeraient les uns les autres (d’après Plutarque). Et Platon, à deux doigts près, que sans lois, nous vivrions comme bêtes brutes ; et s’essaie à le vérifier. Notre esprit est un outil vagabond, dangereux et téméraire : il est malaisé d’y joindre l’ordre et la mesure. Et, de mon temps, ceux qui ont quelque rare excellence au-dessus des autres et quelque vivacité extraordinaire, nous les voyons quasi tous débordés en licence d’opinions et de mœurs. C’est miracle s’il s’en rencontre un rassis et sociable. On a raison de donner à l’esprit humain les barrières les plus contraintes qu’on peut. En l’étude, comme au reste, il lui faut compter et régler ses marches, il lui faut tailler par art les limites de sa chasse. On le bride et garrotte de religions, de lois, de coutumes, de science, de préceptes, de peines et récompenses mortelles et immortelles ; encore voit-on que, par sa volubilité et dissolution, il échappe à toutes ces liaisons. C’est un corps vain, qui n’a par où être saisi et assené (frappé) ; un corps divers et difforme, auquel on ne peut asseoir nœud ni prise. Certes il est peu d’âmes si réglées, si fortes et bien nées, à qui on se puisse fier de leur propre conduite, et qui puissent, avec modération et sans témérité, voguer en la liberté de leurs jugements au-delà des opinions communes. Il est plus expédient de les mettre en tutelle.
C’est un outrageux glaive que l’esprit, à son possesseur même, pour qui ne sait s’en armer ordonnément et discrètement. Et n’y a point de bête à qui plus justement il faille donner des orbières (œillères) pour tenir sa vue sujette et contrainte devant ses pas, et la garder d’extravaguer ni ça, ni là, hors les ornières que l’usage et les lois lui tracent. Par quoi il vous siéra mieux de vous resserrer dans le train accoutumé, quel qu’il soit, que de jeter votre vol à cette licence effrénée. Mais si quelqu’un de ces nouveaux docteurs entreprend de faire l’ingénieux en votre présence, aux dépens de son salut et du vôtre ; pour vous défaire de cette dangereuse peste qui se répand tous les jours en vos cours, ce préservatif à l’extrême nécessité, empêchera que la contagion de ce venin n’offensera ni vous, ni votre assistance. » (p.293 à 295, je souligne)
— Passage adressé à Marguerite de Valois, alors que rien n’indiquait jusque-là qu’il s’adressait en particulier à elle. Unique moment de l’Apologie dans lequel l’adresse au lecteur se particularise ainsi. Fort contraste avec le vague principe d’adresse formulé au début du chapitre ( « Parce que beaucoup de gens s’amusent à le lire, et notamment les dames, à qui nous devons plus de service, je me suis trouvé souvent à même de les secourir, pour décharger leur livre de deux principales objections qu’on lui a fait » p.140) et il est significatif que cette particularisation de l’adresse se donne dans le moment même où le propos de Montaigne se ramasse en lui-même pour formuler la méthode générale de l’ensemble de cet écrit. Il s’agit donc d’un discours de la méthode adressé, et pas à n’importe qui, à une personnalité de la famille royale. Fille de Catherine de Médicis et Henri II, sœur de François II, Charles IX et Henry III, elle est la femme de Henry de Navarre qui deviendra le roi Henri IV. Elle a joué un rôle crucial dans la mesure où son mariage arrangé avec Henri de Navarre en 1672 avait pour enjeu d’établir une alliance royale entre catholiques et protestants – cela fut un échec et le mariage s’est finalement soldé par le fameux massacres de la St Barthélémy ! Ajoutons qu’il est probable que Montaigne ait joué un rôle dans cette affaire, car il aurait été un négociateur entre le duc de Guise et Henri de Navarre en 1572, et a donc sans doute contribué à la mise en place de ce mariage politique. Ajoutons encore que Marguerite de Valois, malgré son mariage forcé avec le prince protestant, va se rallier plus tard à la Ligue, c’est-à-dire à la noblesse catholique à la tête de qui se trouvait la famille des de Guise, qui avait d’autant plus intérêt à laisser le cours des choses s’enfoncer dans la guerre civile qu’elle s’opposait au renforcement antiféodal de la centralisation du pouvoir royal. Celle qui sera surnommée au 19ème siècle la « Reine Margot » a donc pris une position très réactionnaire, et le discours de la méthode formulé par Montaigne prouve qu’il a une responsabilité dans le devenir réactionnaire de la future reine — préservatif à l’extrême nécessité contre l’expansion de la peste protestante! A la fois position très réactionnaire, mais aussi une vraie intellectuelle de son temps : on peut donc subodorer qu’elle ait été particulièrement sensible à la nouvelle arme intellectuelle que lui adressait Montaigne!
— Montaigne emploi trois métaphores qui donnent l’image de la méthode qu’il emploie dans tout ce chapitre : celle de l’escrime, celle des 14 Turcs et celle de Gobrias. En le lisant aujourd’hui, on est tout de suite frappé par l’absence d’une quatrième métaphore, qui pour nous est si évidente qu’il est clair que si Montaigne écrivait aujourd’hui, il l’aurait immanquablement employée, je veux dire la métaphore des kamikazes, de ceux qui se suicident d’une manière ou d’une autre de manière à entraîner leurs ennemis dans la mort avec eux ; un peu comme les 14 turcs, mais d’une manière telle que ce soit de l’ordre d’une volonté systématique. Il parlerait aujourd’hui au des kamikazes japonais de Pearl Harbor, ou des kamikazes afghans ou irakiens contre les armées occupantes occidentales. Ce sont là les coups désespérés de notre époque. Si on appelle cela du terrorisme, alors il faut qualifier de « terrorisme intellectuel » la méthode mise en place ici par Montaigne, et voir dans ce terrorisme intellectuel le fondement de tout le scepticisme moderne. Or c’est bien à un véritable suicide de la pensée que se livre Montaigne, comme moyen effectivement désespéré d’en finir avec la pensée protestante concurrente.
— Ce discours de la méthode permet de déterminer la nature de cette apologie paradoxale de la théologie naturelle de Raymond Sebond. En restituant les thèses de Sebond comme régime d’opinion courant des chrétiens, il requalifie complètement leur nature : les thèses sont intégralement fausses, parce qu’elles ne peuvent pas ne pas l’être à partir du moment où la raison tente de rationaliser l’objet de la foi. Mais leur fausseté ne les disqualifie pas pour autant, car ces thèses témoignent de la nécessité du faux. La raison à l’œuvre dans l’argumentation de l’ouvrage de théologie naturelle ne relève pas de la pensée, puisque Dieu est impensable, mais relève de l’opinion ou, mieux, de la croyance par les moyens proprement humains qui peuvent seuls, quoique faux, renforcer la foi qui elle n’est tributaire que de la pure révélation divine et surtout, pour le commun des mortels, que de la médiation de l’autorité établie de l’Eglise à laquelle il convient de se soumettre. Voilà une chose que le travail d’aujourd’hui doit permettre d’éclairer un peu.
Anthropomorphisme intrinsèque de la pensée, primat de la toute-puissance et enjeux et conséquences réelles de la critique de la religion :
« Qu’est-il plus vain que de vouloir deviner Dieu par nos analogies et conjectures, le régler et le monde à notre capacité et à nos lois, et nous servir aux dépens de la divinité de ce petit échantillon de suffisance qu’il lui a plu départir à notre naturelle condition ? Et, parce que nous ne pouvons étendre notre vue jusques en son glorieux siège, l’avoir ramené ça-bas à notre corruption et à nos misères ?
De toutes les opinions humaines et anciennes touchant la religion, celle-là me semble avoir eu plus de vraisemblance et plus d’excuse, qui reconnaissait Dieu comme une puissance incompréhensible, origine et conservatrice de toutes choses, toute bonté, toute perfection, recevant et prenant en bonne part l’honneur et la révérence que les humains lui rendaient sous quelque visage, sous quelque nom et en quelque manière que ce fût :
« Jupiter omnipotens rerum, regumque deumque progenitor genitrixque »
(Jupiter tout-puissant, père et mère du monde, des rois et des dieux ; Valerius Soranus cité par Saint Augustin).
Ce zèle universellement a été vu du ciel d’un bon œil. Toutes polices (sociétés) ont tiré fruit de leur dévotion : les hommes, les actions impies, ont eu partout les événements sortables (conformes au sort). Les histoires païennes reconnaissent de la dignité, ordre, justice et des prodiges et oracles employés à leur profit et instruction en leurs religions fabuleuses : Dieu, par sa miséricorde, daignant à l’aventure fomenter par ces bénéfices temporels les tendres principes d’une telle quelle brute connaissance que la raison naturelle nous a donnée de lui au travers des fausses images de nos songes.
Non seulement fausses, mais impies aussi et injurieuses sont celles que l’homme a forgées de son invention.
Et, de toutes les religions que Saint Paul trouva en crédit à Athènes, celle qu’ils avaient dédiée à une divinité cachée et inconnue lui sembla la plus excusable.
Pythagore adombra (peignit) la vérité de plus près, jugeant que la connaissance de cette cause première et être des êtres devait être indéfinie, sans prescription, sans déclaration ; que ce n’était autre chose que l’extrême effort de notre imagination vers la perfection, chacun en amplifiant l’idée selon sa capacité. Mais si Numa entreprit de conformer à ce projet la dévotion de son peuple, l’attacher à une religion purement mentale, sans objet prefix (déterminé) et sans mélange matériel, il entreprit chose de nul usage ; l’esprit humain ne se saurait maintenir vaguant en cet infini de pensées informes ; il les lui faut compiler en certaine image à son modèle. La majesté divine s’est ainsi pour nous aucunement laissé circonscrire aux limites corporelles : ses sacrements supernaturels et célestes ont des signes de notre terrestre condition ; son adoration s’exprime par offices et paroles sensibles ; car c’est l’homme, qui croie et qui prie. Je laisse à part les autres arguments qui s’emploient à ce sujet. Mais à peine me ferait-on accroire que la vue de nos crucifix et peinture de ce piteux supplice, que les ornements et mouvements cérémonieux de nos églises, que les voix accommodées à la dévotion de notre pensée, et cette émotion des sens n’échauffent l’âme des peuples, d’une passion religieuse, de très utile effet. » p234/235
— Qu’y a-t-il de plus vain que de vouloir penser Dieu pour le comprendre ? Ce qui est mis en cause, c’est la possibilité pour l’homme de penser quoi que ce soit de Dieu, la possibilité pour la pensée humaine d’avoir un quelconque accès à la connaissance de Dieu pour lui-même, c’est-à-dire à la connaissance de l’absolu dans l’absolu.
— La pensée procède par « conjectures » et « analogies », c’est-à-dire par hypothèses de ressemblances entre l’homme et Dieu. Penser Dieu, c’est nécessairement penser Dieu comme étant à l’image de l’homme. La connaissance est de l’ordre de l’analogie, de la ressemblance. Et Montaigne ajoute : « ce petit échantillon de suffisance qu’il lui a plu départir à notre naturelle condition » ; c’est ici de la « raison » qu’il parle, et en qualifiant la « raison » de « petit échantillon de suffisance », Montaigne destitue l’ancien statut de la raison et procède à sa naturalisation. Du point de son ancien statut, la raison était ce qui en l’homme singularisait absolument l’homme en regard de la nature et du règne animal ; ceci dans la mesure où la raison était ce qui en l’homme n’était pas naturel, la raison faisant ainsi fonction de lieu du divin en l’homme par quoi l’homme était dans le monde ce qui n’était pas de ce monde. Montaigne requalifie donc le statut de la raison et, requalifiant son statut, requalifie la nature de la raison elle-même.
— Le statut de la raison est requalifié dans la mesure où la raison est entièrement naturalisée en tant que raison humaine. Frédéric Brahami décrit très bien ce point dans son livre Le travail du scepticisme. La raison, pour autant qu’il s’agisse de la raison humaine, appartient à la condition naturelle de l’homme ; elle est par conséquent une raison naturelle. Or en tant que la raison humaine devient « raison naturelle », c’est la nature même de la raison qui change : la raison, en tant que raison naturelle, procède par « conjecture » et « analogies » ; ce qui veut dire que la raison naturelle est par essence, par nature, anthropomorphique. La raison naturelle de l’homme donne nécessairement à tout objet auquel elle s’applique la forme même de l’homme. Ce qui est une conséquence évidente ! A partir du moment où la raison est naturelle elle devient nécessairement relative à la nature de ce dont elle est la raison ! La naturalisation de la raison entraîne nécessairement la caractérisation anthropomorphique de la raison. Si la raison est naturelle, alors elle est nécessairement anthropomorphique (On remarquera quand même que cette conséquence logique présuppose autre chose : que l’origine naturelle de la raison détermine le caractère naturel de sa genèse ; que la généalogie de la raison est l’expression de son origine naturelle dans la mesure où on présuppose que tout ce qui est d’origine naturel reste nécessairement naturel en tout point de son devenir, et que par conséquent l’être de ce qui est, est exhaustivement déterminé par son origine. Mais laissons cela de côté pour l’instant.).
— Entendons-nous bien. En affirmant l’impossibilité pour l’homme de penser Dieu, de le connaître rationnellement, de le comprendre et d’accéder à son être par les moyens de la raison, Montaigne procède à une critique de l’anthropomorphisme de la pensée humaine de Dieu, prenant Dieu pour objet. Mais, ce faisant, il ne procède pas à une critique de l’anthropomorphisme en général. C’est là le point crucial. Il ne fait pas une critique de l’anthropomorphisme de la pensée pour en appeler à une pensée soustraire à sa dérive anthropomorphique, non, il assigne au contraire la pensée à l’anthropomorphisme comme étant sa caractérisation intrinsèque, sa détermination naturelle indépassable. La pensée ne peut pas ne pas être anthropomorphique. Et Montaigne va très loin dans cette affaire, la thèse est très radicale, au point que la thèse d’anthropomorphisme se double ou se généralise par une thèse de ce que je proposerai d’appeler le « choséomorphisme de la raison naturelle ». Je cite sur ce point un autre passage du chapitre :
« Il nous faut noter qu’à chaque chose (d’où : « choséomorphisme ») il n’est rien plus cher et plus estimable que son être (le lion, l’aigle, le dauphin, ne prisent rien au-dessus de leur espèce) ; et que chacune rapporte les qualités de toutes autres choses à ses propres qualités (la pensée procède par « analogie » quant aux qualités) ; lesquelles nous pouvons bien étendre ou raccourcir, mais c’est tout ; car, hors de ce rapport et de ce principe, notre imagination ne peut aller, ne peut rien deviner autre, et est impossible qu’elle sorte de là, et qu’elle passe au-delà. D’où naissent ces anciennes conclusions : De toutes les formes, la plus belle est celle de l’homme ; Dieu donc est de cette forme. Nul ne peut être heureux sans vertu, ni la vertu être sans raison, et nulle raison loger ailleurs qu’en l’humaine figure ; Dieu est donc revêtu de l’humaine figure.
« Ita est informatum, anticipatum mentibus nostris ut homini, cum de deo cogitet, forma occurat humana. »
(C’est à tel point une habitude et un préjugé de notre esprit que nous ne pouvons penser à Dieu sans nous le représenter sous une forme humaine ; Cicéron) ». P.259
« A chaque chose », d’où « choséomorphisme » ; et en effet, une autre conséquence de la naturalisation de raison humaine est que la raison va cesser d’être le propre de l’homme pour être rendue à la nature indépendamment de sa figure humaine et va être en partage avec d’autres être naturels, en particulier avec les bêtes, les animaux. Alors, avant de s’extasier pour ce trait de modernité qui passionne nos contemporains, et qui est pour le coup une thématique tout à fait centrale du scepticisme actuel, il faut en examiner scrupuleusement les conséquences. En particulier, il faut bien comprendre que l’incorporation de l’humanité dans l’espace de l’animalité va entraîner une conception d’autant plus anthropomorphique des animaux. On trouve dans l’Apologie de R.S. un très long passage, qui fait une quarantaine de pages, qu’on appelle en général le bestiaire, dans lequel Montaigne procède à un rapprochement systématique des hommes et des bêtes. On ne va pas l’étudier aujourd’hui, ce qu’on peut d’ores et déjà retenir c’est que l’interdit sceptique de la pensée prenant Dieu comme objet a pour corollaire un anthropomorphisme débridé concernant tout ce que la pensée a le droit de penser, c’est-à-dire tout le reste, tout le reste étant tout ce qui est dans la nature, tout ce qui est objet de l’expérience sensible et à commencer par les animaux. Le bestiaire est le lieu d’un anthropomorphisme d’autant plus débridé qu’il procède de l’interdit religieux de penser l’absolu. La destitution de la place séparée de l’homme dans la nature animalise l’homme, mais, animalisant l’homme, ouvre en réalité à une conception de l’animalité complètement rabattue sur ce que l’on connaît de l’homme, donc en définitive sur le déjà connu. En établissant une égalité entre l’humanité et l’ensemble du règne animal, Montaigne substitue à une conception inférieure des animaux une conception dans laquelle l’animalité est entièrement circonscrite dans la forme humaine, enfermée par l’anthropomorphisme débridé du bestiaire dans la figure de l’homme ; je ne suis pas certain pour ma part que les animaux y gagnent beaucoup dans l’affaire. Le passage d’un statut d’infériorité dans la hiérarchie des êtres à un statut d’égalité par fusion et encerclement dans la finitude de la forme humaine, je ne vois là personnellement aucun progrès notable pour la pensée, et si j’étais un animal non humain doué de raison, je crois que cela m’inquièterait plutôt qu’autre chose.
— J’attire enfin votre attention sur le terme d’ « imagination » employé dans l’extrait que je vous ai lu : la requalification du statut de la raison entraîne une requalification de la raison elle-même, qui entraîne à son tour une re-nomination de la pensée. La raison devient chez Montaigne « imagination », « fantaisie ». La raison, en tant que raison naturelle, cesse d’être la raison.
— La catégorie de « imagination » se substitue en définitive à la catégorie de « raison ». Sans approfondir aujourd’hui cette question, je formulerai simplement l’hypothèse que cette substitution est peut-être à l’origine de la nécessité pour la philosophie moderne de forger une nouvelle catégorie, celle de « sujet », qui relèvera l’ancienne catégorie de « raison » au point du renouvellement de la confiance accordée par l’humanité aux pouvoirs de la pensée par les moyens de son développement scientifique expérimental d’une part, et de sa légitimation philosophique argumentée d’autre part.
— En outre, que l’imagination se substitue à la raison revient ici au fait que la problématique propre de la pensée conçue comme imagination, outre son fonctionnement par analogie des qualités ou ressemblance des formes, est une problématique des limites. Alors que la raison était d’une certaine manière sans limite puisque capable de penser l’absolu dans l’absolu, donc capable de penser l’infini – puisque l’absolu, en tant que Dieu, est le lieu de l’infini séparé du monde fini tel que créé par Dieu – l’imagination quant à elle est intrinsèquement finie, limitée. Tout ce qu’on peut faire, écrit Montaigne, c’est « étendre et raccourcir » l’imagination. On peut étendre l’imagination par extension des analogies ou bien la raccourcir par limitation des ressemblances et vice versa, comme lorsque l’on s’interdit de prendre Dieu comme objet de l’imagination puisque, nous sachant voués au choséomorphisme de l’imagination, nous savons aussi par conséquent que ce serait blasphémer que d’étendre jusqu’à cette figure de l’absolu le domaine des analogies.
— Vous voyez aussi que la thèse de choséomorphisme de la pensée qu’il faut désormais appeler l’imagination se conclut par la reconstruction de la pensée humaine de Dieu, où Montaigne prétend montrer que toute pensée de Dieu est vouée à « le représenter sous une forme humaine », comme le dit Cicéron.
— Pour creuser plus avant mon commentaire du texte de Montaigne, je ferai mienne une thèse passionnante de Frédéric Brahami telle que formulée dans Le travail du scepticisme. Primat de la toute-puissance divine et destitution de la raison : venons-en au second paragraphe. Je pense qu’on accède ici au cœur du propos de Montaigne, parce qu’on touche ici à l’opérateur de fondation du scepticisme moderne. Cet opérateur, c’est la thèse de Dieu comme « puissance incompréhensible », c’est-à-dire, fondamentalement, comme toute-puissance. Ce point est renforcé par la citation de Valerius Soranus : « Jupiter tout-puissant, père et mère du monde, des rois et des dieux ».
— Pour entamer cette nouvelle investigation, je commencerai par une remarque. Il y a dans le monothéisme une difficulté fondamentale dès lors qu’il s’agit de penser Dieu, dès lors qu’il s’agit de comprendre ce que peut bien être cette figure singulière de l’absolu. Cette difficulté s’enracine dans l’opposition, la contradiction, entre au moins deux attributs divins classiques : l’attribut de l’absolue bonté de Dieu d’un côté, et l’attribut de l’absolue puissance de Dieu de l’autre. En effet, si Dieu est un être absolument parfait, à la fois tout puissant et toute bonté, comment expliquer que le mal existe dans le monde, comment expliquer que le malheur soit si manifestement et si universellement répandu sur la surface de la terre ? Face à cette grande question, cette suprême énigme théologique, il semble qu’il n’y ait que deux solutions rationnelles possibles : ou bien Dieu est tout puissant mais alors il n’est pas absolument bon, puisqu’étant tout puissant il laisse se répandre le mal alors qu’il pourrait l’abolir ; ou bien Dieu est absolument bon mais alors il n’est pas tout puissant, puisque l’existence du mal prouve l’impuissance de Dieu à universaliser sans reste le règne du bien sur terre. On peut retourner le problème dans tous les sens, on en reviendra toujours à ce choix spéculatif rationnel, c’est-à-dire à partir du moment où on présuppose l’existence démontrable ou indémontrable de Dieu comme Dieu unique. Ce problème-là est ce qui a donné lieu à la longue tradition des théodicées, la dernière grande proposition métaphysique de théodicée étant probablement celle de Leibniz. L’enjeu de toute théodicée est de lever la contradiction, en expliquant le caractère non contradictoire des deux attributs divins, c’est-à-dire en démontrant non par l’inexistence du mal, mais le caractère non contradictoire de l’apparente opposition entre existence du mal, toute bonté et toute puissance divine. D’une certaine manière il s’agira de démontrer que c’est précisément parce que Dieu est tout à la fois tout puissant et absolument bon qu’il laisse l’homme aux prises avec le mal sur terre. Raison pour laquelle on peut voir dans le Dieu de la théodicée une sorte de Dieu pervers.
— La seule manière d’échapper à cette difficulté, finalement, c’est de renoncer à penser. Car il s’agit bien d’une difficulté de la pensée, c’est-à-dire une difficulté dans la seule mesure où on cherche à comprendre rationnellement comment peuvent bien s’articuler le bien et la puissance dans l’absolu en regard de la situation réelle du monde tel qu’il est. Pour lever l’aporie, il faut donc renoncer à la pensée, renoncer à la compréhensibilité divine. Or que fait Montaigne dans ce passage ? Il déclare que l’opinion la plus vraisemblable est celle qui conçoit Dieu comme « puissance incompréhensible », « toute bonté » et « toute perfection ». Il articule donc trois attributs traditionnels, et sachant qu’il ne saurait y avoir d’absolue perfection de Dieu pour la pensée que dans l’harmonie entre les deux autres attributs, il va lever l’aporie constitutive de la double absolutisation de la bonté et de la puissance en désignant un des deux attributs comme incompréhensible, impensable. Il va donc faire porter le renoncement de la pensée, c’est-à-dire de la rationalisation de la figure de Dieu, en identifiant un des deux attributs comme opérateur du renoncement de la pensée. Evidemment, l’attribut qui va être ainsi désigné va devenir l’attribut central, il va devenir le centre de gravité de la figure de l’absolu puisqu’il va être l’opérateur de séparation entre l’homme et Dieu, entre la pensée et l’absolu. Or, l’attribut qu’il désigne ainsi est celui de la puissance. Dieu est tout puissant, mais d’une puissance incompréhensible, puisqu’étant par ailleurs toute bonté, il lui arrivera non pas tant de ne pas employer sa puissance pour empêcher le mal d’avoir lieu que de faire le mal pour des raisons obscures vouées à rester inconnues au genre humaine, définitivement inaccessibles à la raison humaine et naturelle. La rationalisation possible (l’imagination) du bien absolu a pour condition l’incorporation du mal dans la sphère de la puissance divine. Incorporation par elle-même rationnelle ! Si dieu ne pouvait pas faire le mal, il ne serait pas tout puissant puisque cette impossibilité constituerait une limite à sa puissance ! La toute-puissance a donc pour condition rationnelle la capacité au mal. Le caractère incompréhensible de l’absolue puissance ne provient pas de l’incorporation du mal dans sa sphère propre, mais, on va le voir, du fait que la notion même de toute-puissance est en vérité impensable.
— La question qui nous intéresse est de savoir en quoi la thèse du primat de la toute-puissance sur les autres attribut, primat qui se cristallise donc dans le choix de faire de cet attribut le cœur de l’incompréhensibilité divine, en quoi cette thèse va constituer l’opérateur de fondation du scepticisme moderne ? Eh bien, pour la raison que le primat de la toute-puissance va constituer l’opérateur central de destitution de la raison. Parce que pour l’instant on a commencé à voir à quel type de requalification de la raison donc de la pensée procédait Montaigne, on a vu aussi l’enjeu d’époque et la méthode générale, mais on n’a pour l’instant pas établi comment il s’y prenait, quel pouvait bien être le type d’argumentation à l’œuvre, donc l’espace théorique que tout cela dessine réellement.
— On peut me semble-t-il présenter les choses de la manière suivante : si Dieu est tout puissant, alors la puissance de Dieu n’est pas limitée par les lois de la pensée humaine. Les conditions de la rationalité ne sont pas les limites de la puissance divine. Par exemple, si la raison humaine et naturelle est régie par le principe de non contradiction, la toute-puissance est la puissance de la pensée paradoxale ou de l’action contradictoire. Si la puissance divine était régie par le principe de non contradiction, alors elle ne serait pas toute puissante puisque la pensée ou l’imagination peut concevoir une infinité de choses qui seraient hors de la portée de cette puissance. Autrement dit, si on prend à la lettre la notion de toute puissance, si on prend au sérieux son caractère d’absoluité, et si on soutient la thèse ou croyance de son existence effective, nous sommes forcés de reconnaître qu’une telle notion est à la lettre impensable. La toute-puissance est impensable car sa notion suppose pour être pensée d’outrepasser toutes les conditions de possibilité du pensable qui apparaissent comme autant de limites du point de la notion de puissance. Ce qui est une condition de possibilité de la pensée devient nécessairement une limite du possible pour la puissance : il y a incompatibilité radicale entre pensée de l’absolu et puissance absolue. Je pense qu’il faut creuser ce point, car mon intuition est que là gît peut-être une obscure raison pour laquelle il est historiquement (c’est une donnée fondamentale de l’histoire) si difficile de concilier pensée et puissance dans l’action humaine. Au point de l’absolu on touche précisément à une scission irréductible, un étrange noyau contradictoire, entre la pensée et la puissance, donc entre la pensée et l’action !
La puissance est ce qui de l’action n’est pas la pensée.
La rationalité est une condition de la pensée et une limite de la puissance. Ce qui est une condition sine qua non en regard de la pensée se donne comme limite pour toute forme de puissance.
Ou bien on a la capacité de la pensée à penser l’absolu, ou bien on a la puissance absolue, mais ce qui est impossible, ce qui constitue peut-être le réel de la vie humaine, son point d’impossible propre, c’est qu’on ne peut pas avoir les deux simultanément. Du point de l’absolu, entre pensée et puissance, il faut choisir, l’absolu se donne comme l’opérateur de scission de la pensée et de l’action. Pour autant, je pense que l’erreur à ne pas faire serait de croire qu’il faille renoncer à l’absolu pour réconcilier pensée et action. Au contraire, mon intuition est que si on abandonne la visée d’une pensée de l’absolu, alors on a tôt ou tard la figure d’une puissance absolue qui vient circonscrire et aliéner la vie humaine. Il faut choisir, et ce qu’on ne peut pas faire, c’est se débarrasser du choix. Se débarrasser du choix, c’est se débarrasser de la nécessité de penser le choix et c’est croire que l’homme est tout puissant au point de pouvoir se débarrasser du choix qui constitue le point de réel de son humanité, et par conséquent se débarrasser du choix, c’est en réalité choisir la puissance absolue. Entre absolutisation de la pensée et absolutisation de la puissance, il faut nécessairement choisir.
Absolutiser la pensée, c’est envisager les conditions rationnelles de toute pensée comme étant les limites réelles de l’être des choses.
Absolutiser la puissance, c’est a contrario envisager la puissance comme étant si puissante que ses possibilités ne sont pas bornées, limitées, par les règles de rationalité de la pensée.
Plus précisément, donc : si la toute-puissance est impensable alors seule l’absolutisation de la pensée – donc de ses conditions de rationalité envisagées comme des conditions de l’être même – peut avérer les limites de la puissance. A contrario, si la pensée est séparée de l’absolu, alors rien ne prouve que la puissance soit nécessairement limitée, rien n’empêche la thèse d’existence de la toute-puissance, ou la possibilité d’une absolutisation de la puissance qui soit à la fin telle que toute pensée devienne potentiellement vaine pour le vivant qui pense.
Est-ce à dire que Dieu soit dénué de la faculté de raisonner ? Non, car si Dieu est tout puissant il a la puissance de penser. Il y a donc une raison dans l’absolu, une raison de l’absolu, mais dont la raison humaine est séparée. Il y a scission de la figure de la raison, donc une disjonction entre raison et pensée : la raison divine n’est pas de l’ordre de la pensée dans la mesure où elle ne se donne pas sous la forme de propositions rationnelles, la rationalité n’étant qu’un moyen humain, non, la raison divine est de l’ordre de la révélation, c’est-à-dire du commandement absolu, de la prescription incompréhensible. La raison divine ne se donne donc pas pour l’homme sous la forme de la raison ; la raison humaine, à contrario, n’accède en rien à la pensée de Dieu, sinon à la pensée de l’impensabilité et incompréhensibilité de Dieu.
Raison humaine/raison divine : La raison « est en l’âme, et partie ou effet d’icelle : car la vraie raison est essentielle, de qui nous dérobons le nom à fausses enseignes, elle loge dans le sein de Dieu ; c’est là son gîte et sa retraite, c’est de là où elle part et quand il plaît à Dieu nous en faire voir quelque rayon, comme Pallas saillit de la tête de son père pour se communiquer au monde. » p.272
La conséquence est la suivante : penser Dieu, c’est penser l’impensabilité de Dieu. Il n’y a de pensée humaine de Dieu que sous forme critique. La raison humaine et naturelle, rapportée à l’absolu, est intégralement une critique de la pensabilité de Dieu, une destruction de toute prétendue compréhension du divin. Penser Dieu, c’est procéder à la critique de la pensée de l’absolu, c’est détruire tout rapport entre pensée (humaine) et absolu (divin), c’est disjoindre pensée et absolu comme le moyen d’opérer la dédivinisation de l’homme dont je parlais l’autre fois.
La naturalisation de la raison humaine refonde la pensée entière sur la critique, la raison naturelle est fondée sur la raison critique, la critique ayant à charge d’opérer la destruction de toute prétention affirmative de la pensée à penser l’absolu, la condamnation de tout énoncé affirmatif portant sur l’absolu.
C’est pourquoi Montaigne fait l’éloge du Dieu de Pythagore dans la suite du texte :
« Pythagore adombra (peignit) la vérité de plus près, jugeant que la connaissance de cette cause première et être des êtres devait être indéfinie, sans prescription, sans déclaration ; que ce n’était autre chose que l’extrême effort de notre imagination vers la perfection, chacun en amplifiant l’idée selon sa capacité. »
Mais il ajoute ceci, et c’est ça maintenant qui va nous intéresser :
« Mais si Numa entreprit de conformer à ce projet la dévotion de son peuple, l’attacher à une religion purement mentale, sans objet prefix (déterminé) et sans mélange matériel, il entreprit chose de nul usage ; l’esprit humain ne se saurait maintenir vaguant en cet infini de pensées informes ; il les lui faut compiler en certaine image à son modèle. »
— La thèse soutenue est celle de la nécessité de la religion. Il faut donc maintenant déterminer le rapport de Montaigne à la religion.
Une des dimensions constituantes des Essais est que Montaigne s’y livre à une critique de la religion, une critique particulièrement radicale, une critique qui est une relativisation de l’existence des religions. C’est ce qu’on retient souvent de la pensée de Montaigne, en concluant un peu vite que cette relativisation ouvrirait à une orientation morale de tolérance de la diversité des cultes fondés sur la liberté de conscience.
La relativisation de la religion par Montaigne va très loin, puisqu’il va jusqu’à déclarer le caractère radicalement contingent du rapport des hommes au culte religieux particulier dans lequel ils inscrivent leur vie, puisqu’il va jusqu’à reconnaître le caractère absolument fortuit de la religion à laquelle lui-même appartient, et admet sans réserve qu’il aurait pu naître à l’autre bout du monde, au fin fond du nouveau monde récemment découvert, et que si cela avait été le cas il aurait adopté un tout autre culte que le culte chrétien et qu’il aurait eu parfaitement raison de le faire. L’énoncé célèbre de l’Apologie de Raymond Sebond sur ce point est bien connu :
« Nous sommes chrétiens à même titre que nous sommes ou Périgourdins ou Allemands ». p146
L’identité chrétienne est une identité contingente comme une autre, ni plus ni moins que n’importe quelle identité nationale ou régionale (pour le dire dans nos termes actuels).
C’est donc à une relativisation tout à fait radicale et conséquente de la question religieuse que procède Montaigne. Seulement pour déterminer la valeur de ce geste théorique, encore faut-il regarder de près les enjeux et conséquences de tout cela et procéder à une démystification courageuse de ce qu’il en est du relativisme. Concernant la consistance de ce geste intellectuel de relativisation critique de la religion, il y a au moins trois grandes choses à établir :
1/ Pour comprendre ce qu’opère cette relativisation générale de la religion chez Montaigne, il faut commencer par réidentifier l’enjeu de tout ça. L’enjeu pour Montaigne, c’est de renforcer le pouvoir de l’Eglise catholique face à la menace protestante, c’est donc de défendre une religion, la religion catholique, en délégitimant la Réforme. Il peut paraître paradoxal de relativiser sa propre religion pour en renforcer le pouvoir, mais c’est bien de cela qu’il s’agit chez Montaigne, c’est cela qu’il faut arriver à comprendre. Et il est d’autant plus important de comprendre cela que cette opération constitue une matrice de la subjectivité sceptique qui opère aujourd’hui non pour la défense d’une religion, mais en faveur de la démocratie entendue comme régime politique parlementaire propre aux Etats occidentaux. Tout le monde connaît la célèbre formule de Churchill énonçant que « la démocratie est le pire des régimes à l’exception de tous les autres ». Or, si on devait résumer en une formule tout l’enjeu du scepticisme Montaigne, on pourrait dire que toute son entreprise consiste à montrer que la religion catholique est la pire des religions, oui, la pire !… à l’exception du protestantisme !!! C’est la première chose : le geste de relativisation a pour finalité réelle la justification de la légitimité de l’Eglise chrétienne face aux « nouvelletés » protestantes, donc Montaigne a pour objectif la condamnation théorique définitive de la Réforme.
2/ Le corollaire de la relativisation est l’intolérance envers toute prétention de la pensée à s’autoriser d’elle-même pour établir un critère de vérité conduisant à une nouvelle nomination événementielle – par exemple, « la Réforme » – c’est-à-dire conduisant à tenir une série de conséquences qui soient de l’ordre de la transformation radicale (de l’ordre des principes) de ce qui existe, de l’existant, ou de l’ordre d’effets entièrement nouveaux dans le monde. Autrement dit, la relativisation conduit à la destitution de toute pensée face à l’existant, une destitution qui se donne dans l’interdit proprement religieux pour la pensée de penser l’absolu ; ce qui veut dire encore que pour opérer cette relativisation générale de toute religion, Montaigne est obligé pour ce faire de détruire la pensée, de telle manière qu’à la fin des fin la pensée ne pense rien, puisqu’elle est en définitive une raison humaine et naturelle relevant de l’imagination ou de la fantaisie. Cela va avoir des conséquences très graves, puisqu’il ira jusqu’à soutenir dans l’Apologie la thèse selon laquelle « il n’y a point de science », donc la science n’existe pas en tant que science (ce qui n’empêche pas qu’elle puisse être utile en tant qu’imagination, qu’elle puisse être une fantaisie louable) ! Il y a ici apologie de l’obscurantisme ! L’exemple de Copernic !! Un des arguments qu’on peut lire dans l’Apologie, c’est que la thèse de Copernic selon laquelle c’est la terre qui tourne autour du soleil n’est qu’à mettre au crédit du jugement sceptique : cette thèse contredit la thèse traditionnelle qui affirme que le soleil tourne autour de la terre, ce qui ne prouverait rien d’autre que la propension de la pensée à soutenir une idée et son contraire, contradiction où la pensée s’annule car aucune thèse ne saurait être dans l’absolu plus vraie que sa contraire. En un mot, la relativisation se soutient d’une défiance envers la pensée qui soit telle que tout ce qui reste de la pensée à la fin des fins soit sa dimension critique et dénonciatrice.
Une parenthèse : clarifier l’essence du geste intellectuel de Montaigne dans tout ce qu’il a de franchement scandaleux ne me conduit nullement à défendre la Réforme et Luther. Sur ce point, il faut tout de même rappeler qu’après s’être scandalisé des dérives de l’Eglise, de ses corruptions devenues ordinaires, et refondé la foi sur la capacité individuelle de penser, Luther, contemporain des grandes révoltes paysannes enfoncées dans la misère et dont Thomas Münzer a été le plus célèbre chef de file, a écrit des tracts appelant les protestants au meurtre des paysan révoltés, affirmant que tout protestant qui tuerait un paysan surpris les armes à la main aurait une place au paradis. Se rebeller contre les Indulgences pour finalement proférer des appels au meurtre, je ne vois guère ce que tout cela a bien pu apporter de positif à la religion ! Luther est un peu comme nos républicains d’après la Révolution française : des hommes de gauche qui ont chaque fois installés leur pouvoir sur le massacre des ouvriers et des pauvres (1848, 1871 …).
3/ La relativisation a pour conséquence la requalification de la religion, de toutes les religions, comme étants non de l’ordre du vrai, mais de l’ordre du faux ; or, loin de conduire à la disqualification des religions, l’établissement du faux par relativisation a tout au contraire pour conséquence la thèse sceptique de la nécessité du faux. La religion est nécessaire non parce qu’elle est vraie, mais précisément parce qu’elle est fausse. C’est non seulement parce qu’une religion est de l’ordre du faux, qu’elle a non seulement légitimité à exister, mais encore qu’elle doit être envisagée comme étant nécessaire à la faiblesse inhérente à la condition humaine. Que la religion soit de l’ordre du faux ne la disqualifie pas, mais permet d’établir que le rapport de tout homme à sa religion doit être non de l’ordre de la pensée, mais de l’ordre de la soumission sans réserve à l’autorité religieuse.
La nécessité du faux, c’est la nécessité de se conformer et de conformer sa raison naturelle à l’existant – par exemple l’Eglise, l’Etat… – de s’y soumettre sans réserve, une fois que l’existant, renvoyé à son origine naturelle et contingente, est soustrait à toute prétention de rabaisser l’absolu à l’échelle humaine. La tolérance, si tolérance il y a, n’est jamais que la tolérance envers tous ceux qui acceptent de se soumettre sans réserve à l’existant, de se plier au joug des lois et du culte où ils vivent, non parce que ces lois sont justes et ce culte plus juste qu’un autre, mais précisément parce qu’il n’y a que des lois contingentes et des cultes fortuits, qui n’ont que faire de la justice et de la vérité, ces dernières devant de toute nécessité être reléguées dans la sphère de l’impensabilité divine et de l’impossibilité humaine. Voilà à quoi nous mène la relativisation de la religion par Montaigne. Montaigne, ailleurs dans les Essais, va jusqu’à affirmer que celui qui obéit aux lois parce qu’elles sont justes se trompe, c’est sa fameuse thèse du « fondement mystique des lois », par où l’obéissance à l’Eglise se généralise en culte de la soumission à l’ordre établi.
— D’une certaine manière, en dénonçant la corruption qui gangrène l’Eglise catholique et en proposant la conscience comme nouveau critère de vérité de la foi, le protestantisme met à nu le caractère radicalement contingent, fortuit, de la domination de l’Eglise. La réponse de Montaigne va être de refonder la légitimité de la domination catholique sur la base de la nécessaire contingence de la loi humaine religieuse. Il soutient l’énoncé : « notre devoir n’a autre règle que fortuite » p319, et ceci parce que l’origine de toute loi est elle-même nécessairement fortuite, hasardeuse, n’ayant rien à voir avec la nécessité car n’ayant rien à voir avec la vérité et la justice, puisque celles-ci sont intrinsèquement inaccessibles à la raison humaine entièrement naturalisée.
La nouveauté protestante est condamnable non parce qu’elle est fausse, ce qui supposerait qu’il y ait du vrai et du faux dans l’affaire, donc supposerait une discussion possible entre catholiques et protestants dont l’enjeu serait de démêler le vrai du faux en matière de foi religieuse ; la nouveauté protestante est condamnable non parce qu’elle est fausse, puisqu’il n’y a que du faux en matière de religion humaine, mais parce qu’elle est nouvelle et prétend à l’existence au détriment de ce qui existe déjà, sur la base d’un enjeu qui se veut de vérité et d’universalité. C’est donc à un conservatisme véritablement forcené en matière de religion que conduit la relativisation de la religion. La relativisation n’est pas un outil de remise en cause de la religion, mais un outil de son renforcement en période de crise et de grave division, singulièrement du renforcement de ce qui existe au détriment de ce qui prétend naître, venir à l’existence.
La relativisation est la conséquence de l’opération sceptique de destitution de la pensée. Ce qui nous apprend que la véritable essence du conservatisme n’est pas le dogmatisme comme on l’a trop longtemps cru à mon avis, mais le scepticisme. La pensée, dès lors que réduite à sa fonction critique, devient l’outil de justification de ce qui existe, l’arme de défense de l’existant, et ceci parce qu’une telle réduction de la pensée à la critique ayant pour base la naturalisation de la pensée, celle-ci devient logiquement un outil de naturalisation de ce qui existe. Défendre la religion comme nécessité du faux, c’est naturaliser la religion, la nature (humaine) étant l’unique lieu d’articulation possible entre le faux et la nécessité.
Clarification finale de la notion d’apologie : la théologie naturelle de Raymond Sebond doit être défendue non en tant que les thèses qui la composent sont vraies, mais en vertu même de leur fausseté, c’est-à-dire en vertu du fait qu’elles relèvent d’une raison humaine et naturelle qui est une catégorie non de la foi qui ne saurait relever de la pensée, non de la pensée si on entend par pensée la capacité de connaître une chose pour elle-même, qu’il s’agisse d’une chose naturelle ou absolue, mais une catégorie de l’opinion commune ou de la croyance ordinaire (je ne distinguerai pas – pour l’instant – entre croyance et opinion, mais cela suppose une double distinction entre opinion et pensée d’une part, et entre foi et croyance d’autre part) en tant que tissant un lien humain au divin sans lequel la vie humaine placée sous le signe d’un Dieu impensable réduit à son pur noyau symbolique de lieu absolu de la révélation, vouerait l’humanité à une vie invivable et désespérée. L’apologie est donc une apologie du faux en tant que condition réelle de subjectivation de la foi pour le vulgaire et donc d’acceptation sans réserve de l’autorité de l’Eglise par le commun des mortels. Les arguments de théologie naturelle proposés par Sebond sont louables non parce qu’ils sont vrais, mais parce que, quoique complètement faux, ils n’en travaillent pas moins en direction du renforcement de l’autorité de l’Eglise, dans la mesure, donc, où ses thèses sont toutes orientées par la soumission aux lois de l’Eglise et aux cultes chrétiens traditionnels.
Télécharger le texte en pdf :