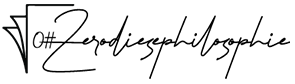Cours de philosophie de Julien Machillot
Ecole des Actes – 1er février 2020
1
Les conditions anthropologico-ontologiques de l’espace subjectif de la poésie hölderlinienne : le Divin
Le cadre général de mon cours de cette année, à l’intérieur duquel je veux inscrire le travail sur l’œuvre poétique de Hölderlin, est la tentative de penser l’humanité comme vide et comme prescription. Concevoir l’humanité comme étant fondée sur un vide et non pas sur un plein. Concevoir l’humanité comme plein, c’est l’envisager comme relevant d’une identité stable et objective qui s’imposerait à tous comme de l’extérieur. Concevoir l’humanité comme vide signifie donc d’abord refuser d’entrer dans la question de l’humanité par l’hypothèse d’une objectivité identifiable. Mais cela signifie alors entrer dans une démarche beaucoup plus subjectivée, non pas scientifique mais philosophique, où la question à laquelle on est immédiatement confrontée est celle de savoir si l’humanité ne serait pas le nom d’une prescription : est-ce que la notion même d’humanité n’est pas en elle-même porteuse d’une prescription pour tous les êtres-humains ?
Ce qui rend pour moi possible l’inscription de la lecture de Hölderlin dans ce cadre philosophique général est le livre encore inédit écrit par Judith Balso : Ouvrir Hölderlin, qui est un véritable Hölderlin sans Heidegger – ce qui devait être initialement le titre du livre. C’est donc sous la condition de ce grand livre que se développera tout mon travail de cette année.
Dans le cadre de cette investigation qui va exiger au moins deux ans de travail et de cours, le principal adversaire à combattre ne va pas être le scepticisme en général mais une modalité très singulière du scepticisme qu’on appelle l’humanisme. Ce sera d’ailleurs une de mes thèses fondamentales, dont je proposerai une démonstration : l’humanisme, en particulier l’humanisme contemporain, est nécessairement un scepticisme – donc un ennemi.
Il y a plusieurs raisons pour lesquelles c’est maintenant que je veux commencer à entrer dans cette adversité spécifiée.
Premièrement, une raison assez naturelle, provenant de ce que traiter de la question de l’humanité comme vide et comme prescription situe immédiatement la pensée philosophique sur le terrain de la question anthropologique. Or, l’humanisme est précisément ce qui entend placer l’homme au centre de la pensée philosophique, il est plus précisément ce qui place l’homme en position de fondement de la pensée. Si par conséquent il s’avère que l’humanisme ainsi conçu est nécessairement un scepticisme, alors mon problème devient celui de fonder une sorte d’anthropologie philosophique en rupture avec le scepticisme qui semble précisément se nourrir de toute tentative de centrer l’investigation philosophique sur la notion même d’humanité. Il y a donc ici une sorte de nœud qui semble à première vue inextricable, qu’il conviendra de dénouer patiemment.
Deuxièmement, il y a deux ans maintenant j’avais décidé de travailler sur un problème conjoncturel qui m’inquiétait beaucoup, celui de l’enfermement, de la prise en tenaille dans laquelle la doxa contemporaine se laissait encercler entre l’animalisme et le transhumanisme, qui se donnait comme une sorte de choix idéologique massivement imposé entre dimension sceptique de la réduction de l’humanité à son animalité et dimension carrément fasciste de l’ « augmentation » (puisque c’est le terme consacré) de l’humain par les moyens de la biotechnologie. Ce travail a été fondamental pour moi car ce qui s’est éclairé est la nécessité je crois pour la philosophie contemporaine de renouer avec la vieille question de la différence anthropologique, différence humain/animal d’un côté et différence humain/dieux de l’autre, cette deuxième détermination différentielle étant substituée aujourd’hui par la différence humain/machine. Or à ce moment-là je me suis sentie obligé, pour poser les premières fondations d’une refonte possible de la question de la différence anthropologique, de m’appuyer au moins temporairement sur certains des arguments d’humanistes contemporain, en particulier de Francis Wolff, qui étaient très éclairants sur ce problème. Il n’y a pas à le regretter, cela correspond tout à fait à une grande règle stratégique qui était en particulier celle de Mao et des communistes chinois, qui veut que quand on a deux adversaires, on ne peut pas combattre sur tous les fronts à la fois, qu’il faut donc s’allier temporairement avec le moins pire pour combattre le pire, avant de régler son compte à celui qui se présente en définitive comme l’adversaire principal. En grand stratège philosophe, je me suis temporairement allié à l’humanisme contemporain pour mettre à distance le doublet ultra-dangereux animalisme/transhumanisme, et maintenant il faut régler son compte à l’humanisme, ce qui est sans doute maintenant une condition pour pouvoir aller plus loin dans le travail sur animalisme/transhumanisme.
Troisièmement, l’ennemi philosophique suprême reste bien le sceptique, et j’entends démontrer que l’humanisme est une variante du scepticisme. Ça signifie qu’il ne faut pas prendre le scepticisme comme un courant d’opinion unique particulier. Le scepticisme est plutôt un régime général d’opinion – c’est ça que j’appellerai « doxa » – qui totalise toute une série d’opinions qui n’apparaissent pas immédiatement comme compatibles entre elles, qui parfois s’opposent, et même parfois violemment. Que le scepticisme soit le nom de l’idéologie dominante ne veut pas dire qu’il s’agirait d’un courant d’opinion unique. Il y a des guerres intrasceptiques, il existe des contradictions au sein du scepticisme qui ne sont donc pas des contradictions antagoniques, mais qui peuvent dégénérer quand même. Le scepticisme en tant que nom de la doxa « démocratique » contemporaine est une totalisation que seul un travail de filtrage philosophique extrêmement affiné peut réaliser jusqu’au bout. Et je dirais que l’humanisme touche, dans la conjoncture actuelle, à ce qui se présente au sein du consensus général autour du mot « démocratie », au consensus plus resserré qui fait tant de ravages actuellement qui est le consensus « républicain », le consensus violent et désormais quasi tyrannique en vérité autour du mot « République », « valeurs républicaines » et autres saloperies de la même engeance. D’ailleurs, ce consensus a ses théoriciens, qui sont des théoriciens « critiques » comme il se doit, puisque la « critique » est précisément le nom de la modalité de ralliement des intellectuels aux courants idéologiques dominants. On a eu notamment récemment coup sur coup un ouvrage de Francis Wolff Plaidoyer pour l’universel qui est la tendance rationaliste de l’humanisme sceptique et le livre de Frédéric Worms Pour un humanisme vital qui représente quant à lui la tendance vitaliste (encore plus ennuyeuse que le rationalisme) de l’humanisme sceptique contemporain. Livres mineurs mais sur lesquels je m’appuierai.
L’humanisme, donc, est une cristallisation du scepticisme. Or le scepticisme, il faut toujours garder en vue sa caractérisation la plus générale. Au fond, le scepticisme, singulièrement le scepticisme contemporain, c’est l’idée que la vraie vie n’existe pas. Seule la vie existe, et la vie ne se laisse nullement mélanger avec je ne sais quelle notion de vérité, avec je ne sais quelle idée portée par le vocable « vérité ». Le scepticisme procède de la séparation de la « vie » et de la « vérité ». La vérité est conçue comme une violence faite à la vie, et la « vraie vie » fait figure de syntagme totalitaire. L’amour vrai n’existe pas, ou alors la science « prouverait » qu’il durerait deux ou trois ans au maximum ; la politique vraie n’existe pas, ce qui existe, ce sont les jeux empiriques de pouvoir ; la science vraie n’existe pas, au sens d’un accès réel à l’extériorité, au sens d’un accès effectif à la connaissance du grand dehors ; l’art vrai n’existe pas, ce qui existe, ce sont de purs jeux de langage, d’image, de son, etc. En un mot, la vérité – plus précisément les vérités absolues – n’existe pas. C’est là son leitmotiv sans doute le plus invariant. Le scepticisme est ainsi fondé sur une thèse d’inexistence.
Telles sont les raisons pour lesquelles l’humanisme sera l’adversaire principal de mes prochaines interventions.
Aujourd’hui il y a un point commun entre ce qu’on peut appeler d’un côté l’humanisme, en tant qu’il s’agit d’un humanisme critique ou d’opinion, et ce qui se revendique de l’autre de plus en plus comme animalisme, ou en tout cas comme antihumanisme, ce qu’on peut appeler un antihumanisme sceptique ou relativiste. Ce point commun, c’est de penser l’humanité comme plein, et comme relevant de traits purement descriptifs. L’humanisme soutient évidemment la thèse de la différence anthropologique, c’est-à-dire la thèse d’existence d’une séparation objectivement déterminable entre d’un côté l’espèce humaine et les autres espèces animales, et de l’autre entre l’espèce humaine et les machines, aussi biotechnologiques soient-elles. L’antihumanisme consiste au contraire à nier qu’il existe une telle différence anthropologique, il consiste en général principalement, dans sa tendance animaliste, à effacer la frontière entre l’espèce humaine et au moins certaines espèces animales, dans le but général de démontrer qu’au fond l’homme serait un animal comme les autres, c’est-à-dire qu’il n’y aurait entre les animaux humains et les autres animaux que des différences de degré et non des différences de nature. Mais là où l’humanisme considérait qu’il y avait une différence objectivement déterminable entre espèce humaine et autres espèces animales ou vivantes, l’antihumanisme à son tour considère qu’il y a une indifférence (au sens d’une absence de différence) tout aussi objectivement déterminable. Autrement dit, la guerre entre humanisme et antihumanisme se place aujourd’hui entièrement sur le terrain de l’objectivité. L’objectivité consiste à envisager l’humanité selon ses facultés positives générales (facultés de parler voire de penser – la raison – et facultés de fabriquer des outils et des technologies etc.), donc à décrire de manière supposément objective, prétendument neutre, des propriétés positives qui soient des propriétés d’espèce. Cela revient par conséquent à s’interroger sur la question de l’identité de l’espèce humaine. Est-ce qu’il y a un propre de l’homme ou non ? S’il y a un propre de l’homme, il faut identifier les propriétés positives de ce « propre » à partir duquel il sera possible de différencier objectivement l’humanité d’autres espèces animales. A contrario, si on arrive à démontrer que tout ce que l’homme croyait avoir en propre, par exemple le langage ou la raison ou même la capacité de créer, la culture, etc., existe en fait chez d’autres espèces animales, fût-ce de manière moins développée, alors on conviendra qu’il n’y a pas de propre de l’homme, qu’il n’y a rien qui identifie l’homme en propre, donc comme espèce singularisable, et par conséquent on conclura qu’il n’y a pas de différence anthropologique, et que l’homme est un animal comme un autre. Dans les deux cas on est sur le même terrain d’une démarche objectivante ou supposément objective pour laquelle le recours aux données scientifiques est de rigueur – démarche qui s’appuie plus ou moins honnêtement sur la science, avec de ce point de vue une rigueur certainement beaucoup plus grande du côté de l’humanisme que de l’antihumanisme animaliste (les animalistes sont des idéologues très bavards mais en général de piètres scientifiques, tandis que les humanistes sont pour la plupart de bien faibles et ennuyeux idéologues, mais souvent dotés d’une forte culture scientifique), et l’opposition de l’humanisme et de l’antihumanisme se cristallise sur la question de l’existence ou non d’un propre de l’homme – au sens de propriétés positives déterminables, dont les différentes facultés attestables – et finalement cette opposition porte sur la question de l’identité humaine en tant qu’identité d’espèce. Donc le terrain idéologique est un terrain identitaire dans lequel la démarche objectivante se cristallise sur la question du propre. Cette question du propre étant ce qui donne à la question de l’identité sa dimension immédiatement universelle. En effet, si l’humanisme parvient à prouver qu’il existe un propre de l’homme, alors il aura par là même démontré qu’il y a une identité universelle de l’espèce humaine, c’est-à-dire une identité en partage par tous les êtres humains et exclusivement par les humains. A ce titre, l’humaniste est un universaliste, mais la thèse d’universalité qu’il soutient est très particulière car elle montre le caractère en quelque sorte oxymorique de l’humanisme, puisqu’on a affaire avec lui à une conception strictement identitaire de l’universel. Or, la notion d’ « identité universelle » est un oxymore : l’identité est toujours particularisante, elle est ce qui par définition rompt l’universel ; et à l’inverse l’universel est ce qui par définition neutralise les séparations identitaires, les particularités, en les subsumant sous ce qu’elles ont, à leur insu et malheureusement souvent à leur grand scandale, de commun. Or, en effet, tout le propos de l’humanisme consiste à montrer ce que toute l’humanité a universellement en propre de manière à particulariser l’espèce humaine au sein du règne animal. Pour le dire autrement, et d’une manière qui va beaucoup nous intéresser ultérieurement, l’universel humaniste est un universel identitaire parce que cet universel est entièrement désabsolutisé. Ce qui s’oppose à l’identitaire ce n’est jamais seulement l’universel en tant qu’universel, mais toujours l’universel dans ce qu’il a d’absolutisable. Pourquoi ? Pour le dire d’abord avec le terme de « relatif » d’une manière dont on verra ensuite qu’elle est insatisfaisante et inappropriée : parce que la dimension particularisante de l’identité, de toute identité, c’est qu’elle est toujours relative à ce dont elle est l’identité : il n’y a d’identité humaine, fût-elle universelle, que pour autant qu’il y a l’humanité. Tandis que l’absolu est par définition au moins négativement ce qui n’est pas relatif. Par conséquent, la dimension absolue d’un universel est ce qui de l’universel n’est pas relatif à ce dont il est l’universel. Pour le dire autrement, d’une manière cette fois plus rigoureuse, lorsque l’universel est soustrait à toute dimension d’absoluité, il est nécessairement de l’ordre d’une identité à soi. Tandis que l’absolu est ce qui introduit dans l’universel une dimension de non identité à soi, une sorte de séparation ou de distance intérieure de l’universel avec lui-même. On peut encore le dire autrement : l’universel désabsolutisé cristallise la figure d’un plein. L’identité humaine, entendue comme son propre, c’est l’ensemble des déterminations objectives et positives dont on pourrait dire qu’elles « remplissent » l’humanité et la constituent dans son universalité particularisante. L’humanisme est donc une conception de l’humanité comme plein, comme identité à soi. Par contre, l’absolu est ce qui introduit non un plein mais un vide au cœur de l’universel. Si on pouvait démontrer, et c’est précisément le but de mon travail, qu’on peut penser l’humanité comme relevant d’une universalité pour part absolutisable, alors on aura élaboré une conception de l’humanité non plus comme plein mais comme vide. Or l’humanité comme vide ne peut plus seulement relever d’une description objective, puisque précisément l’objectivité descriptive est l’opérateur principal de toute détermination d’un plein, d’une universalité de type identitaire et en particulier elle est l’opérateur principal de toute détermination humaniste de l’humanité comme plein. Or si le vide – c’est-à-dire la non-identité universelle à soi – ne peut être déterminé par un opérateur de description, cela signifie qu’il devra l’être, si on parvient à en démontrer la possibilité, par un opérateur de prescription. Penser l’humanité comme vide, c’est nécessairement penser l’humanité comme prescription ; non plus comme une identité pleine aux traits objectifs descriptibles, mais comme un universel dont la dimension absolutisable soit la mesure de ce que l’humanité recèle d’auto prescription. Pour fixer les termes et enfoncer le clou, je dirai donc que le but du cours de cette année est de penser l’humanité comme vide et comme prescription, et par conséquent de penser l’humanité non comme un universel de type identitaire, mais comme ce qu’on appellera un « universel générique ». J’entends donc ici par « universalité générique » un universel comportant en lui une dimension d’absoluité, donc constitué en son sein par un vide, une figure de non identité à soi. Or je suis convaincu, au vu du livre que Judith Balso a écrit sur Hölderlin, que se mettre à l’épreuve de penser philosophiquement sous condition de la poésie de Hölderlin constitue une excellente entrée en matière pour commencer à s’acheminer vers ce but lointain et exigeant.
Précisons encore les choses : le tort commun de l’humanisme et de l’animalisme est d’envisager l’humanité dans la plénitude de ses facultés ou propriétés positives, conduisant soit à l’envisager dans son illusoire identité à soi (l’humanisme), soit dans sa non moins illusoire absence d’identité à soi au nom de sa dissolution dans une identité plus large (l’animalisme est à ce titre une idéologie qui n’est pas moins de type identitaire que l’humanisme, au sens où n’y existent en définitive que des identités objectivables). J’ai ajouté qu’au vrai, ce n’est pas en termes d’identité, mais en termes générique, qu’il convient seul de penser le statut ontologico-anthropologique de l’humanité, c’est-à-dire à la fois anthropologique et ontologique, ce qui suppose la thèse d’une compatibilité entre les deux – c’est à dire d’une articulation positive possible entre la question de l’être en tant qu’être et la question de l’être de l’humanité. Or ce que je constate pour ma part, c’est que toute anthropologie philosophique dans le champ intellectuel contemporain se présente presque systématiquement comme une opération de type anti ontologique. Tout enjeu anthropologique dans la philosophie contemporaine constitue une rupture dite « critique » parce qu’en son fond kantienne avec toute prétention ontologique de la philosophie. C’est anthropologie contre ontologie. L’anthropologie philosophique critique contemporaine consiste en effet dans son principe à déterminer les limites de la pensée et de l’action humaine : à montrer en particulier que l’humanité est impuissante à penser l’être en tant qu’être, parce que la conscience ou le langage constitueraient autant d’obstacles infranchissables à tout accès à l’extériorité de l’être ; à montrer que l’homme ne peut pas transformer politiquement le monde au point de sortir du capitalisme, car ce serait outrepasser les limites de la prétendue nature humaine telles qu’elles s’exprimeraient dans le caractère supposément naturel du capitalisme, c’est-à-dire des bases du monde tel qu’il est. A contrario, toute ontologie, tout renouement avec l’enjeu philosophique de fondation d’une ontologie contemporaine se solde par la destitution de toute entreprise anthropologique de type philosophique. L’anthropologie relève dans ce cas des seules sciences, et le seul problème qui se pose au philosophe est alors celle de la compatibilité globale de son ontologie avec l’anthropologie scientifique. Donc l’enjeu de penser l’humanité comme vide et comme prescription, c’est aussi pour moi l’enjeu de rompre avec cette rupture systémique de l’ontologie philosophique et de l’anthropologie philosophique, parce que je veux d’un côté assumer pleinement la haute prétention ontologique de la philosophie et en même temps je pense qu’il est absolument nécessaire aujourd’hui, pour les raisons évoquées plus haut, de penser à de nouveaux frais la différence anthropologique, dans un contexte idéologique marqué par l’animalisme et le transhumanisme. Or, je pense que seule cette dimension intrinsèquement générique de l’humanité, seule l’idée du vide comme la constituant comme humanité, permet de concevoir une anthropologie philosophique qui ne soit pas un énième opérateur antiontologique, c’est-à-dire qui ne soit ni antiuniversaliste, ni faussement universaliste. L’anthropologie philosophique aura alors je crois comme vertu suprême de mettre enfin dos à dos antiuniversalisme faux et faux universalisme, c’est-à-dire antihumanisme relativiste et humanisme critique. C’est pour moi un des grands enjeux de la philosophie contemporaine.
Donc ce que je veux commencer à faire aujourd’hui, c’est penser philosophiquement sous condition de Hölderlin sans me situer dans les suites de l’incorporation heideggérienne de la poésie hölderlinienne, sous l’hypothèse que c’est précisément ce que la médiation du livre écrit par Judith Balso permet. Judith Balso parvient, pour la première fois de façon aussi radicale et définitive, à arracher Hölderlin à son interprétation heideggérienne archi-dominante. C’est une prouesse qu’il faut saluer.
Or dans la traversée de l’œuvre de Hölderlin qu’elle propose tout au long de son livre, la poésie apparaît comme la conquête chaque fois renouvelée, à travers de multiples difficultés et obstacles, d’une confiance fondamentale en l’humanité. Non pas d’une confiance en une nature humaine supposée bonne, ce qui ne serait que la reconstitution de l’humanité comme plein – l’humanité vivant dans la plénitude de sa nature n’ayant qu’à exprimer ce qu’elle est déjà – mais d’une confiance en quelque sorte plus opératoire, confiance en une capacité et non pas en une nature, confiance en « la capacité des hommes à vivre et à marcher sur terre comme des dieux ». C’est là le leitmotiv, si je puis dire, du livre de Judith. Il s’agit donc d’une confiance en une figure de l’excès, confiance dans la capacité de l’humanité à excéder ce qu’elle, devenant ainsi, au moins provisoirement, ce qu’elle n’est pas en tant que telle. La poésie hölderlinienne et même l’ensemble de ses écrits (écrits théoriques, traductions, roman, etc.) peut donc être envisagée comme une recherche incessante, je cite Judith, des « conditions d’une confiance possible en ce qui dans l’homme excède l’homme en direction d’un Bien commun ».
Je dirai à partir de là que l’univers hölderlinien dessine un espace subjectif très singulier qu’on peut essayer de restituer de manière synthétique.
Pourquoi « espace subjectif » ? Il faut distinguer « espace subjectif » et « figure de sujet ». (Je reprends la notion d’« espace subjectif » au séminaire d’Alain Badiou Théorie axiomatique du sujet.) La notion d’espace subjectif, c’est l’idée que quand quelque chose se passe, quand un événement a lieu – par exemple pour Hölderlin la Révolution française dont il est le contemporain – on n’a pas tant affaire à l’émergence d’un sujet qu’à celle d’une configuration subjective constituée d’une multiplicité de positions subjectives différenciées. La notion d’espace subjectif réinjecte le multiple au sein de la théorie du sujet. Il faut donc rendre philosophiquement compte de cette configuration, de sa complexité interne, même si l’enjeu de tout ça est bien en définitive de faire valoir pour tous une figure de sujet déterminée, la seule et unique figure subjective qui puisse être universellement envisagée comme relevant de la vraie vie en tant que c’est aussi la vie du vrai, la vie créatrice de vérité. Mais par ailleurs il faut tenir compte du fait que les figures d’adversité et de réaction éventuelles sont aussi des figures de sujet dans la mesure où elles sont aussi obligées de s’élaborer, de s’inventer en quelque sorte, sous la condition de l’événement qu’elles veulent nier, barrer, c’est-à-dire combattre. Pour que la négation de l’événement ait une chance de fonctionner, il faut bien tenir compte, quelque part, de l’événementalité de l’événement. Donc l’espace subjectif a pour enjeu de penser l’ensemble des figures positives ou négatives de sujet qui apparaissent sous la condition événementielle.
L’idée que le corpus des créations de Hölderlin forme un ensemble identifiable comme élaboration d’un espace subjectif incorporable aujourd’hui par la philosophie, c’est la thèse que je soutiens qui se dessine à la lecture du livre de Judith Balso. C’est d’autant plus passionnant que cela ouvre à tout un tas de problèmes, et d’abord, pour commencer, avant même d’explorer l’intérieur de l’espace subjectif lui-même, cela ouvre à ce qu’on peut appeler le problème de l’ancrage ontologique, ou anthropologico-ontologique, de l’espace subjectif hölderlinien. Quelle est l’ontologie sur laquelle s’articule cet espace subjectif ? C’est-à-dire quelle est l’intuition fondamentale de l’être dont se supporte la poésie de Hölderlin ? Je dirais qu’il y a un triple ancrage ontologique et anthropologique de l’espace subjectif hölderlinien, à travers les trois notions que sont : la Grèce, plus précisément la Grèce antique ; la Nature, qui est à la fois celle de la Grèce et celle de l’Allemagne ou plus précisément de la région natale de Hölderlin – la Souabe – ; et le Divin ou les dieux, donc un divin séparé du monothéisme chrétien (qu’il soit protestant ou catholique) dont le poète est le contemporain, un divin se nourrissant du polythéisme de l’antiquité grecque.
On a donc un triangle (isocèle ou équilatéral peu importe) mais un triangle orienté, comme en témoigne la flèche. L’espace subjectif a trois bords, la Grèce antique, en tant que bord anthropologique, en est la base ; la Nature et le Divin forment les deux bords ontologiques de l’espace, et celui-ci est tout entier orienté vers le point de jonction de la Nature et du Divin, point de jonction appelé Beauté. Donc la Grèce antique, la Nature et les dieux composent les trois bords anthropologico-ontologiques de ce qu’on appellera l’éthique hölderlinienne des vérités, les trois bords qui ancrent cet espace subjectif orienté dans l’être. Outre ces trois bords qui dessinent les limites de l’espace subjectif, on a un quatrième terme, vers lequel pointe la flèche qui relie la Grèce à la jonction Nature/Divin, ce quatrième terme c’est le présent dont Hölderlin est le contemporain, à savoir la Révolution française. Que l’espace subjectif soit orienté vers la Révolution française signifie que l’enjeu de la poésie pour le poète est de se tenir dans la fidélité subjective la plus forte et rigoureuse, la plus intense et exigeante, à ce qui s’est donné dans la Révolution française comme figure entièrement renouvelée de la capacité humaine au divin. Judith Balso montre dans son livre qu’il est absolument crucial pour élucider le sens de l’ensemble des questions que traite Hölderlin dans sa création poétique continuée de resituer l’importance centrale de la Révolution française pour le poète. Et il y a eu dans l’amitié de Hölderlin/Hegel/Schelling un véritable enjeu de fidélité à la Révolution française, Schelling étant celui qui va se débarrasser de l’enjeu de fidélité, la question étant beaucoup plus complexe s’agissant de Hegel qui gardera jusqu’au bout un élément de fidélité irréductible à l’événement dont il a été contemporain avec ses pairs dans sa jeunesse. Mais Hölderlin a été celui pour qui la question de la fidélité a été la plus brûlante, la plus tendue. Dans l’amitié intense qui a lié les trois jeunes intellectuels au moment de leurs études, Hölderlin n’était pas seulement le poète du groupe alors que les autres étaient philosophes, il était aussi le plus farouchement militant. Comme si la poésie finalement permettait à Hölderlin une intensification de l’engagement dans les idées politiques, là où la philosophie s’est rapidement présentée comme le lieu d’une trop grande prudence, d’une mise à distance un peu équivoque, peut-être suspecte, du feu de l’événement. En même temps, il faut garder à l’esprit qu’avoir des idées révolutionnaires en Allemagne à l’époque, c’était risquer gros, c’était prendre le risque de se retrouver durablement au fond d’un cachot – ce qui a d’ailleurs bien failli arriver à Hölderlin !
A partir de là, les trois grandes séries de questions qui se posent concernant La Grèce, la Nature et le Divin, quand on cherche à penser philosophiquement sous condition de l’œuvre de Hölderlin, c’est celle de leur statut anthropologico-ontologique exact dans la poésie hölderlinienne.
1/ Quel est le statut ontologique et éthique du divin et des dieux chez Hölderlin ? Est-ce que ce statut ontologico-éthique est assimilable à un statut théologique à proprement parler ? Quel est le statut que la poésie donne au divin ? Par ailleurs, est-ce que les dieux doivent exister (au sens propre) pour qu’on puisse affirmer qu’il y a un être du divin ? C’est la question des rapports entre l’être et l’existence dans le divin. Et enfin y-a-t-il quelque chose qu’on puisse appeler les dieux et le divin aujourd’hui ?
2/ Quel est le statut ontologico-éthique de la nature chez Hölderlin ? Y-en-a-t-il une actualisation rationnelle possible pour aujourd’hui, constituant éventuellement une réponse forte aux conceptions écologiques contemporaines de la nature ?
3/ Quel est le statut cette fois anthropologico-éthique de la Grèce antique ? Qu’est-ce qui fait que la Grèce antique constitue un garant aussi crucial et central, aussi invariant et brûlant, dans la subjectivité de Hölderlin ? Et peut-on au moins dans une certaine mesure partager aujourd’hui le rapport qu’entretenait le poète à la Grèce ?
Je rappelle qu’ici nous ne sommes pas encore entré dans l’exploration intérieure de l’espace subjectif, que nous sommes pour l’instant dans l’examen de ses bords, de son périmètre propre, et que c’est pour ça qu’on est confronté à des questions d’ordre ontologique.
Aujourd’hui, nous allons examiner la notion de divin.
LE DIVIN :
Concernant le divin, je soutiendrai qu’on a principalement affaire à une figure de disponibilité (ce sera le terme crucial) de ce qui, dans le monde, se tient en excès par rapport à l’humanité. L’existence des dieux, ou des Célestes comme les appelle souvent H. ne renvoie pas à l’existence d’un monde séparé du monde physique commun. Le divin est immanent, ce qui veut dire intérieur au monde, et même, en définitive, intérieur à l’humanité.
Commençons par examiner une définition du divin.
Judith Balso cite une définition par Hölderlin de « la divinité » :
« […] Ce n’est que dans la mesure où plusieurs êtres ont une sphère commune, où ils souffrent et agissent humainement, c’est-à-dire autrement que pour la seule satisfaction des besoins, c’est seulement dans cette mesure qu’ils ont une divinité commune ; et c’est seulement s’il existe une sphère où tous les hommes vivent simultanément et à laquelle les rattache un lien supérieur à celui de la satisfaction des besoins vitaux, c’est à cette seule condition qu’ils ont tous une divinité commune. »
C’est une très belle définition de la divinité. On voit que la divinité est au fond une figure du bien commun. Il n’y a de divinité commune que s’il y a une sphère commune qui relie les êtres humains entre eux par un lien qui excède la seule satisfaction des besoins. On remarque que ce qui existe pour Hölderlin au niveau de l’humanité ordinaire, c’est le besoin, et même les « besoins vitaux » et non pas l’intérêt ou l’égoïsme. C’est un point que je crois important. La différence c’est quoi ? L’intérêt et l’égoïsme ne relient pas, ils séparent, ils ne peuvent pas constituer une sphère commune. Le besoin quant à lui est déjà par lui-même une figure de partage. Les intérêts induisent l’existence d’intérêts différenciés et incompatibles. Les besoins par contre induisent l’existence de besoins communs à toute l’humanité. Il y a donc une sphère commune des besoins. Seulement c’est la sphère commune la plus ordinaire, celle qui constitue l’humanité dans ce qu’elle est en dehors de sa capacité au divin. Donc il ne faut pas confondre le besoin et l’intérêt. Et à partir de là, la divinité est donc le nom de la thèse d’existence possible d’une sphère commune à des êtres humains, voire à l’ensemble des humains, mais qui soit d’un autre ordre que celui de la satisfaction des besoins communs. De plus, il faut que les hommes vivent simultanément, donc en même temps, de façon contemporaine, dans cette sphère commune. C’est donc une sphère nécessairement synchronique et non pas diachronique, ce qui signifie que l’existence d’une divinité constitue l’existence d’un présent commun. Le divin se décline au présent et non pas dans le temps (et pas dans l’histoire). Il n’y a dans la vie humaine de présent réel parce que subjectif, et non pas seulement un présent empirique ou objectif, que sous la condition qu’existe une divinité en partage pour les êtres humains. Or cet autre ordre, c’est celui de la capacité humaine au divin, au sens où lorsqu’existe une divinité commune aux hommes, à certains hommes voire à tous les hommes, on peut affirmer que les hommes vivent et marchent sur la terre comme des dieux. On pourrait dire encore que cet autre ordre, séparé de celui des besoins, c’est l’ordre de la capacité de création des vérités.
Mais comment s’articule le rapport des dieux et des hommes ? Pour répondre à cette question, explorons quelques extraits de poèmes importants de Hölderlin :
Toutes les traductions sont de Bernard Pautrat, tirées du recueil : Hölderlin, Hymnes et autres poèmes, Rivages poche/Petite Bibliothèque.
« Pourtant tu te sens seul, dans la nuit qui se tait t’entend
Crier la plainte le rocher, et souvent te fuit,
En colère, loin des mortels, la vague ailée qui monte au ciel,
Car vivre avec toi, les nobles chers ne le font plus jamais,
Eux qui t’honoraient, qui jadis, de beaux temples et belles villes,
Couronnaient ton rivage, or toujours cherchent, ont un manque,
Oui, toujours il leur faut, comme la couronne aux héros, à eux, les
Eléments consacrés, pour la gloire le cœur des sensibles humains ».
L’archipel p.51
Cet extrait parle de la Grèce contemporaine en tant que site des ruines de la Grèce antique, site qui se caractérise par l’extrême solitude du dieu de la mer qui est le dieu de la Grèce dans la mesure où celle-ci est rebaptisée par Hölderlin du nom d’Archipel, plaçant ainsi les îles grecques au centre de la Grèce et la mer au fondement de son site (Archè = le fondement ou le principe au sens où c’est à la fois un commencement et un commandement, c’est-à-dire une origine et une autorité ; Pélagos = la mer). Le dieu est si seul que seul le rocher entend sa plainte, et il est seul parce que les mortels ont cessé de vivre avec lui, ils ont déserté le site, ils ont cessé de couronner son rivage avec de beaux temples et de belles villes. Pourquoi le dieu de la mer se plaint-il tant ? Parce que les dieux ont besoin du cœur sensible des humains pour leur gloire, ils en ont besoin comme les héros ont besoin de leur couronne, au point que quand les humains cessent de partager avec eux leur vie commune, alors les dieux toujours cherchent, ont un manque.
Ce qui est très intéressant est qu’apparemment ce n’est pas tant les hommes qui ont besoin des dieux que les dieux qui ont besoin des hommes. Les hommes peuvent vivre sans dieux, mais les dieux ne peuvent semble-t-il pas vraiment vivre sans les hommes. Et ce n’est pas tant les dieux qui se détournent des hommes – contrairement à la légende heideggérienne qui veut voir dans Hölderlin le poète romantique de la perte ou du retrait des dieux – que les hommes qui se détournent des dieux. Hölderlin serait donc plutôt un poète du retrait des hommes que du retrait des dieux. En ce sens, Hölderlin n’est pas un poète romantique de la mort de Dieu. Ce qui signifie que les dieux ne sont pas des êtres à proprement parler extérieurs à l’humanité, mais plutôt une figure intérieure à l’humanité, entièrement dépendante de l’existence humaine.
« Seulement là-haut, la lumière, aujourd’hui encore elle parle aux hommes.
Pleine de bons augures et de la voix du grand Tonnant
Elle crie : pensez-vous à moi ? Et, endeuillée, la vague du dieu de la mer
Fait écho : n’avez-vous plus jamais souvenir de moi, comme avant ?
Car les célestes volontiers sur le cœur sensible reposent,
Toujours, comme jadis, elles le guident encore, les forces enthousiasmantes,
Volontiers, l’homme qui fait effort, et sur les monts de la patrie,
Repose et règne et vit le tout-présent, l’Ether,
Afin qu’un peuple aimant, assemblé dans les bras du père,
Comme jadis éprouve joie humaine, et qu’à tous Un esprit soit commun ».
L’archipel, p.65
Ici s’ajoute l’idée que les dieux sont des « forces enthousiasmantes » qui encore aujourd’hui, malgré l’oubli dans lequel les hommes tiennent les dieux, continuent à « guider » « volontiers » « l’homme qui fait effort ». Les dieux se donnent comme une puissance d’orientation intérieure positive sous condition du courage engagé des hommes. Et d’autre part il y a toujours un dieu, sans doute celui que les grecs appelaient Zeus, alors que le dieu de la mer était appelé Poséidon, mais que les poèmes ne désignent jamais par ces noms là – j’y reviendrai plus loin – il y a un dieu qui continue à « régner » et « reposer » et qui est le dieu par lequel peut exister et renaître une figure de peuple. Le « peuple » est une figure entièrement subjective et non pas objective, son existence dépend non pas de la seule détermination sociale ou nationale, mais d’une capacité subjective forte, il n’existe que fortement subjectivé puisque le poème parle de « peuple aimant, assemblé dans les bras du père », un peuple qui n’existe qu’à « éprouver joie humaine » et, point décisif qui nous ramène à la définition de la divinité : « et qu’à tous Un esprit soit commun ». Là encore, ce qui caractérise l’existence d’un peuple c’est un esprit, donc une subjectivité, une subjectivité commune, sous le signe de l’Un, de l’unité de principe. C’est l’Un subjectif qui avère l’existence d’un peuple. Et cet « Un » subjectif, c’est la sphère de la divinité en tant que c’est une sphère séparée des besoins vitaux. Les besoins, en effet, bien qu’on ait établi qu’ils étaient déjà de l’ordre d’une sphère commune (contrairement à l’égoïsme des intérêts) n’en fondent pas moins une sphère objective et non pas subjective – les besoins, c’est objectivement qu’ils existent, qu’ils appellent à être satisfait. Au fond, ce que Hölderlin appelle les besoins, c’est ce qu’à l’Ecole des Actes nous appelons les lois de la vie des gens, qui sont bien des lois communes, comme l’impossibilité de ne pas vivre et s’abriter quelque part, l’impossibilité de vivre sans manger, sans dormir voire même sans travailler, mais en tant que lois communes de toute population, ce sont des lois de l’existence objective des gens. Ce ne sont pas des lois qui fondent à elles seules un peuple, puisque l’existence nouvelle d’un peuple a pour condition l’émergence d’une capacité collective au divin se donnant sous la forme de la commune subjectivation d’une divinité entendue comme figure de l’Un reliant l’ensemble des êtres humains par un lien subjectif qui doit être pour Hölderlin un lien d’amour et de joie.
« Et donc j’ai même espoir que va, si cela que nous désirons,
Nous le commençons, si, d’abord, nos langues se sont déliées,
Si le mot a été trouvé, si le cœur s’est épanoui,
Commencer le ciel à fleurir en même temps que nous,
Et, à l’œil ouvert, l’éclatant s’ouvrir.
Car cela n’est pas du puissant, mais ça fait partie de la vie,
Ce que nous voulons, et ça semble à la fois joyeux et décent. »
Puis plus loin : ce qu’il faut pouvoir dire, quoi qu’on fasse et quoi qu’il arrive, c’est je cite :
«… la sentence
Nous avons fait, quel que soit le succès, notre part. »
L’Auberge, p.83 (poème inachevé qui préfigure L’Archipel)
Dans l’extrait de poème précédent on voyait que les dieux se donnent comme une puissance d’orientation intérieure positive sous condition du courage engagé des hommes. Ici on discerne la forme que doit prendre le courage engagé, et pourquoi. Il faut commencer à faire ce que nous désirons, donc ne pas se laisser intimider par le fait que ce n’est qu’un commencement, un balbutiement, et « commencer » selon le désir, cela commence par le fait de « délier les langues », donc par la discussion, la réunion. La discussion doit avoir comme enjeu non pas seulement d’exprimer les besoins mais d’établir un désir commun, un bien commun. C’est la déliaison des langues qui tisse la relation nouvelle entre les hommes, qui commence à constituer la nouvelle sphère commune, celle de la divinité. Ce point est aujourd’hui éminemment à l’ordre du jour, et à ce titre Judith Balso a mille fois raison d’écrire dans l’introduction de son livre que nous avons aujourd’hui besoin de Hölderlin, de le lire, qu’il apparaît aux lecteurs que nous sommes comme un frère aîné… Il faut délier les langues pour trouver le mot – on est ici dans l’ordre de la pensée commune – et épanouir le cœur – on est ici dans l’ordre de la subjectivité commune, de l’amitié –, figure de l’amitié dont on sait par ailleurs qu’elle était centrale chez Saint-Just pendant la Révolution française puisqu’il allait jusqu’à proposer dans son fameux texte sur les Institutions républicaines que « celui qui dit qu’il n’a pas d’ami sera banni ». Si ce travail du commencement est fait, s’il est commencé, alors le ciel, qui au début du poème est une chape de plomb nuageux qu’il ne faut pas laisser nous assombrir, alors « commencer le ciel à fleurir en même temps que nous, et à l’œil ouvert, l’éclatant s’ouvrir ». Si on fait ce qui est prescrit pas le commencement, on aura une chance que naisse une nouvelle capacité au divin, de telle sorte qu’à l’œil ouvert, donc à la pensée rendue disponible par ce travail de déliaison des langues – l’œil ouvert, c’est la pensée disponible à ce qui vient – l’éclatant peut s’ouvrir – où l’on retrouve, ici, l’idée que les dieux sont alors les figures d’orientation dans la pensée et dans la vie. Or quel est le point de confiance, dans le poème, de la compatibilité entre l’effort commencé à l’initiative des hommes et l’émergence d’une capacité au divin dont il est clair qu’elle ne dépend pas complètement des hommes, en tout cas de ces hommes-là, de ceux qui sont engagés dans cet effort initial ? Ce point de confiance, c’est que « cela n’est pas du puissant, mais ça fait partie de la vie, /Ce que nous voulons, et ça semble à la fois joyeux et décent ». Cela n’est pas du puissant, l’enjeu n’est pas de prendre le pouvoir, de dominer, mais ça fait partie de la vie, cela relève d’un bien commun à la fois joyeux et décent, parfaitement subjectivable par tous. Par conséquent, c’est parce que c’est la figure d’un vrai bien commun que nous mettons au travail que l’effort peut se métamorphoser en capacité nouvelle de l’humanité au divin. Bien sûr, il n’y a aucune garantie dernière qu’il en sera comme cela. C’est pourquoi le problème n’est pas de chercher une garantie préalable avant de se mettre au travail, mais plutôt de se mettre courageusement au travail de telle manière qu’on puisse dire à la fin, comme le charpentier au faîte du toit dont il vient d’achever la construction, cette très belle « sentence » : « nous avons fait, quel que soit le succès, notre part. »
« Mais ils ont, avec leur propre
Immortalité, bien assez, les dieux, ce qu’il faut
Aux célestes, c’est une chose,
J’entends : des héros et des hommes,
Et mortels, en outre. Car, comme
Les bienheureux ne ressentent rien par eux-mêmes,
Il faut bien, si parler ainsi
Est licite, qu’au nom des dieux,
Prenant part, un autre ressente,
Ils ont besoin de lui ; cependant leur verdict
Est que lui, sa propre maison
Il détruise, et que son plus cher,
En ennemi il le traite, et que père, enfant, il se
Les enterre sous les décombre,
Celui qui comme eux veut être, et ne pas
Tolérer d’inégalité, l’exalté. »
Le Rhin, p.117
Alors ça c’est très intéressant. Si on voulait donner une image, une métaphore significative pour nous de ce qu’est la conception hölderlinienne des dieux, une métaphore à laquelle le poète en son temps n’avait absolument pas accès, on pourrait dire je crois que les dieux de Hölderlin, lorsqu’il les envisage séparés des humains, sont un peu semblables aux particules virtuelles dont regorge le vide quantique de la physique des particules (ce qu’on appelle la mécanique quantique). Les particules latentes, dans la physique quantique, sont là, suspendues dans le vide, figées dans une sorte d’éternité virtuelle, mais elles ne disposent pas d’assez d’énergie pour exister à part entière comme des éléments matériels composant notre monde sensible. C’est métaphorique mais ça marche un peu de la même manière. L’énergie dont ont besoin les dieux hölderliniens, c’est la sensibilité des mortels. Les dieux à ce titre dépendent bien de la présence des hommes (ce qui en revanche n’est évidemment pas le cas des particules quantiques, malgré certaines interprétations pseudo-épistémologiques franchement tendancieuses qui circulent aujourd’hui sur la physique quantique). Finalement, ce qui caractérise en propre les dieux, c’est leur immortalité. Au vrai, et c’est cela qu’il faut bien comprendre, c’est que l’immortalité est le seul et unique attribut des dieux, avec, peut-être, la bonté, mais ce point n’est pas complètement clair. On entre ici dans un débat ‘théologique’ compliqué, mais le bien n’est peut-être pas tant un attribut des dieux que le nom du point de jonction des hommes et des dieux : le bien est plutôt fonctionnel qu’attributif, ou plutôt événementiel que prédicatif. Je veux dire qu’il est plutôt dans la capacité subjective des hommes au divin que dans les dieux objectivés ou projetés comme objets séparés. Du reste, et Hölderlin le sait parfaitement, on ne peut pas dire que les dieux grecs antiques soient particulièrement bons. Ils passent leur temps à violer les femmes, à régler leurs comptes entre eux en réglant leur compte aux humains, etc. Le seul attribut des dieux chez Hölderlin, c’est je crois leur immortalité. Mais ça veut dire : leur disponibilité. Le divin se définit comme disponibilité ininterrompue. L’immortalité se donne en termes de disponibilité latente ou potentielle, dans la mesure où n’étant pas une immortalité de type existentielle à proprement parler – on n’est pas sûr que les dieux restent très vivants une fois séparés des hommes, puisque leur vie implique l’existence mortelle sensible – on ne peut pas dire qu’il s’agisse d’une immortalité réelle ou actuelle. Or quel concept donner à la thèse d’existence d’une immortalité purement virtuelle ou potentielle, à cette sorte d’infra immortalité, sinon celui de pure disponibilité ? On admettra donc désormais que le divin, c’est la disponibilité. La disponibilité de quoi ? La disponibilité non pas d’une propriété objective mais d’une capacité subjective, à savoir la capacité humaine à vivre et marcher sur la terre comme des dieux, ou encore la capacité de la vie mortelle et sensible à vivre comme si elle était immortelle et d’une vie dont l’enjeu existentiel est cet objet suprasensible qu’est l’idée d’un bien commun. J’ajoute que si l’immortalité est le seul attribut des dieux, alors les dieux ne sont pas tout-puissants. Les dieux nomment la disponibilité intérieure à l’humanité d’une capacité créatrice, ce ne sont pas des dieux transcendants créateurs du monde et des hommes. A ce titre, le divin comme disponibilité est entièrement différente de ce qu’on trouve chez Hegel, qui, lui, renoue, justement, avec l’idée de toute-puissance du divin. Les dieux ne sont ni bons ni tout-puissants : on n’a pas affaire ici à une conception religieuse, théologique, du divin.
Dans la deuxième partie de l’extrait, cependant, si les dieux ont besoin des hommes pour exister, les hommes ne doivent jamais perdre la mesure du fait qu’ils ne sont pas des dieux. Les dieux restent supérieurs aux hommes, il y a une part d’inégalité irréductible des deux statuts, dans la mesure où l’existence d’une capacité humaine au divin est toujours supérieure à celle d’une capacité humaine à l’humain – à l’humain trop humain, comme dirait Nietzsche. On pourrait dire que le fait que l’humanité puisse vivre en excès sur elle-même ne signifie pas qu’elle constitue une surhumanité. Il faut distinguer et discriminer la notion subjective d’une capacité collective au divin et la notion d’un état objectif de surhumanité. Cette distinction est d’autant plus cruciale que la thèse de Hölderlin est que cette démesure consistant pour l’homme à se croire l’égal des dieux, à se croire identique à eux, constitue la forme suprême de l’imposture conduisant à la guerre civile, à la destruction. L’imposteur suprême, c’est l’ « exalté », l’homme qui se croit l’égal des dieux, l’homme qui prend sa capacité subjective intrinsèquement fragile et précaire, puisqu’il est mortel, pour un état objectif, nécessaire, tout puissant et définitif de son être, n’ayant alors plus rien à prouver. Désastre se caractérisant par le fait que l’homme se met à voir un ennemi dans ceux-là mêmes qui lui sont le plus proche. Ça c’est une idée très profonde je crois : en vérité, l’homme qui se croit l’égal des dieux ne se croit plus du tout l’égal des autres hommes, et il ne peut faire valoir cette inégalité qu’en détruisant tout ce qu’il a d’humain en lui, et donc en transformant les êtres qui lui sont le plus proche en ennemis mortels qui lui rappellent sa condition sensible et mortelle, non divine. C’est une grande leçon notamment pour aborder, je ne fais ici que l’indiquer en passant, la question du transhumanisme, le problème du caractère intrinsèquement fasciste de l’idéologie transhumaniste.
« Sans qu’on les sente ils viennent tout d’abord, cabrés contre
Eux sont les enfants, il vient trop clair, et trop aveuglant, le bonheur,
Et l’homme s’effarouche, à peine si un demi-dieu sait dire
Par leur nom qui sont-ils, ceux qui l’approchent avec les dons.
Mais d’eux il vient un grand courage, son cœur est comble
De leurs joies, et à peine sait-il faire usage du bon,
Il fait, gaspille, et presque saint lui est le non-saint
Qu’il touche, fou et bon, d’une main bénissante.
Autant qu’ils peuvent, les célestes tolèrent cela ; mais ensuite, et en vérité,
Ils viennent en personne, et les hommes se font au bonheur
Et au jour, à contempler les évidents, le visage
De ceux qui, de longtemps appelés Un et Tout,
De libre plénitude comblent la réserve du cœur
Et les premiers, les seuls, exaucent tout désir.
L’homme est ainsi ; lorsque le bien est là, et que de lui donner
Un dieu se soucie en personne, il l’ignore, il ne le voit pas.
Il lui faut porter, tout d’abord ; mais à présent il nomme son plus cher,
A présent, à présent doivent, comme des fleurs, naître des mots pour ça. »
5ème strophe de Pain et Vin, p.151
Je ferai quatre remarques :
D’abord, concernant la question du bonheur : il y a dans cet extrait l’idée que le bonheur est, au moins au début, au moins pour un temps, plus lourd à porter que le malheur, qu’il y a quelque chose de plus difficile dans l’épreuve du bonheur que dans l’épreuve, sinon du malheur, du moins de l’absence de bonheur, qui est même dans ce cas une absence d’épreuve. Cela vient du fait que le bonheur advient à l’homme de manière événementielle, au sens où « événement » signifie ici l’advenue, la rencontre de quelque chose qui se donne comme totalement excessif en regard de l’état normal ou ordinaire de la vie humaine, qui apparaît donc non sans raison comme absolument hétérogène à tout ce qui de la vie commune se déploie sous une norme proprement humaine – sous la norme de la satisfaction des besoins. En vérité, le bonheur que constitue la levée d’une capacité collective humaine nouvelle au divin est tel qu’il apparaît d’abord sous le signe de l’effroi, de la terreur. Les enfants se cabrent, les hommes s’effarouchent. Or il existe un motif contemporain de cet effroi. Aujourd’hui la terreur, ou plus sobrement l’effarouchement, est assignée à l’idée qu’essayer de transformer le monde pour reconstruire la vie humaine sur de nouvelles bases, et notamment sur un principe égalitaire, reviendrait nécessairement à livrer le monde à un bain de sang, au chaos et à des massacres sans nom. C’est là le résultat absolument massif et répandu dans l’opinion du pseudo bilan réactionnaire antitotalitaire du 20ème siècle qui s’est développé dans les années 80 et qui est aujourd’hui encore archi dominant. Or qu’est-ce qui fait que c’est un pseudo bilan, pas un vrai bilan ? C’est parce qu’il consiste à induire – il s’agit bien d’une induction – de manière totalement infondée et éhontée, d’échecs politiques circonstanciés, fussent-ils par ailleurs massifs, à grande échelle, une impossibilité métaphysique définitive à ce que puisse exister pour l’humanité actuelle une autre voie que celle du capitalisme existant tel que fondé sur la course aux profits, la concurrence sans merci, avec les inégalités humaines monstrueuses et la prédation de la nature qui l’accompagnent comme son ombre.
Deuxième remarque, sur ce qu’on pourrait appeler la dialectique du don divin et du gaspillage humain : je pense que ce que porte ici le poème est l’idée qu’il y a une dimension de gratuité inhérente à l’apparition d’une nouvelle capacité humaine au divin, qui rend impossible de rabattre cela sur l’utilitaire, cela se donnant comme le corollaire de l’autonomie du divin par rapport à la sphère des besoins. Sans cette acceptation par les dieux du gaspillage, le don divin ne serait qu’une imposture, dans la mesure où il y aurait confusion entre la sphère utilitaire de la satisfaction des besoins et la sphère de la divinité. Mais d’autre part, le gaspillage est la conséquence normale du don : sans gaspillage, rien ne garantit que le don soit un vrai don. Si les dieux n’acceptaient pas le gaspillage, alors se serait la preuve que ce n’est pas un don en tant que tel puisque ce qui serait donné serait entièrement soumis à des attentes précises donc intéressées. Et le point intéressant ici c’est que le don, c’est précisément la forme que prend le caractère proprement contingent, hasardeux, événementiel de l’émergence d’une nouvelle capacité collective au divin. Le don est en quelque sorte le symbole divin de la non-nécessité. Et j’ajouterai qu’il faut conclure de ces deux points – séparation divin/besoin et rapport intrinsèque du gaspillage au caractère contingent du don – qu’une éthique purement utilitaire ou utilitariste qui prétendrait se réduire au strict nécessaire, au strict service des intérêts humains vitaux, n’est jamais qu’une imposture. C’est ce qui fait de l’utilitarisme empirique et pragmatique une imposture. Donc : il y’a absolue nécessité ontologique d’une dimension de non nécessité éthique, c’est-à-dire nécessité d’une dimension de gratuité éthique qui avère tout à la fois la singularité autonome de la sphère de la divinité qui unit les hommes en regard de la sphère des besoins humains vitaux, et la contingence intrinsèque de la constitution de cette sphère commune du divin dans l’espace général de la vie humaine.
Troisième remarque : le gaspillage est portée par la figure du demi-dieu, c’est-à-dire du premier homme qui accepte le don divin, du premier courageux, qui éprouve le premier la joie de ce qui est donné par les dieux, et qui le premier distribue de manière un peu aléatoire – c’est le gaspillage – ces dons. Donc la dialectique du don et du gaspillage ne signifie pas que l’humanité est vouée à faire n’importe quoi de sa capacité au divin, mais plutôt qu’il y a nécessairement une figure de médiation entre les dieux et les hommes dans la personne du demi-dieu, c’est-à-dire d’une sorte d’avant-garde, préalable à l’émergence véritablement collective, réellement en partage par tous, de cette capacité collective au divin. C’est notamment pour Hölderlin la figure de Rousseau en regard de la Révolution française.
Quatrième remarque enfin, concernant la nomination par les hommes du divin ou du bien commun : il faut remarquer que le poète lui-même ne nomme pas les dieux au sens où il ne donne par leur nom, c’est aux hommes de trouver les noms au moment où ils acceptent le bonheur d’être porteurs en eux-mêmes d’une nouvelle capacité au divin. Le poète, en ce sens, ne prophétise pas. Hölderlin parle des « célestes », des « éléments consacrés », du « père », de la « mère », de l’ « éther », des « tout-présents », du « très-haut », de « ceux qui sont de longtemps appelés Un et Tout », ou tout simplement des « dieux » etc. etc., la liste est longue et impressionnante, mais par exemple (pour ne prendre qu’un exemple) dans Archipel, poème dans lequel il ne cesse de s’adresser au dieu de la mer, il ne le nomme à aucun moment Poséidon. Il ne reprend pas à son compte les noms donnés par les grecs à leurs dieux, bien que ce soit bien d’une certaine manière de ces dieux qu’il parle, et ceci parce que le renouvellement de la capacité humaine au divin dans le monde présent doit nécessairement s’accompagner de nouveaux noms donnés aux dieux, d’une nouvelle pensée : la Révolution française n’est pas la pure répétition de la Grèce antique. Il n’y a pas de divinité particulière transhistorique, seulement une divinité présente au présent. La disponibilité du divin est transhistorique, mais les dieux sont les cristallisations du divin en présents existants, et ne peuvent par conséquent aucunement avoir de noms transhistoriques. On a d’un côté une supra temporalité du divin, et de l’autre une infra temporalité des dieux. L’existence d’un dieu est l’existence d’un présent réel en partage entre les humains. Un présent réel, non réductible au présent empirique, donc un présent divin, en tant que l’humanité fait l’expérience d’un présent qui soit vrai, où chacun puisse enfin se sentir le contemporain de tous, un présent qui soit le présent singulier d’une vérité et non un présent indifférent interchangeable avec n’importe quel autre moment présent. C’est aussi pourquoi Hölderlin peut maintenir le principe de confiance mais il n’est absolument pas à même d’en faire la prophétie, ni en termes de temps, ni en termes de lieux (malgré son hypothèse sur l’Allemagne).
Dernier extrait concernant la conception hölderlinienne du divin pour aujourd’hui, et non des moindres.
« L’homme ne soutient qu’un temps la plénitude divine ».
Ou encore, pour rester dans les mêmes traductions que j’ai citées jusqu’ici :
« C’est que toujours les contenir [les dieux], un faible vase ne le peut,
C’est seulement de temps en temps que l’homme tient plénitude divine.
Rêve d’eux, ensuite, est la vie. »
7ème strophe de Pain et Vin, p.153
Cet énoncé poétique nous conduit cette fois au cœur du livre de Judith Balso et à ce qui constitue dans son livre une des thèses les plus essentielles et passionnantes. La thèse de l’auteur est que Hölderlin ne pense pas historiquement, qu’il n’y a pas de conception à proprement parler hölderlinienne de l’histoire, et ceci non par défaut, mais par la décision assumée par le poète, je cite Judith, « de penser l’humanité non pas comme sujet d’une histoire mais comme sujet d’une existence ». La catégorie d’existence s’oppose à la catégorie d’histoire telle que l’a constitué l’idéalisme allemand. Ce qui caractérise l’humanité comme existence, c’est ici la discontinuité des rapports entre l’humain et le divin. Si « l’homme ne soutient qu’un temps la plénitude divine », alors cela signifie que ce n’est pas un mal en soi que l’humanité perde régulièrement le fil de sa capacité collective au divin. C’est au contraire au régime de la normalité humaine, ce n’est ni un bien, ni un mal, c’est en-deçà du bien et du mal, parce que c’est la conséquence nécessaire de la non nécessité qu’existe un dieu en l’homme, dans la vie de celui-ci. C’est la conséquence de la nécessaire contingence des rapports de l’humain et du divin, nécessité déterminée par le fait que si les humains peuvent vivre sur terre comme les dieux, c’est à la condition qu’ils ne puissent s’égaler à eux. Le « comme » de la comparaison est en fait un opérateur de dissymétrie constitutive.
Concernant la nature de cette discontinuité existentielle, je ne peux que citer le livre de Judith Balso, écrivant dans sa conclusion :
Ouvrir Hölderlin : « Toujours, comme le décrivait Hypérion, un battement, un rythme, ramènent d’un temps où tout semble avoir été trouvé à un temps où tout semble avoir été perdu. [… Il s’agit ici] de la scission (intérieure à toute vie) de l’humain et du divin, comme principe même d’ouverture au divin. En rappelant une nouvelle fois que le divin, chez Hölderlin, n’est pas autre chose qu’une potentialité non encore dévoilée de l’existence humaine sur la terre. Où passe la séparation, où se tient la limite, cela n’est jamais donné, ce n’est jamais déjà là, déjà connu, c’est précisément ce dont l’humanité doit faire et refaire l’épreuve. »
Je conclurai donc cet exposé sur le divin dans la poésie de Hölderlin en disant que le divin est précisément ce qui donne à l’humanité son statut de vide constitutif. En introduction, j’avais dit que le but de ce cours était de déterminer l’humanité selon l’universalité générique par opposition à l’universalité humaniste identitaire. Alors que l’universalité identitaire relevait de l’identité à soi de l’humanité en fonction de propriétés objectives, l’universalité générique est le nom de l’universel en tant qu’il inclut en lui-même une dimension d’absoluité, non relative à l’homme en tant qu’homme, où se fonde la non identité à soi de l’humanité et par conséquent son vide constitutif. Or le divin tel que pensé dans la poésie hölderlinienne correspond exactement à ce que nous cherchions. On peut résumer les choses de la manière suivante : contre la fausse modestie sceptique de la séparation de l’humain et du divin, on affirmera que l’humanité n’est ce qu’elle est que pour autant qu’elle est ce qu’elle n’est pas ; c’est-à-dire que l’humanité n’est l’humanité en tant que telle, que pour autant qu’émerge en elle une véritable capacité collective au divin. A contrario, contre la démesure de l’identification un peu trop absolutiste des hommes aux dieux, on affirmera que l’humanité n’est ce qu’elle n’est pas que pour autant qu’elle est ce qu’elle est ; c’est-à-dire que l’humanité ne porte en elle une dimension de divinité que pour autant qu’elle n’est pas elle-même divine mais bien humaine. Donc la dimension d’absoluité ou de non-identité à soi de ce qu’il y a d’universel dans l’humanité marche dans les deux sens. Ce qui a une très grande portée à mon avis. En effet, on avait vu avec l’humanisme l’exemple d’un universel de type identitaire parce qu’entièrement désabsolutisé. Mais avec la démesure de l’identification des hommes aux dieux, on a à l’inverse la thèse qu’on pourra appeler idéaliste ou même hégélienne d’un absolu de type identitaire : l’absolu identitaire, c’est l’identité à soi de la non identité à soi ou, mieux encore, c’est l’identité à soi de l’universelle identité à soi et de l’absolue non identité à soi (et là on reconnaît évidemment le noyau spéculatif fondamental de l’hégélianisme). J’en conclurai donc que la critique hölderlinienne de la démesure est une mise à distance de la dialectique hégélienne de l’idéalisme allemand. Il n’y a pas plus d’absolu identitaire concret – concret parce qu’incluant la richesse de la non identité dans l’identité même, par quoi l’identité se trouve chez elle dans son autre – qu’il n’y a d’universel identitaire abstrait – abstrait dans la mesure où l’identité est séparée de son autre, donc dans la mesure où l’identité à soi est exclusive de toute non-identité à soi. Il n’y a chez Hölderlin ni universalisme identitaire critique, ni absolutisme identitaire dialectique. On a donc bien affaire avec la poésie de Hölderlin à un universel générique, c’est-à-dire un universel qui d’un côté comporte en lui une dimension d’absoluité qu’on ne dira pas intime mais plutôt, selon le néologisme fameux de Sartre/Lacan, extime ; et un universel qui d’un autre côté n’est pas absolu en tant que tel, qui n’est pas l’absolu, mais qui touche à l’absolu, d’un touché à la mesure de sa capacité à se soustraire à toutes les retombées identitaires avec lesquelles l’humanisme sophistique tente depuis toujours – depuis au moins Protagoras – de le confondre. L’universel générique est ce par quoi l’humanité se caractérise par un vide et non par un plein. Et effectivement, le divin n’est pas une propriété objectivable qu’on puisse décrire scientifiquement, mais une capacité subjective relevant d’une prescription poétique. Il ne s’agit pas d’opposer la poésie en général à la science en général, qui sont tous deux des processus de vérité conditionnant la philosophie, mais d’affirmer que la condition poétique de la philosophie porte sur la détermination de l’humanité comme prescription, s’articulant par ailleurs à ce que la science peut décrire objectivement quant à ce qu’il en est de l’humanité saisie non plus dans sa dimension générique, mais dans ses modalités biologiques, animales et même, pour part, symboliques.
Télécharger le cours :