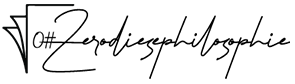Cours de philosophie de Julien Machillot
Ecole des Actes – 2018
Animalisme et Transhumanisme
Introduction
La situation idéologique actuelle se caractérise en partie par le fait que toute figure de différence un peu radicale y est suspectée. On peut dénombrer trois figures sévèrement tenues en suspicion de la différence radicale, ou Différence :
- La différence immanente à la vie humaine, qui partage l’humanité de l’intérieur, et qui se cristallise dans sa modalité la plus intime par la différence des sexes, forme désormais la plus reniée de la différence symbolique.
- La différence qui sépare l’humanité de son extérieur, le dedans de son dehors, c’est-à-dire la différence anthropologique. Celle-ci se pense traditionnellement dans le double partage de l’humanité et de l’animalité (ou de la nature) d’une part, ainsi que de l’humanité et de(s) dieu(x) d’autre part. La prouesse sans précédent de l’évolutionnisme darwinien, pour nous qui sommes toujours dans les conséquences de cette révolution scientifique majeure, est d’avoir établi de manière indubitable qu’une bonne part de ce qu’était la différence anthropologique aux yeux de l’humanité jusqu’à ce jour se situait en vérité au régime de la différence imaginaire.
- La différence qui se cristallise comme écart immanent à l’extériorité même, où l’être se divise entre être-étant et être-en-tant-qu’être. Il s’agit de la différence ontologique, cette fois attaquée en particulier par le biais du tout ridicule procès franco-français de Heidegger. Le retour majestueux de l’ontologie à travers Heidegger aurait comme différence réelle celle de la démocratie parlementaire et des camps d’extermination nazis.
Dans cette configuration intellectuelle générale, l’animalisme et le transhumanisme, dont l’opposition parfois virulente semble progressivement polariser le champ idéologique de certaines contrées d’Europe de l’Ouest, apparaissent en fait comme deux modes de recouvrement contemporain de la différence anthropologique.
Deux faces d’une même pièce, et disons-le, deux terreaux de la barbarie nouvelle. Cette symétrie, qui peut paraître étrange au premier abord, se laisse clairement discerner dès lors qu’on identifie le cadre absolument commun de ces deux modes actuels de désorientation intellectuelle : celui du tournant naturaliste qui fait rage depuis quelques décennies. Animalisme et transhumanisme déploient en réalité un débat interne au tournant naturaliste.
Le 20ème siècle a connu le tournant langagier. Le début 21ème siècle se caractérise par un tournant naturaliste écrasant rendu possible d’un côté par l’évolution spectaculaire de la biologie à la fin du 20ème siècle, et d’un autre côté par la disparition des trois grands référents du communisme tel qu’il a traversé le siècle : l’effondrement des Etats socialistes, la fin des grands mouvements ouvriers ainsi que des guerres anticoloniales de libération nationale.
Le tournant naturaliste actuel se cristallise non dans un naturalisme physicaliste ou physiocentré adossé aux sciences physiques, mais dans un naturalisme biologique ou zoocentré fondé sur le primat de la biologie : les lois biologiques de la vie sont le principe d’intelligibilité exhaustif de la vie humaine. Les sciences de la vie sont, parmi les sciences de la nature, le socle scientifique où tente de s’unifier le nouveau paradigme de naturalisation et de subordination des sciences de l’homme. La naturalisation signifie donc aussi la tentative de biologisation des sciences de l’homme.
C’est pourquoi la vie est le motif central du tournant naturaliste actuel, bien qu’il n’y ait pas, par ailleurs, de concept unifié de la vie clairement identifiable dans l’intellectualité contemporaine de la biologie.
Il existe aujourd’hui trois voies principales de cette biologisation, décrites par Etienne Bimbenet dans son excellent livre Le complexe des trois singes ; essai sur l’animal humain.
1/ La biologie de l’évolution, fondée sur l’intégration de la biologie dans l’évolutionnisme darwinien. Elle a donné lieu à l’apparition de la « psychologie évolutionnaire » dans les années 1990. Celle-ci consiste à faire du gène l’objet par la médiation duquel opère l’intelligibilité complète des comportements humains. Précisément, le gène est la médiation d’objet par lequel la vie humaine est réduite à l’évolution, c’est-à-dire à la sélection naturelle : l’évolutionnisme est détourné au profit d’une version réductionniste.
2/ Les neurosciences cognitivistes, issues du développement de la théorie computationnelle de la pensée et du tournant « connexionniste » des sciences cognitives qui a consisté à faire du cerveau organique et de ses structures neuronales le lieu naturel de la cognition. Ce n’est pas cette fois le gène, mais le cerveau, qui devient l’objet par la médiation duquel opère la naturalisation et l’intelligibilité exhaustive de la pensée et de la vie humaine.
3/ L’éthologie animale, et plus particulièrement la primatologie. L’hypothèse est ici celle de la continuité du comportement des hommes et des animaux : l’homme est un animal comme les autres non cette fois parce qu’il est soumis aux mêmes lois de l’évolution comme pour la psychologie évolutionnaire, non parce qu’il est soumis au même fonctionnement naturel de l’esprit, mais pour une double raison : d’une part, l’homme est soumis à la même diversité infinie des comportements animaux, toutes les espèces ayant un « éthogramme » spécifique, c’est-à-dire « autant de conduites incomparables dans leur manière chaque fois singulière de remplir les fonctions élémentaires de la vie » ; d’autre part, « nous voyons faire à l’animal ce que nous pensions naguère réservé à l’être humain » (le langage, l’usage d’outils, la culture, etc.). Ou l’on voit que le thème des différences horizontales infinies qui doivent être respectées s’oppose frontalement au thème de la Différence anthropologique, suspecte de verticalité présomptueuse. Une conséquence est la disparation de la catégorie même d’« animal », devenue purement nominale, au profit de la notion de « métazoaire » à laquelle appartient l’homme. L’animal, le comportement animal, et plus particulièrement le singe, le primate, sont l’objectivité naturelle par la médiation de laquelle opère l’intelligibilité exhaustive de la vie humaine.
Le gène, le cerveau, le singe, sont les trois médiations d’objets dans lesquels l’humanité actuelle, comme c’était le cas avec le Dieu de Feuerbach, aliène son essence, et oblitère toute Idée singulière de la vie humaine. Comme l’écrit Bimbenet : « le gène, le cerveau et le singe sont devant nous comme de véritables fétiches qui nous laissent sans voix et sans ressort. Entendons par là des êtres qui ne sont pas nous, mais qui nous fascinent assez pour que nous puissions projeter en eux ce que nous pensons être l’essentiel de nous-mêmes. »
Animalisme et transhumanisme participent du même espace idéologique frayé par ces trois horizons du paradigme biologique. Comment animalisme et transhumanisme s’y articulent ?
D’un côté, l’animalisme opère le recouvrement de la différence homme/animal, la négation de la division homme/nature ; on a globalement affaire à l’animalisation de l’humanité par naturalisation des réalisations culturelles humaines envisagées comme produits d’un processus naturel d’adaptation comportemental.
D’un autre côté, le transhumanisme opère le recouvrement de la différence théologique homme/dieu, remplacée désormais par la différence technologique homme/machine ; on a cette fois affaire à la machinisation ou technologisation de l’humanité par naturalisation de la pensée humaine envisagée comme calcul fondé sur la substructure biologico-algorithmique du cerveau.
Point remarquable : dans les deux cas la question de ce qu’il en est du sort de l’humanité dans tout ça est rapportée d’une manière ou d’une autre à la figure du chimpanzé. L’animaliste se distingue par l’énoncé absurde, en vérité moralisateur et nihiliste : « l’homme est le troisième chimpanzé », titre symptomatique du livre de Jared Diamond. Certains transhumanistes soutiennent quant à eux des propos ouvertement fascistes, du type de la tristement célèbre affirmation de Kevin Warwick : « Ceux qui désireront rester humains et refuseront de s’améliorer auront un sérieux handicap. Ils constitueront une sous-espèce et formeront les chimpanzés du futur ». Point où la polarisation antimétaphysique de l’animalisme rejoint comme le reflet du miroir l’apparente métaphysique du transhumanisme. Animalisme et transhumanisme font chacun à leur manière du chimpanzé la mesure contemporaine de l’homme ; soulignons que dans les deux cas il s’agit d’une opération de rabaissement volontaire, soit qu’il s’agisse d’en rabattre avec les prétentions orgueilleuses de l’humanité, soit qu’il s’agisse de piétiner par le mépris l’humanité actuelle et, à travers elle, la pseudo humilité anti-prométhéenne d’une partie de l’humanité à qui ses limites naturelles suffisent. Le chimpanzé, emblème du naturalisme contemporain, cristallise le retour dans l’espace idéologique d’aujourd’hui des éléments de nihilisme et de fascisme qui, fondés dans de nouveaux alliages idéologiques et articulés à de nouvelles manipulations biotechnologiques, sont pour le moins de très mauvais augure.
Revenons au tournant naturaliste. Francis Wolff a montré dans son livre Notre humanité ; d’Aristote aux neurosciences, qu’on a affaire avec celui-ci à une nouvelle figure de l’homme qui « déborde très largement le paradigme cognitiviste » qui structure le champ scientifique contemporain, une « nouvelle figure de l’homme comme vivant, simple vivant et vivant comme les autres, qui est au principe du programme cognitiviste », une « figure de l’homme sous-jacente au mouvement général de « biologisation » de toutes les disciplines dans lequel ce programme est lui-même pris. Selon ce nouveau concept, l’homme est un être de nature, comme tous les autres ; c’est un animal, comme tous les autres ; c’est un animal, ni plus ni moins. »
Point crucial identifié ici par Wolff : « Non seulement l’homme n’a pas d’essence et il convient donc d’abolir toutes les barrières qui l’enserraient jadis dans une essence, mais il n’a pas même de propre – et c’est ce qui fait l’originalité de cette nouvelle figure ».
Wolff conclut : « Ce qui caractérise d’abord cette nouvelle figure de l’homme, animal comme les autres, c’est qu’elle est vague, objectivement vague. Le vague est son trait le plus net. L’homme est sans limites définies. Il est indéterminable. »
C’est donc à une nouvelle figure de l’homme que nous confronte le tournant naturaliste : l’homme est un animal comme les autres ; il n’y a pas de propre(s) de l’homme. L’homme est un être fondamentalement informe, qui doit être informé soit pas augmentation et manipulations génétiques (transhumanisme) soit par identification au sort des animaux et anéantissement de l’hubris métaphysique (donc par diminution : animalisme).
Qu’il n’y ait pas de propre de l’homme, c’est ce qui le rend aussi bien indistinguable des autres êtres naturels (animalisme et transhumanisme) que des êtres artificiels (transhumanisme).
Tournant naturaliste
D’un point de vue scientifique, il est indéniable que l’homme soit un animal, l’être humain est un animal humain, ce qui ne signifie pas que l’homme soit un animal comme les autres ni que ce soit son animalité qui détermine exhaustivement ce qu’il en est de l’être de l’homme. L’animaliste considère que la science (les différentes branches de la biologie) prouve que l’homme est un animal comme les autres. Sur ce point, l’objection de Francis Wolff est définitive. Cette figure de l’homme animal comme les autres repose sur une confusion entre principe méthodologique et résultat scientifique, ou encore entre preuve et présupposé. Faire de l’homme animal comme les autres une définition de l’homme, c’est le concevoir comme un résultat scientifique alors qu’il est le présupposé méthodologique des sciences d’où est déduite cette définition. La science – les sciences de la nature, ou les sciences humaines naturalisées – ne prouve pas que l’homme soit un animal comme les autres. Elle ne peut pas le prouver, parce que voir dans l’homme un animal comme les autres est pour elle un principe méthodologique, le présupposé à l’aune duquel elle étudie l’homme. C’est donc sur ce point que l’animalisme par exemple n’est pas un rationalisme, au sens rigoureux du terme. Postuler scientifiquement que l’homme est un animal comme les autres est légitime en tant que principe méthodologique. Mais poser cet énoncé comme définition de l’homme est parfaitement illégitime, parce qu’une telle définition constitue une contradiction performative, c’est-à-dire une contradiction entre le contenu de l’énoncé et l’énonciation de l’énoncé. On peut repérer au moins trois contradictions performatives – trois points d’aporie – dans l’animalisme actuel :
- La contradiction épistémologique entre postulat méthodologique et résultat scientifique : lorsque je définis scientifiquement l’homme comme étant un animal comme les autres, je me contredits car je fais appel à un présupposé méthodologique qui ne peut servir de preuve pour une définition.
- La contradiction ontologique entre l’homme animal comme les autres et l’homme qui fait de la science : le fait même que cette définition puisse être scientifique fait contredire l’énoncé et l’énonciation, puisque si je fais de la science, c’est que je ne suis pas un animal comme les autres, et si je suis un animal comme les autres, alors je ne fais pas de science, sauf à montrer que les animaux font de la science, ce qui n’est aucunement le cas jusqu’à présent, même dans les doctrines animalistes.
- La contradiction éthique de l’animalisme, qui en appelle à une éthique du respect des animaux et même à l’extension du droit positif au droit des animaux. La contradiction est alors la suivante : ou bien je me soumets à une éthique spécifique du respect des animaux contre les abus de l’homme, et alors je ne suis pas un animal comme les autres, puisque seul l’homme peut formuler une éthique dans laquelle les autres animaux aient plus de valeur ou d’importance que lui-même, ou bien je suis un animal comme les autres et alors une telle éthique est impossible puisqu’aucun animal n’en est capable.
Animalisme
D’un point de vue politique, l’humanité a pour l’instant échouée à vivre et penser à hauteur de l’égalité réelle des êtres humains ou de son désir de justice universelle. J’affirmerai comme le Socrate de la République de Platon, que c’est la Justice qui est le propre de l’homme. Si l’on veut, admettons provisoirement que l’homme n’a pas de propriétés telles que le langage, la pensée, la culture, etc., qui le distinguent de manière décisive du règne animal, quand bien même nous sommes frappés par la singularité apparente de la vie humaine. Ce qui distingue l’homme de l’animal n’est pas tant une propriété objective déterminée (même si cela compte, et beaucoup plus que ne le croit l’animaliste), qu’une propriété subjective qui cristallise le désir le plus haut dont l’humanité est porteuse, dont Egalité, Justice et Vérité sont des noms raisonnables, et par quoi l’homme devient parfois un Sujet. Or, si tel est le cas, la structure de la vie collective qui organise l’humanité actuelle à échelle mondiale est tout sauf la structure d’une vie humaine. On donnera donc partiellement raison à l’animaliste, en ce sens qu’on ne voit guère dans notre monde ce qui distingue aussi radicalement qu’on le voudrait l’humanité de l’animalité à laquelle par ailleurs elle appartient de toute façon. Mais on donnera impitoyablement tort à l’animaliste sur la raison essentielle de cette indiscernabilité : pour lui, c’est naturellement que l’homme est intrinsèquement un animal comme les autres, en ce sens que cela relève des déterminations biologiques de son existence ; en vérité, du point du désir subjectif de Vérité, de Justice et d’Egalité qui anime la vie humaine, il faut plutôt affirmer que c’est historiquement que l’homme est actuellement pour part indiscernable de l’animal, au sens où cette indiscernabilité est à chercher du côté des déterminations politiques qui structurent la vie collective. En ce point, comme autrefois son usage raciste et fasciste, l’usage idéologique de la biologie apparaît, en dehors de l’immense intérêt proprement scientifique des avancées récentes de celle-ci, comme une forme d’essentialisation de la difficulté propre au moment historique où nous nous situons, forme de fuite devant ce que prescrit politiquement l’époque : nous donner les moyens de construire une capacité politique nouvelle des populations innombrables du monde qui n’ont rien à attendre du capitalisme ni du système des Etats. Un tel travail collectif ne peut historiquement avancer que sous la condition de refuser de faire de l’animalité une nouvelle figure de la providence, et de se nourrir de la conviction de la capacité de l’humanité à transformer le monde en s’appuyant sur ses propres forces.
Transhumanisme
L’idée que l’étude de la pensée est l’étude des processus cérébraux et l’idée que la pensée est identique aux opérations informatiques constituent une seule et même conviction homogène.
Le seul point d’accord avec le transhumanisme porte sur le fait qu’on a toujours raison de ne pas se satisfaire de ses limites. Comme l’écrivait le grand poète communiste Aragon : « Honte à qui trouve sa limite, à qui sa limite suffit ».
Mais de quelles limites parle-t-on ?
L’idée pour l’humanité de se donner comme enjeu de surmonter ses limites est un thème courant depuis la Révolution française, thème rebaptisé par le transhumanisme « augmentation ». La différence cruciale étant que l’enjeu de la transformation moderne de l’homme était de se débarrasser de l’inégalité et de l’injustice ; son enjeu postmoderne est a contrario d’en finir avec la maladie et avec la mort. D’une certaine manière, la conviction transhumaniste est strictement inverse de celle qui pointait au 19ème siècle. On connait le célèbre discours à l’Assemblée de Victor Hugo en 1849 : on ne peut pas se débarrasser de la souffrance, des maux naturels tels que la maladie ou la mort, mais la politique a le pouvoir donc le devoir de détruire la misère, de se débarrasser définitivement des maux nés de la société tels que la pauvreté. Or à quoi prétend le transhumanisme aujourd’hui ? A rien moins qu’à détruire la maladie et la mort, sans rien dire de la misère. Or la situation a-t-elle fondamentalement changée de ce point de vue ? Victor Hugo parlait quelque part dans Les Misérables de « la paroisse des meurt de froid qui a du pain et des meurt de faim qui a du feu ». Or la plus grande partie de l’humanité actuelle, à commencer par les pauvres innombrables des pays riches, sont chaque jour confrontés à la nécessité de faire ce type de choix impossibles, de choix monstrueux qui sont la conséquence directe des monstrueuses inégalités qui structurent le monde. Il n’y a sans doute jamais eu autant de misérables sur terre qu’en ce début de 21ème siècle.
On peut conclure de ce rapport inversé de la conviction transhumaniste avec ce qu’a été la conviction proprement moderne qu’on peut appeler de manière générique « communiste », que dans le cadre du retour un peu partout et par ailleurs à mon sens salutaire d’une nouvelle forme de pensée métaphysique, le transhumanisme signe quant à lui le retour d’un type de métaphysique dans sa fonction traditionnelle telle que Lacan l’avait déterminée : le transhumanisme a pour fonction de boucher le trou – immense ! – de la politique.
Conclusion : on peut globalement envisager le rapport à ces deux courants idéologiques désormais omniprésents en regard de la distribution des rapports possibles à la modernité :
L’animalisme est un courant antimoderniste par essence, de type « nous n’avons jamais été modernes » (Latour) : la modernité est le nom de la culpabilité de l’homme ; la figure cartésienne du sujet « maître et possesseur de la nature » étant le péché fondamental de l’homme prétendument moderne.
Le transhumanisme est quant à lui un courant postmoderne par essence, en ce sens qu’il se donne pour tâche de ‘changer l’homme dans ce qu’il a de plus profond’ par des procédés d’augmentation strictement biotechnologiques et complètement séparés de toute l’orientation politique égalitaire dans laquelle cet enjeu avait été formulé, et qui en faisait un enjeu moderne de justice universelle, sous le nom de Communisme.
Tout ceci nous montre que ce dont nous avons le plus urgemment besoin, c’est de la définition d’une nouvelle modernité, qui ne serait pas la répétition de ce que le monde moderne a été, mais qui se donnerait les moyens de surmonter les impasses et les échecs de la première modernité, née il y a deux siècles avec la Révolution française.
Si on garde la Justice comme nom générique de la seule politique digne de ce nom pour aujourd’hui, cela donne :
L’antimodernisme animaliste déploie la pure fiction d’une justice en extériorité : rendre justice aux animaux, de façon à ce que par on ne sait quel miracle la justice intérieure à l’humanité en résulterait. L’extériorité est double : extériorité zoocentrée à l’humanité ; extériorité morale à la politique.
Le postmodernisme transhumaniste se déploie dans la plus pure extériorité à la justice, enjeu de nouveaux monopoles capitalistes. Ici aussi l’extériorité est double : extériorité à la justice même ; extériorité biotechnologique à la politique.
La nouvelle modernité communiste a pour enjeu une nouvelle orientation politique de l’humanité entière fondée sur la seule vraie figure de justice possible : la justice en intériorité, la justice immanente à l’organisation de la vie humaine et les conséquences qui en résulterait dans les rapports de l’humanité avec son dehors envisagé du point de la différence anthropologique.
Bibliographie :
Jared Diamond « Le troisième chimpanzé », 1992.
Francis Wolff « Notre humanité », 2010.
Etienne Bimbenet « Le complexe des trois singes », 2017.
Kevin Warwick : « Moi, le cyborg », 2002.
Télécharger le texte en pdf :