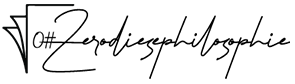Cours de philosophie de Julien Machillot
Ecole des Actes – samedi 4 février 2017
Montaigne :
l’invention du scepticisme moderne
Leçon inaugurale
L’enjeu de ce cours est de procéder à une enquête philosophique sur la subjectivité contemporaine. Mon hypothèse est qu’une forme singulière de ce qui a philosophiquement porté le nom de scepticisme constitue aujourd’hui l’étoffe subjective fondamentale de l’impuissance actuelle des populations dans le monde à construire une figure de paix nouvelle en se séparant de l’horizon de la guerre dans lequel les Etats nous enferment de manière chaque année plus dramatique. L’enjeu est donc immense ; il peut paraître exorbitant, mais je soutiens que les trésors d’intelligence et de subtilité qu’est capable de déployer la pensée philosophique ne valent qu’au prix de se confronter courageusement à un tel enjeu de pensée, identifiable comme enjeu de l’époque historique dans laquelle nous vivons et engageant le destin de l’humanité tout entière.
Mon hypothèse est que pour identifier rigoureusement la figure existante de scepticisme contemporain et se rendre capable de parer à son système entier d’effets mortifères dans le monde actuel, il faut revenir sur l’ensemble de ce qu’a été l’histoire assez tordue du scepticisme moderne, jusque dans la fondation inaugurale qu’on peut situer classiquement au 16ème siècle, enracinée dans les Essais de Montaigne.
Je vais procéder aujourd’hui à une introduction générale de mon travail, introduction qui se compose de deux volets : dans un premier temps, je veux commencer par vous parler du 16ème siècle comme entrée en matière, non pas simplement pour resituer scolairement Montaigne dans son temps, mais parce que je crois que le 16ème siècle intéresse directement le nôtre, je veux dire la conjoncture politique et philosophique de ce début de 21ème siècle ; dans un second temps, j’introduirai mon travail sur Montaigne et le scepticisme moderne non pas en étudiant directement des textes comme je projette de le faire à partir de ma prochaine intervention, mais par la proposition de quelques thèses dont le but sera de vous faire sentir l’ampleur de ce à quoi engage pour moi le fait de constituer les Essais de Montaigne en adversité rigoureuse de la philosophie dont nous avons besoin.
- 16ème siècle : entrée en matière.
Sur le plan politique, je pense que c’est un siècle d’une grande importance car ce qui se joue en ce temps-là est l’apparition d’une nouvelle intelligibilité de la politique, l’invention d’une conception nouvelle de la politique qui trouve dans le 16ème siècle ses prémisses et dont le grand fondateur est Machiavel.
Machiavel écrit Le Prince en 1513, qui sera pour la première fois publié en 1532 ; la première publication des Essais de Montaigne est en 1580. Les deux philosophes enserrent le siècle et donnent une idée de l’horizon du pensable politique pour ce siècle.
Machiavel fonde le noyau de la conception moderne de la politique en tenant la thèse d’une autonomie radicale de la pensée politique : la politique doit être pensée en elle-même, par elle-même, se séparer de toute subordination à la morale, à la métaphysique et à la théologie.
Les intellectuels de l’époque partagent de plus en plus la conviction de la nécessité de refonder l’intellectualité politique, pour séparer la construction de la monarchie naissante de l’ancien régime féodal.
Je dirais qu’il y a pour nous aujourd’hui une espèce de paradoxe du 16ème siècle, tenant en ce qu’on y trouve d’un côté un immense effort de rationalisation inventive de la politique, alors que d’un autre côté, la question des guerres dites « de religion », toute l’époque des guerres civiles qui ont ravagé le territoire du royaume de France notamment entre 1562 et 1598 (édit de Nantes) reste pour nous fondamentalement très obscur et largement inexpliquée. Or c’est là une obscurité qui est pour nous aujourd’hui très dommageable, c’est ma thèse, car elle contribue à notre insu à nourrir un imaginaire dans lequel la religion en général se donne comme la cause mystique, incompréhensible autant que significative, de l’effondrement inéluctable de la politique dans la guerre ou la guerre civile.
Un exemple significatif de ce point. Quiconque a été collégien en France se souvient d’avoir entendu parler un jour ou l’autre des massacres de la Saint Barthélémy, ces sinistres journées de 1572 durant lesquelles des milliers de protestants se sont fait massacrer à Paris et dans quelques autres grandes villes, épisode sanglant qui a engagé l’ensemble des catégories de la population, aussi bien la noblesse que la bourgeoisie ou les gens du peuple. La Saint Barthélémy continue à nourrir en nous l’horreur des guerres de religion ; or force est de constater que ce qui a eu lieu là reste fondamentalement obscur pour les historiens y compris actuels. La fable qui s’est tissée autour de ces massacres dès l’époque contemporaine et qui a cours jusqu’à nos jours (on la trouve encore dans les livres d’histoire-géographie des cinquièmes) est celle tout à fait intéressante du « machiavélisme de Catherine de Médicis » : celle-ci aurait fait semblant de construire une alliance entre catholiques et protestants en organisant le mariage de sa fille avec le prince protestant Henri de Navarre pour attirer les chefs protestants à Paris afin de les faire tous massacrer. Or on sait aujourd’hui qu’il n’en est rien, que cette tentative d’alliance était tout à fait réelle : Catherine de Médicis a instauré, dès 1562, l’orientation générale de ce qu’on peut à bon droit appeler une « politique de tolérance » du protestantisme en tentant à plusieurs reprises de décréter une liberté de culte limitée mais réelle des protestants sur l’ensemble du territoire du royaume, et en négociant par ailleurs la construction d’une alliance entre catholiques et protestants à échelle de la famille royale, à même de s’inscrire dans l’espace symbolique du pouvoir royal.
Or ce qui est intéressant ici, la raison pour laquelle je me concentre un peu sur cette démystification du « machiavélisme de Catherine de Médicis » en introduction, c’est que cela nous apprend d’emblée deux choses sur le rapport à la philosophie de l’époque, l’une concernant Machiavel, l’autre Montaigne.
D’une part, Catherine de Médicis a été une vraie lectrice de Machiavel, et c’est précisément la raison pour laquelle on ne peut pas la réduire à la figure du machiavélisme (ce qui ne veut pas dire qu’elle n’ait pas commis de grandes erreurs politique, y compris du point de sa propre orientation et qui ont peut-être lourdement contribué à l’impuissance durable de la royauté à mettre fin aux séquences récurrentes de guerre civile). Pour l’anecdote, elle était la fille de Laurent II de Médicis à qui Machiavel avait dédié son ouvrage Le Prince. Vraie lectrice, car après la mort de son mari le roi Henry II, elle rompt avec la politique de persécution des protestants qui a cours depuis François Ier. Il faut d’ailleurs souligner la grande responsabilité de la royauté dans l’effondrement dans la guerre civile, préparée par des décennies de persécutions conduites par les rois. les guerres entre catholiques et protestants, loin d’être uniquement déterminées par l’opposition religieuse, sont largement tributaires de la manière dont les rois de l’époque – François Ier en France, Charles Quint en Espagne et ailleurs – se sont disposés dans cette opposition par le développement de véritables politiques de persécution. Le rôle de l’Etat est – dirais-je comme toujours ? – fondamental pour l’intelligibilité des massacres de masse. Toujours est-il que Catherine de Médicis est la première à rompre délibérément, tout en restant catholique, avec la politique royale de persécution pour fonder une politique royale de « tolérance » dont l’enjeu est de fonder l’unité du royaume autour de la personnalité royale, construire l’unité politique du pays autour de son fils Charles IX comme figure de roi de France. Donc là où elle se révèle être une vraie lectrice de Machiavel, c’est que sans renoncer du point de vue religieux, à son catholicisme, l’orientation qu’elle donne à la politique royale défait peut-être pour la première fois le lien de subordination de l’intellectualité politique à la détermination religieuse. La politique royale cesse d’être l’expression de la foi chrétienne, et la reine-mère tente au contraire d’effectuer une alliance politique entre catholiques et protestants, ce qui s’inscrit parfaitement dans le nouvel espace de pensée des rapports entre politique et religion tel que prescrit par Machiavel.
Concernant Montaigne d’autre part, tout cela me permet de commencer par soustraire les Essais, et notamment la catégorie de tolérance qu’on lui prête si souvent, à un double mythe le concernant.
Premièrement, lorsqu’il traite de la tolérance religieuse, il ne se situe absolument pas au-dessus de la mêlée, Montaigne n’est absolument pas je ne sais quelle « voix isolée et prophétique dans le contexte sombre des guerres de religions » ; d’abord, c’est un catholique qui pense que les protestants ont tort de se révolter : même s’il en dénonce l’extrémisme, il se situe fondamentalement et ouvertement du côté de la Contre-réforme catholique. Le scepticisme qu’il va déployer et systématiser est d’abord, dans la voie ouverte par Erasme, un instrument de la Contre-réforme avant de devenir plus tard, avec notamment Pierre Bayle, un instrument de la Réforme ; le scepticisme, on le verra, ne renvoie en rien à un athéisme secret, caché, que notre époque prête à Montaigne pour mettre un voile de laïcité sur sa propre piété, mais renvoie au contraire, comme on le verra, à la construction d’une catégorie de l’absolu dont le seul et unique rapport possible et légitime est un rapport de soumission totale et absolu.
Deuxièmement, la « tolérance » n’est pas chez Montaigne une catégorie morale renvoyant à la liberté de conscience, mais une catégorie politique par laquelle il prend parti pour l’orientation politique royale d’alliance religieuse autour de l’unité royale telle que déterminée par Catherine de Médicis. Loin de se situer moralement au-dessus de la mêlée politique, il prend parti politiquement pour la fidélité envers la royauté, et se rendra tout au long de sa vie disponible pour être l’instrument de négociations secrètes entre les grands, visant à construire cette alliance, notamment, à plusieurs reprise, avec le prince protestant Henri de Navarre, qui deviendra finalement le roi Henri IV. Il n’a pas été un conseiller du prince comme s’envisageait et l’a été Machiavel, mais plutôt ce qu’on pourrait appeler une figure d’instrument politique très ponctuel, évanouissant, du prince.
Troisièmement, Montaigne n’était pas à proprement parler l’anti-machiavel du siècle. Sa pensée s’inscrit dans l’intellectualité de la politique ouverte par Machiavel, certes avec beaucoup de réticences, mais loin d’en faire un anti-machiavel, j’ai l’impression que cela en fait au contraire un machiavélien prudent, certains chapitres des Essais sont, me semble-t-il, une sorte de tentative de limitation interne des effets potentiels des thèses de Machiavel sur la politique, tentative de circonscription du réel politique pour le limiter au maximum et pour séparer au maximum les gens de la politique, faire de la politique un domaine réservé et séparé, dont le réel ne doit pas corrompre la subjectivité générale. Sorte de « machiavélisme restreint » ?
A propos des guerres dites « de religion » : nécessité d’y revenir, car elles sont très vite devenues, de par leur obscurité même, la matrice d’une conception de la politique et de la guerre nous vouant au scepticisme. En particulier, les fables tissées autour des épisodes sanglants de guerre civile visent à sauver la figure de l’Etat naissant, en mettant l’Etat du côté de la solution politique aux « guerres de religion » alors qu’il a été au contraire largement du côté du problème et une des causes de l’effondrement du royaume dans la guerre, via les politiques de persécution initiées par François premier.
Le 16ème siècle en France mêle un élément d’enfermement de la vie collective dans l’horizon de la guerre, et en particulier de la guerre civile extrêmement cruelle ; un élément de confusion obscurantiste entre politique et religion qui à ce jour n’a pas encore été complètement démêlée je crois ; un élément de sortie d’une séquence historique absolument inventive sur le plan des arts, et de la pensée en générale – la Renaissance importée très tardivement en France – mais aussi absolument guerrière – la guerre de cent ans qui a ravagé longtemps des régions entières du royaume de France – ; un élément d’invention ou de levée d’une figure entièrement nouvelle de la politique procédant à des ruptures très profondes avec le féodalisme et les modèles aussi bien chrétiens que romains de la politique ; ainsi qu’un élément d’enfoncement subjectif dans une figure fondatrice du scepticisme faisant doctrine du renoncement à ce dont la pensée est capable et qui ouvrira une grande crise de la pensée philosophique, que surmontera le cartésianisme. Eléments en regard desquels je soutiendrai que le temps dans lequel nous sommes aujourd’hui est une sorte de « répétition » du 16ème siècle, qu’il s’agit d’un même temps intervallaire aux enjeux très proches – temps intervallaire entre la Renaissance et la modernité pour ce qui concerne le 16ème siècle, temps intervallaire entre figure de politique et de pensée moderne adossée à l’Etat et invention d’une figure neuve de communisme devant s’avérer capable de lever les apories de la guerre et de l’Etat pour ce qui concerne le 21ème siècle – qui mêle dans les deux cas une sorte d’impuissance à s’orienter vers la construction d’une paix nouvelle et à parer à l’effondrement toujours plus sinistre, cruel et dévastateur de la vie collective, orchestrée par la bêtise des puissants de l’époque, et une sorte de recherche active, d’invention fébrile, un approfondissement de la pensée qui prend en particulier l’aspect singulier de prendre pour objet des éléments particuliers sous la pression de la conjoncture, des questions dont la portée est en apparence limitée (l’unification de l’Italie pour Machiavel notamment) mais de traiter ces questions dans un effort synthétique de remontée aux principes ayant pour effet que les propositions intellectuelles sont immédiatement ressaisies par les intellectuels de l’époque comme ayant une dimension universelle, comme constituant les termes d’une pensée neuve, d’une nouvelle intellectualité de la politique, et même d’un nouvel objet politique, qui deviendra l’Etat. Autrement dit, la pensée philosophico-politique ne se déploie pas sous la forme de doctrines générales comme ce sera le cas à partir de Thomas Hobbes au XVIIème siècle, mais procède par systématisation de ce qui se donne comme des principes généraux à partir de points de conjoncture déterminés, sous la pression d’une question particulière brûlante. C’est à ce titre aussi qu’il est intéressant que la philosophie en tant que telle rencontre le 16ème siècle aujourd’hui, car cela montre la conscience très forte qu’avaient les intellectuels de l’époque de ce que voulait dire « penser philosophiquement sous condition de la politique », dès lors qu’on cherche à rompre avec les conceptions générales installées de celle-ci. En particulier, un des enjeux de la pensée actuelle est de rompre avec la polarisation étatique de la politique, de la même manière que le 16ème siècle cherchait à rompre avec sa polarisation féodale (et je crois que la difficulté de la rupture est au cœur de l’impuissance à conjurer la guerre civile, de 1562 à 1598 ; la séparation avec le féodalisme sera politiquement consommée par l’assassinat du duc de Guise, chef de la Ligue des ultra-catholiques, clef de voûte de l’orientation de la Contre-Réforme).
- Scepticisme moderne et antique ; duplicité spéculative ; humanité, divinité, désir d’absolu et choix spéculatif fondamental.
Je vais aujourd’hui commencer à aborder les thèses de l’Apologie de Raymond Sebond, titre de l’énorme chapitre 12 du livre II des Essais de Montaigne, qui concentre les thèses sceptiques fondamentales de Montaigne, et qu’il est à mon sens important de connaître et d’étudier parce que je soutiendrai – après d’autres ! – que ce chapitre est fondateur du scepticisme moderne, y compris du scepticisme que Descartes devra traverser quelques décennies plus tard. Il inventera en particulier le doute méthodique comme le moyen de rendre justice à ce que la raison contient non pas d’égarement errant, mais de capacité à se séparer avec toute la radicalité requise, de toutes les fausses certitudes, de toutes les fausses figures de vérité qui gangrènent l’exercice de la raison, qui empêchent la pensée. Le doute méthodique de Descartes va être une première forme de renversement du scepticisme moderne, qui se donne sous la forme d’une traversée de la négativité comme moyen d’accéder à une nouvelle certitude indubitable, donc à une nouvel accès de la pensée à l’absolu, cet absolu étant in fine envisagé par la pensée moderne comme « totalité infinie ».
Cette figure de négativité méthodique va constituer une matrice fondamentale de toute la pensée moderne, qui va se révéler absolument déterminante pour la philosophie comme pour la politique. Je soutiendrai en ce sens que la détermination du rapport entre pensée philosophique et pensée politique dans la modernité passe par une élucidation de leur rapport au scepticisme moderne.
L’importance de cette matrice intellectuelle de la traversée de la négativité effleure jusque dans la formulation de certains mots d’ordres cruciaux. Par exemple, un des mots d’ordre de la Grande Révolution Culturelle Prolétarienne chinoise, porté par les gardes rouges, était : « détruire l’ancien pour construire le nouveau ». « Détruire l’ancien » : nécessité d’un moment purement destructeur, d’une traversée de la négativité pure, fondée sur la subjectivité sceptique d’arrachement à toute idée qu’on puisse faire aujourd’hui quoique ce soit d’absolument tout ce dont l’existence est enracinée dans le passé, si on a pour enjeu politique la construction du communisme.
Cet énoncé politique, comme tous les énoncés dont se nourrit la conviction d’une nécessité de la table rase, est très intéressant car il se situe en quelque sorte aux antipodes du scepticisme ouvert par Montaigne, ils lui sont radicalement opposé.
Donc : ce travail de caractérisation du scepticisme moderne doit à mon sens permettre, entre autres choses cruciales, de traverser à de nouveaux frais l’intellectualité marxiste et communiste des 19ème et 20ème siècles, de formuler des hypothèses nouvelles susceptibles de nous permettre de lever quelques-unes des apories internes aux dispositifs de pensée dont cette intellectualité a pu être le nom à un moment ou à un autre.
Je voudrais commencer par établir une différence cruciale entre scepticisme antique et scepticisme moderne – l’enjeu étant de concentrer progressivement la question du scepticisme sur sa figure contemporaine : le scepticisme antique est le scepticisme rapporté à ce qui existe, une mise en cause de l’existant, des opinions et institutions régnantes, tandis que le scepticisme moderne se donne, avec Montaigne, comme le scepticisme rapporté à tout ce qui se situe au-delà de l’expérience – de l’expérience consciente, sensible, empirique ou sociale.
L’adversaire du sceptique antique est le sens commun, les opinions circulantes ou la doxa, le soi-disant bon sens qui se révèle n’être que le sens des mœurs et coutumes installées ayant à voir avec les mythes de la Cité, et non avec la vérité. L’ennemi du sceptique antique est le sens commun.
En revanche, l’ennemi ou adversaire du sceptique moderne est le métaphysicien, c’est-à-dire le penseur, le philosophe prétendant ouvrir et construire un accès rationnel à la connaissance de ce qui se situe au-delà de l’expérience, à la pensabilité de ce qui se donne comme suprasensible, c’est-à-dire de ce qui est radicalement séparé de toute expérience sensible – il faut prendre « suprasensible » au sens strict : est un existant suprasensible tout objet de la pensée à propos duquel n’existe aucune perception possible par les sens, qui ne peut être ni vu avec les yeux, ni entendu avec les oreilles, ni touché avec les mains, ni gouté avec le palais, ni senti avec le nez – et qui compose par conséquent une figure de l’absolu, au sens de ce qui est séparé de toute perception possible par un sujet doué de sensibilité. Cette figure de l’absolu est évidemment pour Montaigne celle qui a traversé toute la philosophie médiévale, c’est-à-dire la figure du Dieu chrétien monothéiste, et ce Dieu restera d’ailleurs la figure référentielle de l’absolu pour une grande part de la pensée moderne.
Cette détermination de l’adversité est importante car elle montre que le rapport de la philosophie au scepticisme change du tout au tout :
Pour l’antiquité, le scepticisme va constituer une dimension constitutive et fondatrice de la philosophie elle-même, elle va s’inventer de l’intérieur de la philosophie et s’établir comme une condition de la pensée. Socrate peut en ce sens être légitimement envisagé comme un sceptique, et même comme l’inventeur du scepticisme antique, et cette liberté que se donne la philosophie d’une mise en cause à la fois générale et rigoureuse de toutes les opinions circulantes sera relevée et systématisée par Platon dans la différence conceptuelle entre doxa et épistémè, c’est-à-dire entre opinion et vérité. Ce qui veut dire aussi que pour comprendre ce qu’a pu être le scepticisme philosophique de l’antiquité, il faut le soustraire à ce qu’est d’une manière générale le scepticisme pour nous, au scepticisme tel qu’il s’est déployé dans la modernité, ce qui est un exercice difficile. Mais un point essentiel qu’il faut saisir, c’est que dans l’espace de la philosophie antique, le scepticisme est toujours une condition de la pensée, et jamais à aucun moment il ne se donne sous la forme d’un renoncement à la pensée. Toujours une condition, jamais un renoncement. Même dans la figure sceptique la plus anti-platonicienne de l’antiquité, c’est-à-dire une philosophie qui va faire passer le scepticisme du statut dogmatique de condition d’accès au vrai par séparation d’avec le faux et le sophisme à un autre statut, celui de principe d’orientation de la philosophie elle-même, celle de Pyrrhon et du pyrrhonisme que formalise Sextus Empiricus, la figure de suspension du jugement ne se donne pas comme un point d’arrêt de la pensée, mais comme une condition de continuation de la pensée. Pourquoi ? Parce que le scepticisme de Pyrrhon ne consiste pas à considérer que la pensée ne peut rien connaître avec certitude, mais à considérer que la pensée ne peut pas savoir si elle peut connaître ou non une chose avec certitude. Ce faisant, le sens de la suspension du jugement n’est pas de reconnaître pour la pensée l’inconnaissabilité intrinsèque de la chose pensée, mais, ne sachant pas si elle peut ou non connaître la chose en question, cette suspension va se donner comme condition d’une continuation de l’exploration en pensée de la chose, comme condition d’une continuation de la recherche, donc de la pensée ! La suspension du jugement n’est pas un renoncement à penser, mais une condition de continuation d’une pensée qui ne saurait se laisser réduire à la figure aporétique du jugement ; la pensée est un processus complexe irréductible au moment du jugement suspendu dans le processus de connaissance. La finitude du jugement se donne comme la condition de l’infinitisation du processus de la pensée.
A contrario, le scepticisme moderne que va initier Montaigne et qu’ensuite la philosophie va rapidement essayer de détourner pour en faire une condition inhérente de la philosophie moderne, comme le tente Descartes avec l’invention du doute méthodique, ce scepticisme moderne est d’abord et avant tout non une condition de la pensée philosophique, mais une détermination profondément antiphilosophique qui va notamment se cristalliser, on le verra, dans une thèse de nécessaire renoncement à la pensée dès lors que l’on se situe aux abords d’une figure de désir de l’homme, de désir de l’humanité susceptible de porter les marques ou stigmates d’un peu d’absolu. Or, en tant que forme d’élaboration des termes d’un renoncement à la pensée, ce scepticisme moderne ne va pas jouer de la vérité contre l’opinion, de la pensée contre la croyance commune, mais va au contraire jouer de l’opinion contre ce qu’il appellera la prétention dogmatique au vrai, ou encore de l’humilité de la croyance comme relevant de la condition naturelle de l’homme contre la pensée strictement rationnelle que le sceptique envisagera comme une présomption antinaturelle exorbitante de l’homme dès lors qu’il s’imagine pouvoir se tenir au-delà de sa condition de mortel.
Je terminerai cette longue introduction par une thèse générale concernant le scepticisme moderne, après l’avoir distingué du scepticisme antique :
Ma thèse est qu’il y a une hypocrisie fondamentale, constitutive, du scepticisme moderne, qu’il faut identifier pour ce qu’elle est, à savoir non pas simplement une hypocrisie au sens moral du terme, mais une hypocrisie qu’il faut entendre en un sens spéculatif, au sens d’une duplicité spéculative ou conceptuelle, c’est-à-dire une hypocrisie qui constitue une dimension théorique systématique du scepticisme, une structure méthodique de la pensée sceptique, un véritable outil théorique, une clef de voûte sans laquelle je tiens qu’il n’est pas possible de faire doctrine du scepticisme. Peut-être même peut-on parler de duplicité méthodique du scepticisme, au sens où on parle par ailleurs de doute méthodique concernant Descartes. Duplicité méthodique comme mode de traversée de la négativité, constitutif de la requalification moderne du scepticisme tel qu’inauguré par Montaigne.
La critique de l’hypocrisie au sens de catégorie morale est la plupart du temps très faible. Ce qui importe, c’est en quoi elle est un élément structurel de la pensée philosophique, plus précisément anti-philosophique, ou encore de la politique, de la mauvaise politique. Par exemple, la campagne présidentielle actuelle n’est rien d’autre qu’un concours national d’hypocrisie conçu tout à fait ouvertement comme clef de voûte de la structure politique du pays ! C’est particulièrement malheureux et catastrophique, mais c’est comme ça ! Disons que l’hypocrisie au sens moral, c’est une tromperie cachée : dire une chose en en pensant une autre, se montrer tel alors qu’on est autre, etc. En réalité, la duplicité spéculative n’est pas cachée, c’est une structure de pensée, une méthode, donc le terme d’hypocrisie n’est en vérité pas adéquat pour nommer ce que j’essaye de circonscrire là, il nous permet seulement d’accéder à une intuition générale de la chose…
Cette hypocrisie méthodique consiste dans l’abaissement systématique de tout ce qui prétend chez l’homme à une forme de grandeur, de hauteur, de courage héroïque ou d’accès intellectuel et pratique à une dimension d’absoluité, – abaissement méthodique de tout ce qui prétend se tenir au-delà ou un peu au-delà de la condition supposément naturelle de l’homme ou de la dimension de finitude envisagée comme fondatrice de la condition humaine, afin de se sentir plus grand que ce qui se croit grand au nom même du fait qu’on se sait petit, ou encore pour se tenir au-dessus de tout ce qui s’envisage comme élevé, ceci au nom même du fait qu’on ne prétend pas se tenir plus haut que tout en bas ; ou encore à s’envisager comme homme se situant (un peu) au-delà de la condition humaine au nom même du fait qu’on serait celui qui a rabaissé l’homme à ses justes dimensions, aux strictes dimensions de sa condition de mortel, ou encore au nom de ce qu’on serait celui qui a ramené l’homme à sa condition d’être naturel parmi les êtres naturels. L’homme ne peut être présent ailleurs/au-delà/en dehors/etc. de sa condition intrinsèquement limitée, finie, mais celui qui représente l’humanité dans les strictes limites de sa vie ordinaire, celui-là se tient au point le plus élevé qu’il est possible à l’humanité d’accéder et qui comme tel reconduit la possibilité d’un point de vue extraordinaire de la conception humaine, la possibilité d’un lieu de pensée inconditionnel à l’aune duquel la vie humaine est entièrement circonscrite – soit disant « sans reste » – par l’ensemble des conditions d’existence qui la déterminent et la subordonnent à autre chose qu’elle-même.
On peut indiquer que cette forme d’hypocrisie systématique se donne couramment dans le refus des catégories fondamentales de la pensée, refus qui se donne dans le rejet de ce qui est qualifié de « grands mots », ou encore dans le rejet de toute systématisation de la pensée. C’est pourquoi d’ailleurs il faut systématiser Montaigne, c’est-à-dire forcer à tout prix les « Essais » à se donner pour ce qu’ils sont en réalité : un système anti-philosophique de pensée et un des plus vicieux que l’humanité ait jamais conçu. Refus des « grands mots » : L’histoire avec un grand H, la nature avec un grand N, l’humanité avec un grand H, etc. L’anti-systématisme et le rejet des grands mots sont toujours à mon avis l’indice qu’on a affaire à une duplicité spéculative systémique, ils sont le symptôme d’existence de cette névrose de la pensée.
Plus précisément, ils sont le symptôme de ce qui constitue un des enjeux les plus cruciaux du scepticisme moderne, et que j’appellerai la volonté de séparation de l’homme et du divin. La volonté de soustraction de l’humanité de toute assignation à quelque élément de divinité que ce soit. Autrement dit, le rejet de l’absolu comme objet du désir rationnel de l’homme, c’est-à-dire comme objet du désir de l’homme en tant qu’être pensant, en tant que singularisable par la raison qui constitue l’humanité de l’homme, ce rejet de l’absolu entendu en ce sens, le rejet de cet absolu-là se donne dans une opération d’absolutisation de la séparation de l’homme et du divin : la séparation doit être radicale, elle doit être sans reste.
On repère cela chez Montaigne au sens strict, de manière tout à fait littérale. En effet, une des dimensions fondamentales du propos de Montaigne est d’opérer une dédivinisation de l’humanité, c’est-à-dire une séparation conceptuelle rigoureuse et particulièrement sourcilleuse de l’élément divin et de l’élément humain. Rien de ce qui est humain, rien de la pensée ni de l’action humaine ne contient dans son être, dans sa nature, un quelconque rapport au divin, une quelconque trace de divinité – sauf, éventuellement, lorsque l’homme est mû par la révélation, c’est-à-dire sauf lorsque l’homme n’est plus en rien par lui-même sujet de ce qu’il dit ni de ce qu’il fait.
On est au plus loin de la conviction de Hölderlin affirmant la possibilité pour les hommes de « vivre sur la terre comme des dieux ».
Cette séparation systématique et méthodique du divin et de l’humain va très loin, puisque Montaigne va, par exemple dans l’Apologie de Raymond Sebond qu’on étudiera, jusqu’à reprocher aux anciens, aux philosophes grecs et latins de l’antiquité, des énoncé philosophiques dans lesquels humanité et divinité étaient mêlés, au point que les anciens argumentaient philosophiquement la possibilité non métaphorique mais bien entièrement réelle pour les hommes de devenir sous certaines conditions des dieux en tant que tels. Un homme peut réellement devenir un dieu, et cette possibilité est pensable, rationalisable, faisant l’objet de démonstrations philosophiques rigoureuses. Je me souviens en avoir lu une, très belle, dans La consolation de Philosophie de Boèce. C’était là une conviction forte à mon sens des anciens, conviction partagée par les sceptiques de l’antiquité. Plus encore : l’invention du scepticisme par Pyrrhon est contemporaine des conquêtes d’Alexandre le Grand, qui était considéré par ses contemporains comme un dieu au sens le plus strict du terme, sans que cela n’engage aucunement un quelconque diagnostique de folie de masse ou de psychose des foules !
Ce reproche de Montaigne apparaît comme parfois rhétorique, tellement il se montre pointilleux sur cette question : il parle je cite de « ce sot titre qu’Aristote nous prête : de Dieux mortels ; et ce jugement de Chrysippe, que Dion était aussi vertueux que Dieu. Et mon Sénèque reconnaît, dit-il, que Dieu lui a donné le vivre, mais qu’il a de soi le bien vivre ; conformément à cet autre (qui dit) : ‘c’est avec raison que nous nous glorifions de notre vertu ; ce qui n’arriverait pas si nous la tenions d’un dieu et non pas de nous-même’. Ceci est aussi de Sénèque : que le sage a la fortitude (c’est-à-dire le courage) pareille à Dieu, mais en l’humaine faiblesse ; par où il le surmonte. Il n’est rien si ordinaire (conclut Montaigne de ces citations prises un peu au hasard) que de rencontrer des traits de pareille témérité ».
On voit ici à l’œuvre une très pointilleuse critique de la témérité, de la présomption, de la prétention de la philosophie lorsqu’elle soutient la thèse d’un quelconque statut divin de l’humanité. Et que répond Montaigne à cela ? Je cite :
« Mais il faut mettre aux pieds cette sotte vanité, et secouer vivement et hardiment les fondements ridicules sur quoi ces fausses opinions se bâtissent. Tant qu’il pensera avoir quelque moyen et quelque force de soi, jamais l’homme ne reconnaîtra ce qu’il doit à son maître ; il fera toujours de ses œufs poules, comme on dit ; il le faut mettre en chemise ».
Vous voyez que c’est un propos d’une violence inouïe ! Et il y en a d’autres, encore plus brutaux, qu’on étudiera la prochaine fois. L’énoncé central ici est « tant qu’il pensera avoir quelque moyen et quelque force de soi » ; autrement dit, l’enjeu de la dédivinisation radicale de l’humanité pour le sceptique moderne, c’est de refuser à l’homme un quelconque statut de sujet. Sujet, c’est-à-dire thèse de capacité de l’homme à penser et agir par lui-même, c’est-à-dire thèse de la capacité de l’homme à s’appuyer sur ses propres forces pour déterminer par lui-même le cours de sa vie et, au-delà, le cours des choses. Sujet, c’est-à-dire élément de liberté absolue constitutive de l’humanité de l’homme. C’est à cela précisément que le sceptique tente de faire la peau, en dépouillant sauvagement l’homme de tout attribut divin qui lui donnerait un statut de sujet.
La thèse n’est pas que l’homme est mauvais en soi, elle est beaucoup plus subtile : la multiplicité des vices inhérents à l’humanité compose le fond de la nature humaine, ils sont donc naturels, il faut les accepter, on ne peut les condamner comme un mal insupportable, il faut faire au mieux avec eux, et finalement les accepter comme un mal nécessaire. Ils sont humains. Non, en réalité l’homme devient réellement mauvais dès lors qu’il s’envisage comme sujet, comme fondamentalement libre, c’est-à-dire dès lors qu’il prétend dépasser sa condition naturelle, dès lors qu’il a la présomption d’outrepasser les limites de son impuissance intrinsèque, de sa faiblesse native, dès lors qu’il se prête une puissance, une capacité qui ne saurait venir de lui, car ce n’est manifestement pas adéquat à ce que l’on trouve dans la nature. Le sujet se donne comme figure d’outrepassement de la nature humaine, et cette présomption est une figure du mal et même du mal absolu. Ce n’est pas l’homme qui est mauvais, mais l’homme en tant que sujet, ou l’homme qui se prend pour un dieu, fût-ce un « dieu mortel », un petit dieu. Si l’homme est mauvais, c’est dans la mesure où il ne parvient pas à s’empêcher de surmonter sans cesse sa condition finie d’être mortel. L’assignation de l’homme à une figure de sujet, c’est cela le mal suprême, du point de vue du scepticisme moderne dans sa tendance la plus mortifère.
Quand on lit Montaigne, on a un peu l’impression d’entendre un écologiste d’aujourd’hui parler…
Je parlais à l’instant de la duplicité spéculative du scepticisme moderne, et de celle de Montaigne en particulier. Or, en regard de que je viens de commencer à établir concernant l’enjeu de dédivinisation de l’homme dans les Essais, quelle n’est pas en effet la surprise du lecteur lorsqu’il arrive à la toute fin des Essais, à la dernière ou avant dernière page du gigantesque ouvrage, à l’endroit même où se trouve comme condensé à l’extrême tout le propos de Montaigne dans une décisive conclusion ! On peut effectivement y lire la chose suivante :
« La gentille inscription de quoi les Athéniens honorèrent la venue de Pompée en leur ville se conforme à mon sens :
D’autant es-tu Dieu comme
Tu te reconnais homme.
C’est une absolue perfection, et comme divine, de savoir jouir loyalement de son être. Nous cherchons d’autres conditions, pour n’entendre l’usage des nôtres, et sortons hors de nous, pour ne savoir quel il y fait. »
Il faut noter que cette inscription des Athéniens visait à honorer la venue d’un dictateur romain, dans une Grèce défaite, où Athènes n’est plus que l’ombre d’elle-même et n’a depuis longtemps plus rien de cette majestueuse Cité antique abritant les philosophes. C’est comme si aujourd’hui Alexandre Tsípras célébrait la visite d’Angela Merkel et Jean Claude Juncker par ces mots, les remerciant de ne pas piller Athènes plus avant après avoir livré au pillage la Grèce entière… Plus précisément ici, pour ce que j’en comprends, c’est l’inscription par laquelle les athéniens honorèrent la venue de Pompée, en lui disant qu’ils le reconnaissent d’autant plus comme leur maître – comme un Dieu – qu’il a eu la bonté de passer par Athènes sans, pour cette fois, avoir eu la velléité de piller et saccager la ville – il s’est donc comporté comme un homme du commun, qui n’a pas en général la puissance de piller ses voisins.
On voit ici éclater la duplicité dont je parlais. Le vrai désir de Montaigne est bien un désir d’absolu, un désir d’absolue perfection, un désir qui ne saurait se satisfaire que de conquérir la position subjective d’un dieu mortel. Le réel du désir spéculatif éclate après s’être comporté durant des centaines et des centaines de pages comme un Tartuffe ne cessant de s’exclamer : « cachez cet absolu que je ne saurais voir !!! ».
La duplicité spéculative se révèle donc ici de manière éclatante être la méthode d’une dénégation du désir d’absolu, plus précisément une dénégation de la structure intime du désir de l’homme, de tout homme en tant qu’homme, qui est d’être intrinsèquement un désir d’absolu. Je dirais que c’est d’ailleurs la thèse de la psychanalyse ! L’intellectualité psychanalytique se fonde sur l’identification du désir comme ce qui chez l’homme n’est pas réductible à la nature, comme le lieu même où opère la disjonction entre humanité et animalité ; ce qui en l’homme est apparemment le plus animal et naturel est précisément ce qui l’est le moins, car le désir de l’homme est entièrement recodifié comme désir non-naturel d’absolu. C’est en ce sens aussi que la duplicité méthodique est le signe infaillible d’une névrose, d’une maladie de la pensée : le scepticisme moderne est une forme de névrose très grave, et l’une des tâches de la philosophie est de dessiner les termes d’une guérison possible de ce mal mortifère.
J’en viens pour finir à l’ultime thèse de cette leçon : si le désir est nécessairement désir d’absolu, si comme je le crois l’idée d’un désir relatif est un oxymore, une contradiction dans les termes, alors, le choix spéculatif fondamental auquel est confronté tout homme – et toute femme également – dans sa vie, le choix qui engage toute entière la pensée d’un être humain jusque dans les moindres de ses opinions, quel que soit le degré de conscience qu’il en a, est le suivant : il faut choisir entre croire en Dieu et diviniser l’humain. Toute tentative de dédivinisation de l’homme n’est jamais qu’une forme de renforcement de la croyance en Dieu, c’est-à-dire en un dieu transcendant, comme je le montrerai à propos de Montaigne ; et toute croyance en Dieu se soutient de la séparation la plus abyssale possible entre humanité et divinité. Il faut choisir entre donner au divin un statut de transcendance ou bien un statut d’immanence à l’humanité.
J’insiste sur son caractère de choix fondamental, il ne s’agit pas d’un choix simple, dans le mesure où il n’y a pas d’autre choix possible, pas d’alternative, pas de tiers terme de la décision qui soit envisageable. En particulier, on ne peut pas en finir avec Dieu sans assumer une divinisation affirmative de l’homme : toute forme de prétendu athéisme qui cherche à en finir avec Dieu y compris sous la forme d’une dédivinisation de l’homme, ne fait que jeter le bébé avec l’eau du bain pour le dire vulgairement, jeter le bébé du désir d’absolu avec l’eau sale de la théologie dans lequel ce désir s’est trop longtemps vautré. En vérité, une telle tentative est si bien vouée à l’échec qu’elle ne peut pas ne pas nourrir un retour aux superstitions, que préparer une nouvelle forme de croyance en un substitut de Dieu, comme cela tend à être le cas par exemple dans la constitution récente de l’écologie comme idéologie générale post-communiste de la conscience et principe d’orientation globale de la politique.
D’un autre côté, ce qui va faire le caractère profondément dissymétrique du choix, le caractère radicalement non équivalent du choix est que selon que l’on choisit le premier ou le second terme de l’alternative, le rapport de la pensée à l’élément du divin change du tout au tout. Le rapport est le suivant : la conception transcendante du divin entraîne la séparation de la pensée et du divin, autrement dit conduit à une conception irrationnelle du divin. Le rapport au Dieu séparé ne peut pas être autre chose en dernière instance qu’un rapport de croyance irrationnelle en une puissance incompréhensible. A contrario, la conception immanente du divin, celle qui conçoit l’idée de divinité comme inhérente à l’humain, une telle conception conduit à la rationalisation du divin, à sa pensabilité : il n’y aura alors de divin qu’à la mesure de qui ce qui sera rationnellement pensable pour l’homme sous ce nom. En un mot, la croyance en Dieu se cristallise dans l’interdit religieux de la pensée, alors que la divinisation de l’homme opère toujours nécessairement sous une exigence de rationalité et ceci au point que ce qui est divin en l’homme est toujours au final de l’ordre de la pensée, de l’ordre de la conquête d’une nouvelle idée, d’une nouvelle hauteur de la pensée, d’une nouvelle clarté universalisable.
On touche là à un point crucial de ma thèse : la divinisation de l’homme n’est pas une croyance mais une pensée soumise à l’exigence de rationalité, et en vérité seule la thèse de la divinité de l’homme est rationnelle, ou encore : toute forme de rejet de cette thèse, toute espèce de dédivinisation de l’humanité conduit nécessairement à l’irrationalisme. Cela fait partie des choses que je voudrais parvenir à démontrer rigoureusement dans mon futur travail.
En guise d’ultime conclusion du jour : l’orgueil de la pensée, la fierté de ce dont l’homme est capable quand il surmonte sa condition naturelle et historique quotidienne, la présomption ou prétention à penser et faire quelque chose de sa propre vie qui puisse porter la marque de quelque absolu rationnel à mille lieux des superstitions de l’époque, telles sont quelques-unes des conditions anti-sceptiques sine qua non de la vraie vie.
Télécharger le texte en pdf :