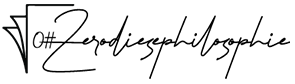Cours de philosophie de Julien Machillot
Ecole des Actes – 15 février 2020
2
Les conditions anthropologico-ontologiques de l’espace subjectif de la poésie hölderlinienne : la Grèce
La Grèce de Hölderlin n’est pas la Grèce de l’humanisme
Dans mon premier cours, j’ai exposé de manière un peu détaillée quel était le but du travail de cette année. On peut le résumer de la manière suivante : l’idée, c’est sous le couvert du livre écrit par Judith Balso sur Hölderlin Ouvrir Hölderlin, de penser sous condition de l’œuvre du poète de manière à construire un dispositif philosophique à même de façonner un concept de l’humanité envisagée comme vide et comme prescription. L’humanité comme vide : l’humanité n’est pas un plein objectivement déterminable mais un vide subjectivement déterminant ; et l’humanité comme prescription : en tant que vide subjectif, le nom d’humanité pourrait être porteur d’une prescription pour l’ensemble des humains, au lieu que l’humanité soit l’objet d’une simple description. Et dans ce cadre-là, on avait commencé à examiner ce que j’ai appelé « les bords anthropologico-ontologiques de l’espace subjectif propre à l’éthique hölderlinienne de la capacité humaine au divin » (Télécharger ici l’annexe du premier cours). Cela signifiait que j’avais désigné le divin, la nature et la Grèce antique comme configurant les coordonnées d’une pensée poétique grâce auxquelles l’enjeu de la poésie pouvait être entièrement concentré – sous l’exigence d’une fidélité intellectuelle militante à la Révolution française – dans l’investigation des conditions d’une confiance retrouvée en la capacité de l’humanité à s’excéder elle-même.
La dernière fois, nous nous étions concentrés sur la question du statut du divin chez Hölderlin, et j’avais essayé d’établir que le divin composait dans sa poésie une figure de disponibilité. Le divin, c’est la disponibilité d’une capacité subjective et collective permettant aux hommes de vivre et marcher sur terre comme des dieux, sans être eux-mêmes des dieux à proprement parler. Judith Balso explique dans son livre que le divin est le nom d’une capacité intérieure à l’humanité, et j’avais proposé de conclure en disant que le divin est tout à la fois ce par quoi l’humanité n’est ce qu’elle est que pour autant qu’elle est ce qu’elle n’est pas, et ce par quoi l’humanité, aussi bien, ne peut être ce qu’elle n’est pas que pour autant qu’elle reste ce qu’elle est.
J’avais essayé d’établir à partir de là ce que n’était pas l’espace subjectif de la poésie de Hölderlin. L’espace subjectif, c’est la configuration des positions subjectives multiples que Hölderlin est amené à traité dans son œuvre pour frayer la voie vers une confiance renouvelée, pour le présent, dans les capacités collectives de l’humanité. Et cet espace subjectif, donc, j’avais essayé de montrer qu’il ne relevait ni d’un universel identitaire abstrait, ni d’un absolu identitaire concret. Je réexplique ces termes car ils sont intégrés dans le schéma que je propose aujourd’hui.
Universel identitaire abstrait. C’est la position humaniste. Elle consiste à considérer qu’il y a une identité universelle de l’humanité. Il s’agit à la fois d’une identité parce qu’elle est sensée différencier l’humanité de ce qui n’est pas humain, en particulier l’animalité, mais aussi les dieux ou les machines. C’est la question de la différence anthropologique. Mais il s’agit en même temps d’une identité universelle, universelle dans la mesure où cette identité vaut pour tous, au sens de « pour tous les êtres humains, pour toute l’humanité ». Et en même temps cet universel identitaire est abstrait au sens hégélien du terme, parce que l’universel en jeu est entièrement désabsolutisé : tout ce qui est absolutisable, au sens de délié de l’humanité, reste extérieur, donc séparé, de l’universel identitaire. C’est cela que signifie « abstrait » chez Hegel, c’est quand l’autre ou le contradictoire d’un terme lui reste extérieur, étranger. Ici, l’autre de l’universel, à savoir l’absolu, lui reste radicalement extérieur.
Absolu identitaire concret. C’est la position hégélienne, la position idéaliste, au sens de l’idéalisme allemand post-révolutionnaire. L’absolu, c’est au départ ce qui désidentifie l’universel. C’est ce qui soustrait l’universel au registre identitaire. Pourquoi ? Parce que toute dimension d’absoluité injectée dans l’universalité introduit en lui un vide, le vide d’une de non-identité à soi, un écart de la position d’universalité avec elle-même. Cela s’explique parfaitement si on l’applique à l’universel humain. Introduire une dimension d’absoluité dans l’identité universelle de l’homme, c’est introduire quelque chose qui n’est pas réductible à l’humanité telle qu’elle est, par définition même du mot absolu. C’est introduire une dimension qui n’est pas réductible à l’identité, mais qui introduit au contraire une dimension de non identité à soi, de vide interne, qui soustrait, donc, l’universel, à l’identité. Donc, quand on introduit de l’absolu dans l’universel, on ouvre l’espace de ce que j’appelle un universel générique, c’est-à-dire un universel de type non identitaire. Mais, à l’inverse, l’absolu lui-même peut être réenvisagé, à l’autre bord, comme étant interne au champ identitaire. C’est ce que pratique l’idéalisme hégélien. L’absolu devient identitaire lorsque d’une certaine manière il englobe complètement l’universel en lui-même. Ce n’est alors plus l’absolu qui introduit un vide, une forme de non identité à soi, dans l’universel, mais c’est l’universel qui vient remplir, en quelque sorte, l’absolu. Le renversement de la logique du vide dans la logique du plein est ce qui introduit l’absolu dans le registre identitaire. Et l’absolu identitaire devient par là-même un absolu identitaire concret, là encore concret est à entendre au sens hégélien. L’absolu est concret parce qu’il inclut son autre, l’universel, en lui-même. Le concret, c’est précisément l’incorporation de l’autre en soi-même, le fait pour un terme d’être chez soi dans son autre, là où l’abstrait, c’est la séparation, l’extériorité d’avec son opposé.
L’enjeu est donc de penser le statut d’un universel générique, qui croise positivement l’universalité et l’absoluité sans tomber dans le registre identitaire, contre l’humanisme d’un côté, contre l’idéalisme de l’autre, et à partir de l’hypothèse que c’est précisément ce que la poésie de Hölderlin met au travail.
LA GRECE :
Nous allons examiner aujourd’hui la question de la Grèce, mais nous allons examiner cette question d’un peu loin. On ne va pas le faire, pour aujourd’hui, directement à partir de Hölderlin.
Je voudrais placer l’investigation de ce qu’il en est de la figure de la Grèce dans l’œuvre d’Hölderlin sous la condition d’une enquête quant à ce qui constitue notre rapport contemporain à la Grèce. Je partirai de l’hypothèse qu’au fond notre rapport à la Grèce est largement défait, et qu’en dehors des études savantes, ce qu’on peut appeler « humanisme » en un sens très large et indéterminé est ce qui dans l’opinion est porteur des restes de représentations tronquées du moment où s’origine ce qu’on pourrait appeler de manière tout aussi vague et indéterminée ‘le destin général du monde occidental moderne’. Ce que je voudrais faire c’est donc partir de ce qui me semble être les résidus de représentation de la Grèce antique dans l’opinion, dans ce que ces résidus ont d’aussi vagues que répandus. Opération qui va donc consister à donner un minimum de consistance à l’inconsistance de l’opinion, de manière à pouvoir travailler à partir de là, de manière à trouver le fil d’un rapport séparé et plus juste à la Grèce, et qui en outre nous rapprocherait de Hölderlin. Qui peut-être même permettrait d’établir ce que j’appellerai la position logique exacte du rapport de Hölderlin à la Grèce. Car il n’y a sans doute pas de vision plus haute, plus puissante, plus intense de la Grèce que celle que porte, dans la modernité, l’œuvre de Hölderlin. Il faut dès lors souligner le caractère délibérément fastidieux de l’enquête sur l’humanisme contemporain auquel je vais procéder aujourd’hui. Il s’agira, une fois n’est pas coutume, de plonger les mains dans des choses suspectes. Ça m’embête un peu de soumettre le lecteur à ça, mais c’est comme ça. Ce qui va compter, c’est ce qu’on va bien pouvoir tirer d’une telle investigation et on verra bien si ça en valait la peine.
A supposer, comme je le fait, qu’on puisse qualifier même vaguement ‘d’humanisme’ ce qui, dans l’opinion contemporaine, véhicule les résidus de représentation déformée, tronquée, de la Grèce antique, il ne faut pas prendre ici ce terme ‘d’humanisme’ seulement au sens où il existe des théoriciens contemporains de l’humanisme, ni même au sens où il existe toute une longue histoire de courants intellectuels dits humanistes, mais en un sens plus plat, au sens de la manière dont circule la notion d’humanisme aujourd’hui dans l’opinion. Donc au sens où est très répandu dans les couches cultivées des démocraties occidentales ce que je proposerais d’appeler un « humanisme d’opinion », qui a par ailleurs ses médiocres théoriciens qui sont plus ou moins grassement payés pour faire discours de cette inconsistante doxa humaniste dans l’espace des études supérieures, mais ça c’est une autre question. L’ « humanisme d’opinion », c’est je crois ce qu’on peut appeler la ‘philosophie spontanée’ du parlementarisme démocratique. Et si c’est le cas, alors il nous fait toucher au cœur même du consensus démocratique dans ce qu’il a de plus bête et de plus stupide, mais aussi de plus inquiétant et violent, puisqu’il est alors par ailleurs l’aura dont s’entourent en France toutes les saloperies détestables qui se drapent sous le nom pompeux de « valeurs républicaines ».
Ce que je vais faire, c’est tenter d’identifier un ensemble d’énoncés, dont je subodore qu’ils donnent la structure sous-jacente de cet humanisme d’opinion, et à partir de là montrer qu’on peut remonter à la question de la Grèce, jusqu’à déterminer ce qui me semble être la position logique exacte du démêlé de Hölderlin à la figure de la Grèce antique.
Il s’agira, en quelque sorte, d’un cours sur Hölderlin sans Hölderlin !
Le premier énoncé de ce que j’appelle donc l’humanisme d’opinion, l’énoncé fondateur, est un énoncé grec, c’est le point d’ancrage précisément de l’humanisme dans l’univers de la Grèce antique, c’est l’énoncé du sophiste Protagoras qu’on trouve dans le dialogue éponyme de Platon, je cite : « l’homme est la mesure de toute chose », et dont la traduction contemporaine est « l’homme est la source de toute valeur ».
« L’homme est la mesure de toute chose » est traditionnellement reçu comme l’énoncé fondateur du relativisme. Si l’homme est la mesure de toute chose, si donc il n’y a pas de mesure extérieure, venant du dehors, alors cette mesure n’est pas absolue, elle est entièrement relative à homme. Autrement dit, « toute chose est relative à la mesure qu’en donne l’homme ». Et il y a un point à souligner, c’est que l’énoncé est anti absolutiste, mais il n’est pas nécessairement anti universaliste. Si l’homme est la mesure de toute chose, il peut y avoir une mesure universelle dans la mesure où ce sera une mesure valant pour toute l’humanité. Ceci pour dire que toute la difficulté va être celle du rapport entre universalité et absoluité.
Si cet énoncé est traditionnellement reçu comme l’énoncé constitutif du relativisme, je veux proposer ici d’envisager les choses de manière un peu différente. Ce que je voudrais, c’est examiner comment en partant de cette distinction entre universel et absolu, comment se redistribuent les cartes du relativisme et du scepticisme. Je vais donc proposer des définitions du relativisme et du scepticisme. Il faudra prendre ces définitions comme des définitions provisoires, dans la mesure où je vais symétriser à outrance les deux définitions, quitte à redonner plus tard à chaque terme ce qui lui revient de singularité non symétrisable. Ce sont donc des définitions délibérément forcées, qui opèrent une sorte de torsion pour part certainement illégitime, et qu’il faut donc prendre comme quelque chose de susceptible de nous servir de boussole pour nous guider dans nos investigations. C’est-à-dire qu’on verra bien si ça nous sert à nous guider réellement, à éclaircir des choses nouvelles et utiles pour ce qu’on cherche.
Je pense qu’il y a de toute façon une grande obscurité dans le partage de ces deux termes – relativisme et scepticisme – dans l’espace intellectuel et d’opinion contemporain. Je donnerai un exemple qui m’a particulier frappé ces derniers temps. J’ai lu quasiment coup sur coup un texte de la sophiste revendiquée et académicienne Barbara Cassin qui reprend l’énoncé de Protagoras et en fait, de manière très traditionnelle, l’énoncé constitutif de son propre relativisme, et j’ai commencé à lire le livre de Francis Wolff Plaidoyer pour l’universel où il est écrit en quatrième de couverture je cite : « Il faut s’y résoudre : l’humanité est seule source de valeurs [donc l’humanité est la mesure de toute chose, traduction contemporaine tout à fait explicite de l’énoncé de Protagoras]. Pour autant, nous ne sommes pas condamnés au relativisme. » !! Donc l’une prend l’énoncé de Protagoras pour en faire le principe du relativisme tandis que l’autre prend le même énoncé pour en faire le point d’appui d’un antirelativisme (sur fond de réactivation des valeurs des Lumières). Et en même temps il y a un double point commun entre les deux. D’abord, ils admettent tous deux une catégorie de l’universel. Avec Wolff, on a affaire à un humanisme universaliste qui se veut antirelativiste, et avec Cassin, on a affaire à un relativisme pour part universaliste, pour autant que l’universel reste révocable à peu de frais. Mais dans les deux cas, la conception de l’universel est pour le moins extrêmement restreinte : c’est ce que j’appellerai un universel de très basse intensité, et encore je suis gentil, car après tout, la question de savoir si on peut réellement parler d’universalisme dans des dispositifs intellectuels pareil est précisément toute la question. Parce que leur universel, ce n’est rien d’autre dans les deux cas, en définitive, que les « valeurs dites occidentales » telles qu’envisagées dans la référence aux droits de l’homme ! Le deuxième point commun, c’est l’absence de référence à la question du scepticisme. Or je pense que de là vient le fait que de telles contradictions dans la conception des rapports entre relativisme et universalité ne sont mêmes pas problématisées comme telles. Et de toute façon quand les deux termes apparaissent, ils ont tendance à substituer plus ou moins allègrement leur place. Or je proposerais volontiers de dire que la difficulté à distinguer clairement entre relativisme, scepticisme, et même par ailleurs nihilisme (il faudrait peut-être introduire ce troisième terme), est non pas de l’ordre d’une ignorance ou d’une connaissance qui se serait perdue, mais est une dimension à part entière de la désorientation actuelle. Désorientation au sens où pour constituer une orientation véritable dans la pensée, il faut précisément mettre à distance ces termes, mais comment mettre en adversité dans toute l’ampleur que suppose le caractère antagonique de cette adversité, des termes qui nagent dans une espèce de flou général ? D’où qu’on ne puisse pas à mon sens traiter tout à fait séparément (au moins) les termes de scepticisme et de relativisme. Je partirai pour ce faire d’une distinction très symétrisée, même si forcée, des deux termes.
Ce que je propose est donc la chose suivante :
Je dirai que le relativisme c’est la négation de tout ce qu’il y a d’absolu dans l’universel, tandis que le scepticisme est à l’inverse la négation de tout ce qu’il y a d’universel dans l’absolu. Autrement dit, le relativisme est un opérateur de désabsolutisation de l’universel. Ce qui ne signifie pas qu’il soit antiabsolutiste ! Peut-être qu’en vérité il n’y a pas plus absolutiste que le relativiste ! Et à l’inverse, le scepticisme est un opérateur de désuniversalisation de l’absolu. Ce qui ne signifie pas, cette fois, qu’il soit antiuniversaliste ! Peut-être que derrière toute sa prétendue prétention à la modestie, il n’y a pas de plus farouche prétendant à l’universalisme que le sceptique ! Ce qui est intéressant ici, avant même de commencer à comprendre de quoi il retourne dans cette articulation inversée des rapports entre universalité et absoluité, c’est de voir que ce sont des définitions qui maintiennent, contre ce qui semble être traditionnellement les prétentions du relativisme et du scepticisme, les deux termes sur le terrain de l’absolu et de l’universel. Autrement dit, ma thèse sous-jacente, à travers ces deux définitions, c’est que le véritable antagonisme n’est jamais entre universalisme et antiuniversalisme ou entre absolutisme et antiabsolutisme – alors que tout nous est précisément présenté comme ça aujourd’hui ! – mais qu’il est toujours interne à l’universalisme et interne à l’absolutisme, il se situe toujours entre deux conceptions de l’universel ou entre deux conceptions de l’absolu, même si évidemment tout l’enjeu est chaque fois de montrer qu’on a affaire avec un des deux termes de l’antagonisme à un faux universel ou à un mauvais absolu. J’affirme par exemple qu’à mon avis il n’y a pas plus absolutistes que les relativistes qui répètent à longueur de conversations « il n’y a pas d’absolu, tout est relatif ». Sur ce point je dirai d’abord qu’on entend tous les jours le terme « relativiser », « il faut relativiser », « je relativise ». L’objection que j’ai à faire à ça, c’est qu’en vérité, la relativisation, au sens strict, ça n’existe pas. Relativiser, c’est désabsolutiser quelque chose, dédramatiser quelque chose pour ne pas en faire un absolu. Très bien ! Mais le problème, c’est que quand quelqu’un dit « je relativise ceci ou cela », vous pouvez être absolument certain qu’il ré absolutise quelque chose d’autre par derrière, fût-ce à son insu ! Toute prétendue relativisation est une désabsolutisation, mais toute désabsolutisation est toujours réabsolutisation d’autre chose. La question est chaque fois de savoir quoi. Prenons maintenant l’énoncé « tout est relatif » : alors ça c’est vraiment un cas d’école. Tout le monde sait de quoi il retourne, il y a là une question de rationalité minimale, vraiment très minimale, qui se pose, or personne ne la prend au sérieux, alors qu’il faudrait à mon avis au contraire la prendre complètement au sérieux ! Le problème, c’est que si tout est relatif, alors il y a bien un absolu, c’est la relativité de toute chose ; et s’il n’y a pas d’absolu, alors tout ne peut pas être absolu puisque ce serait alors absolutiser la relativité elle-même, donc il y a de l’absolu, puisque tout n’est pas relatif. Donc l’énoncé « tout est relatif » est contradictoire, inconsistant, totalement vide de sens. Or il y a tout un tas de gens, notamment les gens de gauche, je crois même que c’est typique de l’imposture constitutive de la gauche actuelle, qui répètent sans cesse de manière qui plus est très autoritaire à qui veut bien les entendre que « tout est relatif » et « qu’il faut en finir une fois pour toute avec l’absolu », c’est-à-dire avec la religion ! Car l’absolu est alors entièrement assigné à la religion, donc à la figure du Dieu unique. On a ici affaire avec la figure de la gauche à ce qu’on pourrait appeler le relativisme critique, qui n’est pas le tout du relativisme, loin de là. Or ce qui caractérise le relativisme critique, c’est qu’il procède en fait à l’absolutisation du relatif même. C’est le geste même de relativisation qui est posé comme absolu, et c’est donc bien par conséquent une imposture : l’énoncé relativisant est ici contredit pas la position d’énonciation absolutisante. Et je pense que c’est souvent dans le jeu, l’écart, entre « énoncé » et « position d’énonciation » que se loge le caractère faussement antiabsolutiste de l’antiabsolutisme prétendu ou le caractère faussement antiuniversaliste de l’antiuniversalisme revendiqué, du moins lorsqu’on est dans l’espace général de la « critique ».
Pour en revenir à mes deux définitions, et au schéma que j’ai fait pour aujourd’hui, je dirai que le relativisme est ce qui fait usage de l’absolu comme d’une machine de guerre contre l’universel. Le relativisme se présente comme antiabsolutiste. Mais, comme je l’ai dit, en fait, il désabsolutise toute figure d’universalité, ou il désabsolutise tout ce qui est universalisable. Mais en désabsolutisant tout universel, le relativisme en vient toujours par-là à absolutiser un terme non universel. C’est pourquoi on peut dire qu’en réalité, le relativisme, lorsqu’il n’est pas enfoncé dans l’imposture du relativisme critique que je viens de décrire, est toujours un relativisme ouvertement absolutiste. Et j’ajouterai que définir ainsi le relativisme, cela nous permet de caractériser rien moins que l’essence du fascisme. Le fascisme, c’est un relativisme absolutiste. En regard d’une telle définition, si on s’en tient à l’idée que le relativisme est antiabsolutiste, alors cette définition est contradictoire et ne veut rien dire. Mais si on admet, comme je le propose, qu’en réalité le relativisme est désabsolutisation de tout universel et par conséquent absolutisation d’un terme non universel, alors le syntagme « relativisme absolutiste » prend tout son sens. Car il est bien vrai d’une part que pour le fascisme rien de ce qui est véritablement universel – pour tous – n’est absolu ; et il est bien vrai d’autre part, que le fascisme procède à l’absolutisation d’un terme non universel, en l’occurrence une identité. Car qu’y a-t-il de moins universel que les identités précisément ? Et qu’y a-t-il de plus absolutisé par le fascisme que ces mêmes identités ? On appellera « faux absolu » ou « mauvais absolu » toute figure d’absoluité ainsi désuniversalisée. Ça peut être les identités, comme dans le cas du fascisme, mais on pourrait sans doute déterminer d’autres formes encore de relativisme absolutiste qui absolutiseraient d’autres termes non universalisables que les identités. Entre parenthèses, il ne faut pas confondre l’absolutisation fasciste de l’identité, donc la notion d’identité absolue, avec l’absolu de type identitaire que l’on trouve déployé dans la dialectique hégélienne et dont j’avais parlé dans mon premier cours. En effet, l’absolu identitaire est absolutisation d’un universel et non d’une identité ; autrement dit, la dialectique hégélienne consiste à déterminer non une identité absolue, mais une identité de l’absolu, ce qui n’a strictement rien à voir. Ce n’est pas l’identité qui est absolutisée, mais l’absolu qui est identifié à lui-même par la médiation de son autre, le relatif. On ne peut à ce titre absolument pas dire que la dialectique hégélienne serait protofasciste, puisqu’elle n’est en rien relativiste. Encore une fois, le point clef, c’est que le fascisme est un relativisme ! Un relativisme absolutiste, mais un relativisme ! Ce qui signifie aussi par ailleurs que le fascisme n’est pas un scepticisme. Ce n’est pas un scepticisme, puisque c’est un absolutisme. Absolutiser une identité, c’est toujours chercher activement à absolutiser quelque chose, même si l’absolutisation est ici l’imposture certainement la plus destructrice qui puisse exister.
Ce qui est très intéressant ici pour moi c’est que l’humanisme, en tant que scepticisme, se retrouve, envisagé dans sa pure logique spéculative interne, comme en strict vis-à-vis du fascisme. L’humanisme se présente comme une sorte de miroir inversé du fascisme, ce qui semble a priori être sa force, mais qui est en fait sa faiblesse fondamentale. Le fascisme est un relativisme absolutiste ; à contrario, l’humanisme est un scepticisme universaliste. Là où le fascisme fait de l’absolu une machine de guerre contre l’universel, l’humanisme fait à l’inverse de l’universel une machine de guerre contre l’absolu. D’où le fait que l’humaniste se targuera d’être l’idéologue le plus antifasciste qui soit, ce qui n’est pas pour rien dans l’arrogance avec laquelle les démocraties occidentales ont pu mettre aussi facilement dos à dos fascisme et communisme en s’innocentant ainsi à peu de frais, par ce tour de passe-passe, dans la terrible histoire des guerres criminelles du 20ème siècle ! Or on va voir qu’en vérité c’était bien plutôt le communisme qui était en position d’exception là-dedans, ne se tenant en vis-à-vis ni de l’humanisme démocratique, ni de l’antihumanisme fasciste. Donc on a un premier vis-à-vis, un premier plan de symétrie, avec d’un côté le fascisme comme relativisme absolutiste et de l’autre l’humanisme comme scepticisme universaliste. Le fascisme procède par absolutisation des identités. Comment procède l’humanisme ? Logiquement, puisqu’il travaille à la désuniversalisation de toute figure d’absoluité, l’humanisme sceptique va procéder par universalisation d’un terme non absolutisable. Or, cet universel non absolutisable, c’est, je vous le donne en mille, précisément, l’homme, l’humanité elle-même ! C’est en assignant l’universalité à l’humanité elle-même que l’humaniste sceptique va maintenir la figure d’une universalité non absolutisable. Je dirai que l’universel humaniste est un universel faible ou de basse intensité, au sens où c’est un universel soustrait à toute opération d’absolutisation interne qui seule peut réellement lui donner sa véritable consistance, sa densité au-delà des platitudes du sens commun, son épaisseur qui n’est qu’aveuglement pour le bon sens qui se contente de peu, bref, son intensité spéculative. Tout l’enjeu pour le scepticisme humaniste est au final d’établir non pas l’universalité d’un terme absolutisable, mais l’universelle absence d’absolu. Donc comment procède l’humanisme exactement ? Comment peut-il utiliser l’universel contre l’absolu ? La réponse est immédiate, contenue dans le terme même d’humanisme : C’est précisément en assignant l’universel à l’humain que l’universel devient un opérateur antiabsolutiste. Pourquoi ? Parce que par définition, est absolu ce qui existe ou vaut indépendamment de l’humain. Par conséquent, si l’universel est entièrement enclot dans l’humanité de l’homme, alors tout accès à l’absolu devient humainement impossible. Le scepticisme humaniste est donc un scepticisme par assignation de l’universel à l’humain, assignation qui se cristallise parfaitement dans les deux énoncés, antique et contemporain : « l’homme est la mesure de toute chose » et « l’homme est la source de toute valeur ». Assigner l’universalité à l’humanité, cela consiste à faire de l’humanité la source de toute valeur. Ces valeurs peuvent être envisagées comme universelles, c’est-à-dire comme valant pour toute l’humanité, mais elles ne sauraient être absolutisables, parce que pour qu’il y ait absolu, il faut qu’il y ait un terme délié de l’humanité, non relatif à l’homme ; il faudrait par conséquent que la mesure des choses viennent du dehors, et non de l’intériorité humain. Par conséquent, et c’est là qu’il y a pour moi comme un certain flottement, l’indice de quelque chose qui n’est pas encore complètement déployé, c’est que je fais pour ma part de l’énoncé de Protagoras l’énoncé constitutif du scepticisme, alors qu’il était clair dans l’antiquité qu’il s’agissait de l’énoncé du relativisme et non du scepticisme. C’est une espèce de conséquence contradictoire sur laquelle je tombe comme sur un os, et disons pour l’instant que « c’est comme ça ».
Venons-en, pour faire le tour de mon schéma, au communisme. Je dirai que seul le communisme, dans ses meilleures tendances, se pensait sous l’exigence d’une alliance et non d’une opposition de l’universel et de l’absolu, échappant aux deux formes d’imposture symétriques consistant à croire que l’on puisse impunément jouer d’un terme contre l’autre. Seul le communisme n’était ni universaliste par défaut, ni absolutiste par défaut, négativement, de manière intrinsèquement critique. J’ai écrits que le relativisme absolutiste et le scepticisme universaliste se distinguaient du relativisme critique et du scepticisme critique. Mais ici, on a affaire à ce que j’appellerai une dimension critique de second niveau : le relativisme absolutiste se présente comme un affirmationisme, mais l’absolu qu’il prône est un faux absolu reposant sur une opération essentiellement négative. A ce titre, le relativisme absolutiste reste un relativisme critique, mais un relativisme critique de second niveau. Idem pour le scepticisme universaliste. Parler de critique de second niveau, c’est nier qu’on ait affaire à un vrai absolu ou à un vrai universel dans le relativisme ou le scepticisme. Et j’ajouterai que seul le communisme, dans sa meilleure figure, ne faisait d’aucun des deux termes un opérateur purement négatif et critique plaçant la pensée de l’humanité sous le signe de la finitude. Car, encore une fois, l’humanisme n’est universaliste que par défaut, contre l’absolu, et le fascisme n’est absolutiste que par défaut, contre l’universel. Seul le communisme est donc tout à la fois et universaliste et absolutiste. Seul le communisme fonde ainsi une pensée véritablement affirmative. Car la condition de la pensée affirmative, c’est d’être capable d’affirmer rationnellement à la fois et l’universel et l’absolu. Bien sûr cela ne signifie pas que l’affirmationnisme communiste soit dénué de gros problèmes à résoudre ! En réalité, l’affirmationnisme a sa difficulté propre, que j’avais aussi commencé à repérer dans le premier cours. Cette difficulté, c’est quoi ? C’est que s’il faut affirmer à la fois et l’universel et l’absolu, ce ne peut être sous la forme brute d’un universel absolu, mais sous celle de ce que j’ai appelé un universel générique, contenant en lui-même une part d’absolu, mais ne pouvant pas être absolutisé de part en part sans retomber sur le terrain identitaire, identitaire au sens non plus fasciste, puisque ce n’est pas, encore une fois, un relativisme, mais au sens idéaliste et dialectique. Autrement dit, s’il faut affirmer à la fois et l’universel, et l’absolu, ce ne peut être au titre de l’identification des deux termes l’un à l’autre : universel = absolu. Il est nécessaire de maintenir un usage séparé, donc matérialiste, des deux termes, contre toute tentation idéaliste de leur identification. Car identifier universel et absolu, en définitive, ce n’est pas moins mortifère que de jouer d’un des deux termes contre l’autre, car c’est encore une manière d’en annuler la consistance interne. On pourrait dire d’ailleurs que la notion d’universel absolu ou d’absolu universel, c’est la même chose, se tient quant à elle en vis-à-vis non de l’humanisme ou du fascisme, mais de l’humanisme et du fascisme en même temps. Or ce vis-à-vis, bien que plus global et radical que le vis-à-vis humanisme/fascisme, serait encore un échec, encore une manière de se situer sur le même plan de symétrie que l’ennemi idéologique, comme on le voit dans mon schéma. C’est donc doublement que le communisme, le communisme vrai, se soustrayant aux oppositions en miroir composant des plans communs de symétrie, constitue le véritable pôle antagonique vis-à-vis du monde tel qu’il est. Le communisme vrai et soustrait tout à la fois au vis-à-vis du relativisme absolutiste et du scepticisme universaliste, et au vis-à-vis de ce qu’on peut appeler négation critique ou finitudinaire d’un côté et, disons, négation affirmative ou négation infinitisante, de l’autre, puisque l’absolu pensée dialectiquement dans son identité universelle consiste à le fonder entièrement chez Hegel sur le travail du négatif qui lui est interne. L’identité dialectique de l’universel et de l’absolu se fonde dans l’idéalisme hégélien sur le primat du négatif, ce en quoi il reste bien en vis-à-vis du doublet humanisme/fascisme, bien qu’il ne soit en rien réductible ni à l’un, ni à l’autre.
Revenons maintenant à l’humanisme d’opinion. J’ai établi que son premier énoncé est « l’homme est la mesure de toute chose » ou « l’homme est source de toute valeur ». A partir de là viennent s’articuler quatre autres énoncés qui véhiculent à mon avis la représentation fausse et dévoyée de l’esprit grec antique une fois que celui-ci a de toute façon était ramené dans son fondement à l’énoncé de Protagoras. Le deuxième énoncé est « l’homme est capable du meilleur comme du pire ». On touche le fond dès le deuxième énoncé. Ce qui va caractériser les quatre énoncés, c’est précisément leur platitude. Troisième énoncé : « tout excès est mauvais ». Interprétation tout à fait plate de la véritable menace que représentait pour les grecs la figure d’excès qu’ils appelaient « hubris », c’est-à-dire « démesure », en tant que cette démesure était le ressort des opérations dramatiques de la tragédie grecque. Quatrième énoncé qui s’en déduit directement : « les extrêmes se touchent, en particulier les deux extrêmes du bien et du mal ». Enoncé dont la version parlementaire bien connue est « les deux extrêmes de la gauche et de la droite se touchent, sont équivalents ». Mais aussi énoncé dont il existe une autre version : « vouloir le bien conduit à l’excès donc au mal, mieux vaut se contenter de limiter le mal » : on a ici tout le bilan antitotalitaire du 20ème siècle par les idéologues réactionnaires des années 80. Cinquième énoncé, enfin, qui est l’énoncé prescriptif moral de l’humanisme, sa maxime éthique résultant logiquement de l’articulation des quatre énoncés précédents : « il faut chercher en toute chose le juste milieu, le juste équilibre ». Voilà les cinq énoncés constitutifs de ce que j’appelle l’humanisme d’opinion entendu comme philosophie spontanée du parlementarisme – du parlementarisme dit démocratique, républicain, ça c’est sûr, mais peut-être aussi monarchiste. Après tout, c’est le britannique Churchill qui a lâché l’idée que « la démocratie était le pire des régimes, à l’exception de tous les autres », ce qui est bien dans l’esprit de l’humanisme d’opinion.
Revenons à la phrase « l’homme est capable du meilleur comme du pire ». En fait, c’est là un écho très lointain, très affaibli, complètement édulcoré d’un énoncé qu’on trouve chez Sophocle, donc un énoncé qui n’est pas d’un sophiste, qui n’est pas non plus d’un philosophe, mais d’un dramaturge, d’un des plus grands écrivains de tragédie grecque, un énoncé dont je dois la connaissance à Judith Balso, et qui va petit à petit nous ramener à Hölderlin. C’est un énoncé qui ouvre un des premiers épisodes du chant du chœur dans l’Antigone de Sophocle (vers 333). Une traduction possible de ce vers est :
« Quelle chose admirable que l’homme !
Quelle chose terrifiante que l’homme ! »
Dans la traduction il n’y a pas un vers, mais deux vers ; pour faire une traduction complète du vers de Sophocle, on est obligé de traduire deux fois le même vers, parce que « chose merveilleuse » et « chose terrifiante » sont contenus chez Sophocle dans un même mot grec : DEINOS. Or il n’existe pas en français (mais y-a-t-il une langue où cela est possible ?) de mot capable de traduire l’équivoque portée par le mot grec DEINOS. Deinos ressemble un peu à « dieu » en français, sauf qu’en grec « dieu » c’est « Théos », et le divin « Theïkos ». DEINOS signifie à la fois merveilleux et monstrueux, prodigieux et effrayant, ou encore admirable et terrifiant. On pourrait dire je crois que c’est le mot grec qui concentre en lui toute la condition tragique de l’humanité. On intuitionne bien immédiatement qu’il s’agit là d’un énoncé infiniment plus intense et plus riche que « l’homme est capable du meilleur comme du pire ». D’abord, la position d’énonciation n’est pas du tout la même. La phrase humaniste moderne se donne sur un ton neutre et objectif, purement constatatif qui tranche d’ailleurs très bizarrement avec la portée de ce qu’elle signifie si on essaie de la prendre au sérieux. C’est une position d’énonciation ouvertement banalisante. C’est, au fond, l’énoncé de ce que Lacan appelait le « non-dupe », du non-dupe qui en a vu d’autres et qui est revenu de tout, à qui on ne la fait pas. Oui, l’homme, voilà, bon, c’est comme ça, on y peut rien ! En revanche, le vers tragique antique se donne à travers une position d’énonciation duale, proprement ambivalente, dont l’équivocité, on pourrait dire la schizophrénie, reflète le sens et la portée du sens de ce qui y est dit. Je veux dire que c’est avec le ton de la plus haute admiration que l’on affirme que l’homme est merveilleux ; et c’est, simultanément, sur le ton de la plus angoissante frayeur que l’on affirme qu’il est monstrueux. Autrement dit, dans les deux cas c’est certes l’homme qui parle. Mais dans le cas grec, l’énoncé est maximalement subjectivé, ce qui signifie que l’homme qui parle se compte pleinement dans ce qu’il dit. Alors que dans l’énoncé humaniste, l’énoncé est au contraire maximalement objectivé, celui qui parle ne se compte pas dans ce qu’il dit, il n’est pas en tout cas immédiatement impliqué dans ce qu’il affirme, parce qu’en réalité, connaissant la vérité de la nature humaine, il est en quelque sorte très au-dessus de tout ça ! On a ici typiquement une position d’imposture, on a même la position d’énonciation structurelle dont se supporte toute imposture : je dis ce qu’est l’homme, je suis un homme, mais connaissant la vérité sur l’homme, je suis au-delà des autres hommes, je suis ailleurs. C’est l’objectivation ou la désimplication comme imposture. L’opération d’objectivation peut être une opération d’imposture fondamentale. Donc la différence d’intensité des deux phrases est liée à une rupture dans leur position d’énonciation respective. A quoi on peut ajouter qu’en réalité, quand l’humaniste a aujourd’hui affaire à un énoncé d’intensité semblable à celui de Sophocle, sa réaction, qui est là aussi à mon avis de l’ordre d’une opération d’opinion structurelle, consiste à oublier la première partie et à ne garder que la deuxième, c’est-à-dire à oublier bien vite le meilleur pour ne garder que le pire. J’en veux pour preuve que tout le monde connaît l’énoncé de Thomas Hobbes, qui est en écho de celui de Sophocle. Tout le monde connaît l’énoncé, l’a entendu et l’a dit un jour ou l’autre, même si on ne sait pas forcément que c’est un énoncé hobbesien. Cet énoncé, c’est « l’homme est un loup pour l’homme ». Ca, tout le monde le connaît. Mais ce que presque personne ne sait, ou presque, même parmi ceux qui savent que c’est un énoncé de Hobbes, c’est-à-dire même parmi les gens dit « cultivés », c’est que l’énoncé complet de Hobbes, c’est en réalité : « Il est également vrai que l’homme est un dieu pour l’homme, et que l’homme est un loup pour l’homme » (on trouve cet énoncé dans l’épître dédicatoire qui ouvre le livre De Cive, Le Citoyen). Il est tout à fait caractéristique que l’humanisme d’opinion n’ait gardé mémoire que de la partie négative. Encore une fois, ce n’est pas une faute de connaissance, mais une structure d’opinion, ce n’est pas une ignorance, mais disons une méconnaissance, au sens de la méconnaissance de type idéologique dont parle Althusser quelque part.
Ceci étant dit, une fois établie l’hétérogénéité des deux positions d’énonciation, quel est l’opérateur de dissymétrie des deux énoncés ? Car il y en a un. Ce n’est pas seulement que la phrase humaniste est un écho éloigné de la phrase grecque. En vérité, il y a dans la phrase humaniste un pivotement du sens qui est un dévoiement de la phrase grecque. Cet opérateur de dissymétrie, il porte sur le statut de l’excès. Leur statut n’est absolument pas le même dans l’un et l’autre cas. En réalité, dans la phrase de Sophocle, il y a une scission de l’excès. L’excès est divisé en deux. La dimension admirable de l’homme n’est pas moins excessive que sa monstruosité. Autrement dit, contrairement à la phrase « l’homme est capable du meilleur comme du pire » dont l’énonciation entièrement dépassionnée, désaffectée (au sens de désaffecter des affects) pourrait-on dire, conduit à « tout excès est mauvais », la phrase de Sophocle conduit plutôt à l’idée de Hölderlin selon laquelle les hommes peuvent vivre sur la terre comme des dieux. Je dirai que l’opération de scission de l’excès est au cœur de la poésie de Hölderlin. Elle se donne de la manière suivante : que les hommes puissent vivre sur la terre comme des dieux, il s’agit bien là d’une capacité de l’humanité à vivre en excès sur elle-même, mais en même temps cela ne signifie aucunement que les hommes puissent être des dieux ou puissent s’égaler à eux. D’une part, l’idée d’une capacité des hommes à vivre en excès sur eux-mêmes, cela implique stricto sensu que l’homme n’est pas la mesure de toute chose, car l’homme ne peut vivre en excès sur lui-même que s’il prend comme source de mesure de la vie humaine autre chose que lui-même, le divin. D’autre part, le comme de la comparaison est ici l’opérateur de scission. L’excès comme hubris mortifère, c’est-à-dire comme démesure, consiste à identifier les hommes et les dieux comme s’ils étaient le même, et cette identification nomme la position d’imposture qui menace l’humanité et qu’il s’agit chaque fois de conjurer. Et alors, point qui m’intéresse tout particulièrement, je dirai que d’une certaine manière, la poésie hölderlinienne cristallise en poème ce que Badiou dans l’Immanence des vérités a théorisé au titre du « presqu’être absolu » des vérités. Je ne vais pas m’étendre là-dessus maintenant, je ne fais que l’indiquer, mais le rapprochement est intuitivement assez évident. Chez Badiou, la scission ne relève pas d’un opérateur poétique mais d’un opérateur mathématique, engageant notamment la notion mathématique d’« ultrafiltre non principal ». L’idée est que les vérités ne sont pas absolues en tant que telles dans la mesure où elles ne s’identifient pas à l’absolu mais elles sont des attributs de l’absolu. Or être un attribut de l’absolu relève d’une fonction mathématique appelée « plongement élémentaire de V (c’est-à-dire de l’absolu) dans ses attributs (c’est-à-dire les vérités) » et ça signifie que les vérités sont tout au plus comparables à l’absolu (puisqu’en mathématique ce sont les fonctions qui opèrent la comparaison entre différents ensembles) et que par conséquent une vérité va en quelque sorte représenter l’absolu mais sans même lui ressembler (pour des raisons mathématiques que je ne peux pas expliquer ici). Par cette fonction, par ce « comme », toute vérité touche en un point à l’absolu mais sans s’identifier à lui. Tout cela entraîne des choses très compliquées évidemment, mais je conclus ici rapidement qu’on pourrait requalifier philosophiquement l’opérateur mathématique à l’œuvre, via la poésie de Hölderlin, de « plongement élémentaire du divin dans l’humain », figure d’excès à ne pas confondre à ce qu’en mathématicien on appellerait la thèse d’existence d’une relation biunivoque (relation d’égalité ou d’identité, mathématiquement c’est la même chose) du divin et de l’humain et qui représente cette fois l’hubris mortifère, l’excès comme démesure.
Donc si on reprend la phrase de Sophocle, si on la prend au sérieux, il faut conclure que d’une certaine manière, il est inutile de parler de juste milieu, d’équilibre ou autres calembredaines humanistes puisque d’une certaine manière, l’homme est ou bien formidable, ou bien une calamité, il n’y a pas d’entre-deux, il n’y a pas de milieu, ou, plus exactement, l’entre-deux, le milieu, ne sauraient être le lieu normatif de la vie humaine, ils ne sauraient être le lieu de la justice : il n’y a pas de « juste milieu ». Cela ne signifie pas qu’il n’y ait pas d’équilibre ou de justice, seulement que cet équilibre ne se situe pas dans un entre-deux, mais doit être trouvé à l’intérieur même de la figure de l’excès.
La scission de l’excès implique en fait la scission de la question de la norme. Ce n’est pas simplement que l’homme n’est pas la mesure de toute chose, c’est que la notion de mesure, changeant de source, va aussi partiellement changer de signification. La notion de mesure, de norme, n’aura pas le même sens dans les deux cas, ce qui signera, si on démontre ce point, la dissymétrie définitive de la vérité tragique grecque antique et de l’opinion humaniste parlementaro-républicaine.
Pour la mesure humaniste, tout excès est mauvais parce que tout excès est une démesure. Alors que pour la mesure hölderlinienne, tout excès n’est pas une démesure, et par conséquent il existe une mesure de l’excès, ou plutôt : il existe une figure de d’ « excès mesuré » qui a sa propre norme. Et s’il y a une norme de l’excès, en tant qu’il y a un excès mesurable, c’est-à-dire une mesure de l’incommensurable alors l’homme n’est pas la mesure de toute chose puisque si cet excès a quelque chose d’incommensurable, c’est précisément du point de la norme dont l’homme serait la source. Donc : il y a excès et excès. Un bon et un mauvais excès, si on veut aplatir les choses. Il y a l’excès comme mesure du point d’une norme qui est elle-même en excès par rapport à l’humanité ; et il y a l’excès comme démesure du point de l’absence de toute norme, humaine ou inhumaine. Il y a la norme de l’excès qui se donne comme seule véritable juste mesure, et il y a la démesure qui se donne comme excès sur toute norme.
Ici, c’est jusqu’à la notion même d’inhumanité qui change de sens : pour l’humaniste, l’inhumain c’est le mauvais en l’homme (ce qui là encore renvoie à l’intuition la plus courante et partagée du terme, c’est ce qui est installé aujourd’hui dans l’opinion, quand on veut dire que ce qu’ont fait des gens est vraiment mauvais, on dit qu’ils ont fait quelque chose d’inhumain… ce pourrait être l’objet d’un sixième énoncé de l’humanisme d’opinion : « tout ce qui dépasse la mesure de l’humain est une démesure inhumaine », donc « l’inhumain, c’est le mal », c’est pour ça que ça se situe de manière unilatérale du côté du crime sanglant etc.), pour le grec ou le disciple de Hölderlin, l’inhumain est la source d’une norme pour l’humanité, en excès sur l’humanité. Dans le cas de l’humanisme, puisqu’il ne saurait y avoir de norme de l’excès, l’inhumain est une figure extérieure à l’humanité, l’homme inhumain est celui qui cesse d’être un humain ; dans le cas grec au sens générique, l’inhumain est toujours une figure d’excès interne à l’humanité, car s’il y a une norme de l’excès, alors l’inhumain devient la ressource même de l’humain, la meilleure part de l’humanité, et non plus de manière unilatérale sa part sinistre. Mais par ailleurs, l’inhumain au sens de l’hubris, de la démesure, de l’excès sur toute norme, reste lui aussi interne à l’humain, cette intériorité étant à la mesure du caractère subjectivé de l’énoncé de Sophocle. Et d’ailleurs, pour Hölderlin, il s’agit bien d’une figure interne, puisque dans une lettre à son frère qu’on étudiera il affirme que tout, même le pire, vient du besoin de l’humanité de se faire une vie meilleur.
Par ailleurs, la norme conçue comme conjuration de tout excès est toujours tout à la fois morale et juridique, tandis que la norme envisagée comme norme de l’excès ne relève pas du sens moral mais du vrai, non d’une éthique sensée mais d’une éthique des vérités, et elle n’est pas juridique mais métaphysique : en effet, la norme juridique est toujours relative à une loi humaine et en réalité étatique, alors que toute norme de l’excès est une manière de faire valoir l’absolu dans le monde et jusque dans la vie elle-même. L’humanisme d’opinion républicain est un moralisme et un juridisme, tandis que l’esprit grec relève de la métaphysique et de la législation du vrai.
Je dirai pour conclure que tout le démêlé de Hölderlin avec la Grèce vient de ce qu’avec la Grèce antique le poète est aux prises avec les difficultés de la scission de l’excès : l’enjeu de la pensée poétique est de déterminer les conditions d’une confiance renouvelée en la capacité humaine collective au divin, donc en la capacité de l’humanité à s’excéder elle-même, tout le problème étant à partir de là de donner forme à une norme de l’excès qui ne soit pas effondrement dans l’excès sur toute norme, c’est-à-dire écrasement du présent sous une démesure impossible à normer. Or c’est dans le site grec, dans les ruines de la Grèce antique, que Hölderlin trouvera la norme définitive de l’excès à l’aune de laquelle investiguer le présent lui-même, au péril constant de finir par faire de la Grèce une figure d’excès démesuré écrasant le présent de tout son poids mortifère. Il y a sur ce point une évolution de Hölderlin, que décrit Judith dans son livre. Dans un premier temps sa tendance est de se laisser écraser par la figure de la Grèce comme excès sur toute norme, écrasant le présent de tout son poids. C’est de là qu’est née la légende du rapport romantique et nostalgique du poète à la Grèce, accusation qui court de Hegel jusqu’à nos jours, et qu’on trouve y compris chez des commentateurs qui cherchent par ailleurs à rendre justice à ce qu’a apporté Hölderlin à ses amis Hegel et Schelling dans l’évolution de leur philosophie, comme par exemple Jacques Rivelaygue. Mais dans un deuxième temps, Hölderlin parvient à fixer définitivement la Grèce comme norme antiromantique de l’excès.
D’où s’origine ce démêlé de Hölderlin avec la figure de la Grèce antique ? En réalité, il faut ici dialectiser la Grèce et la Révolution française : c’est parce que le poète est confronté, avec la Révolution française, à un excès qui ne trouve pas en lui-même sa norme interne, qu’il va trouver la norme de l’excès dans la Grèce antique.
Qu’est-ce alors que la Grèce pour Hölderlin ?
La Grèce, c’est le seul véritable lieu qu’habite subjectivement Hölderlin de manière constante. Si le site natal objectif du poète est l’Allemagne, ou plus précisément le jura souabe, la Grèce est son véritable site natal subjectif, c’est-à-dire le lieu de naissance de sa pensée. La Grèce vit en lui comme la mesure intérieure de ce que peut et doit être l’humanité, et elle fait à ce titre vérité, de manière indubitable et définitive, de ce qu’il en est de la liberté et capacité créatrice humaines.
On avait vu la dernière fois que le Divin est une figure de la Disponibilité – plus précisément de la Capacité (humaine) disponible.
On a vu aujourd’hui que la Grèce antique est une figure de la Norme – plus précisément de la Norme de l’Excès (pour cette capacité).
Reste à traiter la figure de la Nature.
Télécharger l’annexe du cours ici
Télécharger le cours en pdf :